Syndicalisme de transformation sociale
Dans notre union syndicale Solidaires, nous estimons que le syndicalisme doit tout à la fois agir pour participer à l’amélioration de la situation concrète, aujourd’hui et maintenant, des travailleurs et des travailleuses, des chômeuses et des chômeurs, des précaires, des personnes retraitées, etc., et, dans un même temps, conjointement, œuvrer pour participer à la transformation de la société. Nous voulons ainsi vivre et faire vivre un syndicalisme du quotidien et un syndicalisme de transformation sociale.
Cette « double besogne » du syndicalisme est plus ou moins inscrite dans les gènes d’une partie du syndicalisme en France depuis le 9e congrès de la CGT tenu à Amiens en octobre 1906. Ce sont ces textes de 1906 qui sont maintenant désignés par les termes « La Charte d’Amiens ». Les congressistes ont alors voulu expliciter le sens qu’ils donnaient à l’article 2 des statuts constitutifs de la CGT de 1895 : « La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat ».
Il est certainement utile de rappeler dès maintenant le texte voté en 1906 par les congressistes de la CGT, dès lors que notre union syndicale Solidaires prétend assez régulièrement s’y référer : « Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte des classes, qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique : dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme : d’une part il prépare l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste, et d’autre part, il préconise comme moyen d’action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupe de production et de répartition, base de réorganisation sociale. Le Congrès considère que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait, à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le syndicat. Etc. »
Le fait que ce texte ait été voté il y a près de 110 ans n’est pas, a priori, une raison de le rejeter car daté et donc obsolète. Il y a des textes encore plus « anciens », qu’on trouve chez Socrate, Platon, Aristote, Montaigne, Descartes, Montesquieu, la Déclaration des Droits de 1789, celle de 1793, etc., qui, très heureusement, sont encore des références vivantes pour nombre de personnes. Ce n’est pas, non plus, une raison pour le « fétichiser » et en faire un dogme à prendre en totalité.
A Solidaires, nous voulons faire ce pour quoi nous existons et nous nous sommes regroupés et constitués, faire du syndicalisme, faire du syndicalisme utile, utile pour les adhérentes et les adhérents, utile pour les salarié-e-s, les chômeurs et chômeuses, les retraité-e-s d’aujourd’hui, mais utile aussi pour demain, pour les générations suivantes, d’ici et d’ailleurs, utile pour le progrès social et humain. Nous pensons que pour conforter et pérenniser les acquis des travailleurs, il faut une transformation sociale conduisant à une répartition des pouvoirs n’en laissant plus la direction aux détenteurs du capital. Ce n’est ni ambitieux, ni prétentieux, ni démesuré, que de vouloir agir, en plus du syndicalisme du quotidien, pour une transformation sociale, alors que nous ne sommes même pas capables d’assurer la première besogne. Justement, cette ambition supplémentaire ne peut que donner du sens à nos luttes quotidiennes et une cohérence d’ensemble utile à un syndicalisme aujourd’hui particulièrement déboussolé.
I – Faire vivre un syndicalisme du quotidien qui s’inscrit dans un syndicalisme de transformation sociale, c’est déjà faire du syndicalisme de transformation sociale.
1 – La besogne quotidienne du syndicalisme.
Dès lors que la société continue d’être une société capitaliste d’exploitation et d’aliénation, le syndicalisme doit, dans l’urgence, œuvrer pour réduire cette exploitation capitaliste, c’est-à-dire agir pour « vendre plus cher » la force de travail. Il s’agit donc, tout à la fois, de revendiquer une réduction de la charge de travail, une réduction du temps de travail, une amélioration des conditions de travail, et d’agir dans le même temps pour une augmentation du « prix du travail », c’est-à-dire une augmentation des salaires, des prestations sociales diverses liées au travail, etc. C’est ce qui est parfois appelé la « première besogne du syndicalisme » : le syndicalisme de la vitre cassée, le syndicalisme de la feuille de paye, etc. Ces luttes peuvent être menées de façon sectorielle, fragmentée, entreprise par entreprise, au coup par coup. Elles peuvent également être menées de façon coordonnée par de larges secteurs économiques (la fonction publique, le commerce et la distribution, les transports, etc.), voire par l’ensemble des salariés (quand ce sont des organisations confédérées qui, par exemple, appellent à une grève générale). Il peut s’agir de luttes offensives : il s’agit d’obtenir des améliorations des conditions de travail ou d’emploi, des augmentations des salaires, des créations d’emplois, etc. Le plus souvent, et depuis de nombreuses années, les luttes, en France, quand elles ont lieu, sont des luttes défensives, le « dos au mur », pour s’opposer à une fermeture d’entreprise, à un plan de licenciement, à des suppressions d’emplois, à un blocage prolongé des salaires, à des réductions de salaires, à une contre réforme des retraites, etc.
2 – L’offensive continue des détenteurs de capitaux.
 L’organisation prolongée d’un chômage de masse améliore fortement la situation des détenteurs de capitaux dans leur rapport de force avec les salariés, et c’est cette situation qui permet, depuis un certain nombre d’années, d’accélérer les contre réformes, qualifiées « réformes structurelles », qui veulent pérenniser et marquer dans le marbre les avantages et privilèges des privilégiés. Depuis de nombreuses années, en France, et dans la plupart des pays, à commencer par les pays voisins en Europe, nous assistons à des attaques conjuguées des patrons, des chefs d’entreprises, poussés par les détenteurs de capitaux et les propriétaires des sociétés, et principalement des multinationales, qui veulent un rendement toujours plus important de leurs capitaux « investis », en liaison avec les détenteurs du pouvoir politique (les partis au gouvernement, avec le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et souvent le pouvoir judiciaire et le pouvoir répressif). Ces réformes structurelles, souvent impulsées de façon parallèle par les différents gouvernements par le truchement des « institutions européennes » en ce qui concerne l’Europe (Commission de Bruxelles, Parlement européen, BCE, Cour de Justice de l’Union européenne qui précise « le droit » de l’Union européenne, etc.), viennent réduire les droits des travailleurs, des chômeurs, des précaires, des retraités, mettent en cause les conventions collectives, inversent le système des « normes » en accélérant l’éclatement du salariat, attaquent le droit du Travail, etc. La liberté de circulation des capitaux, en Europe et dans le monde, sans harmonisation fiscale ni sociale, est un outil très efficace pour essayer de faire passer toutes les réformes régressives : le plus souvent, elles sont présentées comme devant rendre le pays plus compétitif et plus performant, … pour la croissance … et pour l’emploi ! En ce qui concerne la France, une partie de la cohérence d’ensemble des attaques dont les travailleurs sont victimes depuis plus de 30 ans, nous pouvons la trouver dans les propos tenus en octobre 2007 par Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF : « La liste des réformes ? C’est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance ! ».
L’organisation prolongée d’un chômage de masse améliore fortement la situation des détenteurs de capitaux dans leur rapport de force avec les salariés, et c’est cette situation qui permet, depuis un certain nombre d’années, d’accélérer les contre réformes, qualifiées « réformes structurelles », qui veulent pérenniser et marquer dans le marbre les avantages et privilèges des privilégiés. Depuis de nombreuses années, en France, et dans la plupart des pays, à commencer par les pays voisins en Europe, nous assistons à des attaques conjuguées des patrons, des chefs d’entreprises, poussés par les détenteurs de capitaux et les propriétaires des sociétés, et principalement des multinationales, qui veulent un rendement toujours plus important de leurs capitaux « investis », en liaison avec les détenteurs du pouvoir politique (les partis au gouvernement, avec le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et souvent le pouvoir judiciaire et le pouvoir répressif). Ces réformes structurelles, souvent impulsées de façon parallèle par les différents gouvernements par le truchement des « institutions européennes » en ce qui concerne l’Europe (Commission de Bruxelles, Parlement européen, BCE, Cour de Justice de l’Union européenne qui précise « le droit » de l’Union européenne, etc.), viennent réduire les droits des travailleurs, des chômeurs, des précaires, des retraités, mettent en cause les conventions collectives, inversent le système des « normes » en accélérant l’éclatement du salariat, attaquent le droit du Travail, etc. La liberté de circulation des capitaux, en Europe et dans le monde, sans harmonisation fiscale ni sociale, est un outil très efficace pour essayer de faire passer toutes les réformes régressives : le plus souvent, elles sont présentées comme devant rendre le pays plus compétitif et plus performant, … pour la croissance … et pour l’emploi ! En ce qui concerne la France, une partie de la cohérence d’ensemble des attaques dont les travailleurs sont victimes depuis plus de 30 ans, nous pouvons la trouver dans les propos tenus en octobre 2007 par Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF : « La liste des réformes ? C’est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance ! ».
Face à cette action coordonnée du pouvoir politique et du pouvoir économique, le premier au service du second, les organisations syndicales n’ont, jusqu’à présent, et depuis de nombreuses années, enregistré le plus souvent que des reculs. C’est même la somme de ces reculs accumulés et l’addition de ces échecs qui nous montrent aujourd’hui que notre environnement social et économique s’en est trouvé très largement modifié et dégradé. Depuis l’arrivée progressive de l’idéologie libérale rapidement concrétisée par la venue au pouvoir de Ronald Reagan aux Etats-Unis et de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, partout, dans tous les pays ou presque, des réformes ont été mises en place qui, à chaque fois, privilégiaient les privilégiés, accentuaient les inégalités au profit d’une minorité, affaiblissaient ce qu’il pouvait exister comme fonctionnement démocratique de certaines sociétés. Les attaques ont été menées « tous azimuts » : sur les conditions de travail et d’emploi, sur les salaires, sur les retraites, sur les services publics, sur les budgets publics et les budgets sociaux, sur les droits des travailleurs et les droits syndicaux, etc. Ceci s’est fait sans luttes armées ouvertes, sans coups d’Etat violents : des lois ont été votées, des traités internationaux ont été signés qui, à chaque fois, facilitaient l’exploitation capitaliste, par la libéralisation de la circulation des capitaux et par la mise en concurrence des travailleurs. Les accords de libre échange, qu’ils soient élaborés par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ou par des traités bilatéraux (Union européenne / Etats-Unis, par exemple) sont de plus en plus souvent le moyen d’enserrer des populations dans des limites très contraignantes : ils sont aujourd’hui un outil supplémentaire utilisé par les classes dominantes pour se prévenir de toute velléité de changement radical qui pourrait naître dans une population. Jean-Claude Juncker, au lendemain des élections législatives grecques de janvier 2015, exprimait sans fard la position des classes dominantes : « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ».
3 – La transformation sociale opérée au quotidien par les revanchards.
 De fait, une « transformation sociale » s’est opérée sous nos yeux, et continue de s’étendre et de s’approfondir. Ce que les capitalistes financiers dominants sont aujourd’hui capables de faire pour maintenir et conforter leurs avantages, nous commençons à nous en rendre compte très concrètement en Grèce par exemple. Au sein de l’Union européenne, les traités européens se révèlent être des outils très efficaces pour enfermer des expressions démocratiques. Mais l’enfermement démocratique se mettra aussi en place dans tout autre Etat où une majorité de la population exprimerait le choix de sortir d’une politique génératrice d’austérité et d’inégalités : cet Etat a très certainement signé des traités internationaux qui l’engagent vis-à-vis d’autres Etats et il est bien entendu lié par une multitude d’accords commerciaux et financiers qui deviendraient autant d’outils de contrainte à l’égard d’une population rebelle. Pendant le même temps, la classe dominante de cet Etat, plus directement menacée, aura le soutien des classes dominantes des autres Etats qui se ligueront pour éviter déjà que cette première résistance n’en amène d’autres. Nous devons bien intégrer l’idée que la lutte des classes, ce n’est pas qu’une construction théorique : quand ça devient sérieux, c’est un combat très concret. Les Révolutionnaires de 1789 ont dû combattre tous les tenants du maintien des privilèges. Ceux-ci se trouvaient à l’intérieur du pays. Bon nombre ont fui le pays mais ne sont pas restés passifs une fois émigrés, à Coblence ou ailleurs. Et ils ont vite eu l’appui de toutes les monarchies d’Europe, lesquelles se sont très souvent liguées contre les Révolutionnaires après l’exécution de Louis XVI. Les Grecs qui s’opposent aux politiques d’austérité ont vécu et vivent la même situation, avec leurs oppositions de l’intérieur, avec les manœuvres de tous les gouvernements de l’Union européenne, avec les agissements de toutes les institutions au service de la finance et avec les opérations menées par les banques et les principaux détenteurs de capitaux, à l’intérieur du pays comme à l’extérieur.
De fait, une « transformation sociale » s’est opérée sous nos yeux, et continue de s’étendre et de s’approfondir. Ce que les capitalistes financiers dominants sont aujourd’hui capables de faire pour maintenir et conforter leurs avantages, nous commençons à nous en rendre compte très concrètement en Grèce par exemple. Au sein de l’Union européenne, les traités européens se révèlent être des outils très efficaces pour enfermer des expressions démocratiques. Mais l’enfermement démocratique se mettra aussi en place dans tout autre Etat où une majorité de la population exprimerait le choix de sortir d’une politique génératrice d’austérité et d’inégalités : cet Etat a très certainement signé des traités internationaux qui l’engagent vis-à-vis d’autres Etats et il est bien entendu lié par une multitude d’accords commerciaux et financiers qui deviendraient autant d’outils de contrainte à l’égard d’une population rebelle. Pendant le même temps, la classe dominante de cet Etat, plus directement menacée, aura le soutien des classes dominantes des autres Etats qui se ligueront pour éviter déjà que cette première résistance n’en amène d’autres. Nous devons bien intégrer l’idée que la lutte des classes, ce n’est pas qu’une construction théorique : quand ça devient sérieux, c’est un combat très concret. Les Révolutionnaires de 1789 ont dû combattre tous les tenants du maintien des privilèges. Ceux-ci se trouvaient à l’intérieur du pays. Bon nombre ont fui le pays mais ne sont pas restés passifs une fois émigrés, à Coblence ou ailleurs. Et ils ont vite eu l’appui de toutes les monarchies d’Europe, lesquelles se sont très souvent liguées contre les Révolutionnaires après l’exécution de Louis XVI. Les Grecs qui s’opposent aux politiques d’austérité ont vécu et vivent la même situation, avec leurs oppositions de l’intérieur, avec les manœuvres de tous les gouvernements de l’Union européenne, avec les agissements de toutes les institutions au service de la finance et avec les opérations menées par les banques et les principaux détenteurs de capitaux, à l’intérieur du pays comme à l’extérieur.
4 – Commencer à inverser le rapport de forces par notre syndicalisme au quotidien.
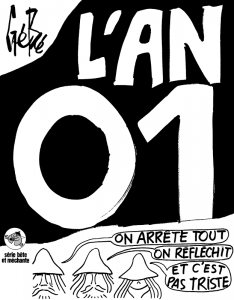 La stratégie menée avec constance par les classes dominantes depuis des décennies nous montre donc que leurs petites victoires ajoutées peuvent conduire à des transformations profondes. Ceci devrait convaincre le mouvement syndical, à l’inverse, que de petites victoires dans des luttes quotidiennes pourraient participer au changement de notre environnement, par l’amélioration des conditions de travail et l’amélioration des conditions de vie. Ainsi, il est certain que le syndicalisme du quotidien, celui de la feuille de paye, celui des conditions de travail, peut déjà concourir au changement social, sans pour autant participer totalement à la « transformation sociale ». En ce sens, la lutte au quotidien qu’il faut certainement prioritairement mener est celle conduisant à une diminution forte du chômage et à un plein emploi pour toutes et tous. La lutte pour la réduction du temps de travail devrait donc être une lutte prioritaire : il s’agit de travailler moins pour travailler tous et toutes ; il s’agit de lier le temps de travail aux gains de productivité et aux besoins économiques et sociaux des populations. Dès lors que le poids du chômage et le poids de sa menace auront disparu de l’horizon du plus grand nombre, d’autres luttes, et des luttes gagnantes, deviendront possibles, notamment celles pour une amélioration des salaires et des protections sociales. Ceux d’en face ont bien compris que l’organisation de la rareté de « l’emploi salarié » par rapport à sa demande ne pouvait que tirer la rémunération du travail vers le bas dans notre système économique. Les attaques de plus en plus fortes menées contre ce qu’il reste de droit du Travail et de protection des salariés dans leurs relations « contractuelles » avec les employeurs confirment que le capital, par le truchement des employeurs, cherche bien à conforter ses avantages dans ses rapports de force avec le salariat. Pendant le même temps, la mise en concurrence accrue des salariés et des salariats par la libéralisation totale de la circulation des capitaux sur la planète, affaiblit encore les salariés dans leurs luttes contre les employeurs. Pour de nombreuses raisons, et particulièrement pour des raisons tenant à la nature de l’être humain, il est certain, en effet, que la mobilité du travail sera toujours inférieure à la mobilité du capital. L’Union européenne libéralisée est aujourd’hui un outil supplémentaire pour organiser cette concurrence entre les travailleurs. Demain, avec les idées qui commencent à être présentées de SMIC différents selon les régions à l’intérieur du territoire national, ce seront des « accords entre partenaires sociaux » qui seront proposés, région par région, et qui mettront en concurrence les salariés de Bretagne et ceux de Nord-Pas-de-Calais / Picardie, par exemple. Des luttes doivent donc être menées pour tenter de réduire la mobilité, la fluidité et la volatilité des capitaux. Ainsi, la mise en concurrence des mains d’œuvre et des salariés par le dumping social et le dumping fiscal, par leur confrontation par les « coûts », serait rendue plus difficile.
La stratégie menée avec constance par les classes dominantes depuis des décennies nous montre donc que leurs petites victoires ajoutées peuvent conduire à des transformations profondes. Ceci devrait convaincre le mouvement syndical, à l’inverse, que de petites victoires dans des luttes quotidiennes pourraient participer au changement de notre environnement, par l’amélioration des conditions de travail et l’amélioration des conditions de vie. Ainsi, il est certain que le syndicalisme du quotidien, celui de la feuille de paye, celui des conditions de travail, peut déjà concourir au changement social, sans pour autant participer totalement à la « transformation sociale ». En ce sens, la lutte au quotidien qu’il faut certainement prioritairement mener est celle conduisant à une diminution forte du chômage et à un plein emploi pour toutes et tous. La lutte pour la réduction du temps de travail devrait donc être une lutte prioritaire : il s’agit de travailler moins pour travailler tous et toutes ; il s’agit de lier le temps de travail aux gains de productivité et aux besoins économiques et sociaux des populations. Dès lors que le poids du chômage et le poids de sa menace auront disparu de l’horizon du plus grand nombre, d’autres luttes, et des luttes gagnantes, deviendront possibles, notamment celles pour une amélioration des salaires et des protections sociales. Ceux d’en face ont bien compris que l’organisation de la rareté de « l’emploi salarié » par rapport à sa demande ne pouvait que tirer la rémunération du travail vers le bas dans notre système économique. Les attaques de plus en plus fortes menées contre ce qu’il reste de droit du Travail et de protection des salariés dans leurs relations « contractuelles » avec les employeurs confirment que le capital, par le truchement des employeurs, cherche bien à conforter ses avantages dans ses rapports de force avec le salariat. Pendant le même temps, la mise en concurrence accrue des salariés et des salariats par la libéralisation totale de la circulation des capitaux sur la planète, affaiblit encore les salariés dans leurs luttes contre les employeurs. Pour de nombreuses raisons, et particulièrement pour des raisons tenant à la nature de l’être humain, il est certain, en effet, que la mobilité du travail sera toujours inférieure à la mobilité du capital. L’Union européenne libéralisée est aujourd’hui un outil supplémentaire pour organiser cette concurrence entre les travailleurs. Demain, avec les idées qui commencent à être présentées de SMIC différents selon les régions à l’intérieur du territoire national, ce seront des « accords entre partenaires sociaux » qui seront proposés, région par région, et qui mettront en concurrence les salariés de Bretagne et ceux de Nord-Pas-de-Calais / Picardie, par exemple. Des luttes doivent donc être menées pour tenter de réduire la mobilité, la fluidité et la volatilité des capitaux. Ainsi, la mise en concurrence des mains d’œuvre et des salariés par le dumping social et le dumping fiscal, par leur confrontation par les « coûts », serait rendue plus difficile.
5 – Pour un syndicalisme au quotidien qui engrange des résultats.
Pour notre Union syndicale Solidaires, à ce stade, nous avons déjà plusieurs obligations à satisfaire, et que nous sommes très loin de remplir aujourd’hui, en 2015 : mener des actions revendicatives, mener des actions revendicatives victorieuses, et engranger des victoires sociales qui aillent dans le sens de la transformation sociale que nous souhaitons et préconisons. Parvenir à cette première étape pose déjà une multitude de questions : convaincre un nombre significatif de salarié-e-s de l’utilité de l’action et de la lutte, augmenter très sensiblement nos capacités de mobilisation (nombre d’adhérents, nombre de secteurs, de branches et d’entreprises dans lesquels nous existons réellement, nombre de localités dans lesquelles nous sommes effectivement présents, etc.). Pendant un certain nombre d’années encore, nous aurons l’obligation de « composer » avec d’autres organisations syndicales, si nous escomptons peser efficacement dans le rapport de forces. Ce qui nous oblige à agir avec d’autres organisations syndicales, organisations syndicales dont nous ne partageons pas toutes les positions ni toutes les pratiques, sinon nous serions déjà réunifiées. Il nous faut donc savoir agir efficacement avec d’autres. Ceci nécessite encore de réaliser pas mal de prouesses.
Ces conditions remplies, nous aurons encore à donner une cohérence à nos revendications et à nos mobilisations et actions. Force est de reconnaître que le mouvement syndical baigne souvent dans de grandes contradictions, y compris notre union syndicale Solidaires. Ainsi, lorsque nous défendons des emplois existants, lorsque nous nous opposons à des fermetures d’entreprises, à des cessations d’activités, etc., il nous arrive de mettre entre parenthèses les critiques que parfois nous formulons à l’égard de ces activités (polluantes, nuisibles, néfastes pour la santé des travailleurs et des travailleuses, nuisibles pour la santé des personnes vivant à proximité, nuisibles pour la santé des usagers, des consommateurs, des clientes et des clients, etc.).
II – Imaginer collectivement la transformation sociale et élaborer des revendications pouvant y conduire.
1 – L’émancipation intégrale des travailleurs.
La Charte d’Amiens de 1906 fixe l’objectif de la transformation sociale : il s’agit de la disparition du salariat et du patronat. Cet objectif final annoncé part du constat que le travailleur salarié est tout à la fois aliéné et exploité, qu’il est exproprié par les détenteurs du capital d’une partie des richesses qu’il a créées. Pour les congressistes de 1906, « l’émancipation intégrale (…) ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste ». Souhaiter la disparition du salariat et du patronat, c’est dire notamment que le salariat n’est pas la « finitude » de l’humanité, comme ne l’étaient, auparavant, ni l’esclavage, ni le servage.
Pour notre Union syndicale Solidaires, quand nous nous affirmons « syndicalisme de transformation sociale », il est nécessaire que nous précisions ce que nous mettons derrière ce drapeau. Si notre ambition finale est bien « l’émancipation intégrale », il nous faut non seulement se le dire entre nous, il faut aussi débattre collectivement pour voir tout ce que ceci implique. Les congressistes de 1906 déclaraient que ceci ne peut se faire que par « l’expropriation capitaliste ». Très concrètement, ceci signifie certainement qu’il faut mettre en cause le droit de propriété actuel, droit qui, de plus en plus, surplombe tous les autres.
2 – Un droit de propriété expansionniste.
 Les trois valeurs retenues en France à partir de la Révolution de 1789, et particulièrement de la Déclaration des Droits du 26 août 1789, et qui ont été actées par la Troisième République, sont celles de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Ce sont elles qui figurent sur les frontons des édifices publics. Pour être plus complet, et pour traduire la réalité de notre système politique, il aurait été plus exact, et plus « honnête », d’ajouter à ces trois valeurs la « propriété ». La « Propriété » est un des droits revendiqués prioritairement par les rédacteurs de la Déclaration des Droits. Dès l’article II il est écrit : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
Les trois valeurs retenues en France à partir de la Révolution de 1789, et particulièrement de la Déclaration des Droits du 26 août 1789, et qui ont été actées par la Troisième République, sont celles de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Ce sont elles qui figurent sur les frontons des édifices publics. Pour être plus complet, et pour traduire la réalité de notre système politique, il aurait été plus exact, et plus « honnête », d’ajouter à ces trois valeurs la « propriété ». La « Propriété » est un des droits revendiqués prioritairement par les rédacteurs de la Déclaration des Droits. Dès l’article II il est écrit : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
Nous savons, par expérience, et par les leçons de l’Histoire, qu’une société « humaine » est le résultat de compromis et d’équilibres, difficiles à déterminer, variables dans le temps et dans l’espace, entre des aspirations individuelles et des aspirations collectives. C’est le débat démocratique et la confrontation qui devraient décider, par exemple, des équilibres à trouver entre liberté et égalité. Et l’Histoire nous montre également que lorsque c’est le droit de propriété qui est surdéterminant, tous les autres droits sont mis en cause, attaqués, menacés, et certains voués à disparaître. C’est un peu la période que nous vivons depuis le développement de l’idéologie libérale et sa mise en application commencée avec Reagan et Thatcher qui ont fait évoluer les régimes successifs du capitalisme.
Au départ, l’entrepreneur, c’’est celui qui est propriétaire des capitaux. Au nom de cette propriété privée, il dispose du droit de diriger « son » entreprise. Puis apparaissent des entreprises plus importantes créées sous la forme de sociétés de capitaux regroupant des fonds appartenant à plusieurs personnes. Les grandes entreprises seront des sociétés de capitaux apportés par un grand nombre d’actionnaires. A ce niveau, apparaît une dissociation entre les détenteurs de titres de propriété de la société anonyme et ses dirigeants, les « manageurs ». Le régime du capitalisme managérial a laissé une grande latitude aux dirigeants, notamment par rapport aux petits actionnaires dispersés. La financiarisation de l’économie à partir des années 1970, se traduisant notamment par l’arrivée grandissante des « investisseurs institutionnels » sur les marchés financiers, a conduit à un contrôle plus strict des dirigeants, de leur activité et de leurs résultats. Le gouvernement d’entreprise (corporate governance) consacre le pouvoir de l’actionnaire, au nom de son droit de propriété. L’actionnaire est présenté comme le seul à supporter le risque financier, et, selon le postulat du capitalisme financier, les actionnaires, et eux seuls, sont pleinement légitimes pour définir les objectifs de l’entreprise ; dans ce cadre, les dirigeants ont pour fonction de maximiser le profit des actionnaires.
Cette évolution s’est faite en liaison avec une libéralisation des capitaux sur la planète : ils peuvent circuler et s’investir partout, sans limites ni contrôles. L’absence voulue d’harmonisation des législations, sociales et fiscales particulièrement, va conduire à une confrontation plus brutale, et généralisée, des apporteurs de travail face aux détenteurs de capitaux. Les gains vont se faire en grande partie par un taux d’exploitation plus fort des apporteurs de travail. La mise en concurrence des territoires et des Etats va se traduire par une course au moins disant social (réduire le coût du travail pour le capital) et par des systèmes fiscaux au service du capital (réduction de la taxation des profits, des patrimoines, des hauts revenus qui participent à l’accumulation et à la concentration du capital, etc.).
La période actuelle se caractérise notamment par un renforcement du droit de propriété dans l’entreprise. Les détenteurs de capitaux s’autorisent de plus en plus d’avantages et de privilèges qui renforcent le contenu et les conséquences de leur « droit de propriété ». A terme, l’entreprise doit devenir le domaine privé des propriétaires qui seraient libres d’y agir sans contrôles. Les interventions de Vincent Bolloré, l’actionnaire principal de Canal +, au cours de l’été 2015, dans le fonctionnement de cette entreprise, illustrent assez bien ce que peut signifier le « droit de propriété ». Le propriétaire a droit de vie et de mort sur « son » entreprise, il peut y pratiquer l’arbitraire le plus absolu, « car tel est son bon plaisir ». De plus en plus, les principaux détenteurs de capitaux ne souffrent plus d’être limités et contraints par une quelconque législation. Dans l’entreprise, le recul de l’Inspection du Travail, le recul des contrôles fiscaux et douaniers, le recul des interventions des services de la Concurrence et de la Consommation devraient être complétés par un effacement progressif du Droit du Travail au motif que l’entrepreneur doit être maître chez lui et qu’il est le seul à savoir ce qui est bon pour l’entreprise. C’est, en effet, le droit du Travail qui agit sur la relation primaire du capitalisme, sur le lieu de travail, là où s’organise l’exploitation du travailleur salarié. Le droit du Travail est l’un des premiers endroits de la confrontation des classes sociales. Aujourd’hui, les détenteurs de capitaux souhaitent profiter d’un rapport de forces favorable pour conquérir de nouveaux terrains.
Ce pouvoir du capital dans l’entreprise déborde dans toute la société et sur toute la planète. Tout ou presque devient marchandise. L’endettement public organisé (par une sous taxation des profits et une fraude à très grande échelle des multinationales par les paradis fiscaux, etc.) conduit à la vente progressive de biens publics achetés par des détenteurs de capitaux privés : privatisations, ventes de ports, d’aéroports, de services publics, de biens domaniaux et patrimoniaux, etc. A terme, avec les difficultés faites à l’investissement public, une part grandissante des biens existants sur la planète sera la propriété d’investisseurs privés.
3 – Circonscrire le droit de propriété.
Le droit de propriété actuel tel qu’il est reconnu et établi à l’égard des moyens de production conduit à des excès intolérables. Ceci a très directement des conséquences sur les conditions de travail, d’emploi, de vie, des salariés. Ceci concerne donc très directement le syndicalisme. Il nous faut donc réfléchir à un autre « gouvernement » des entreprises. Nous savons que les « nationalisations » passées n’ont pas été des modèles de démocratie, et que ces entreprises « nationalisées » n’ont pas toujours su concilier l’intérêt des travailleurs, des usagers, des fournisseurs, des créanciers, des contribuables, des territoires. Il s’agit d’imaginer un autre « droit de propriété » des entreprises et des moyens de production. Il est probable qu’il faudrait constituer deux niveaux de gestion, un premier niveau regroupant les apporteurs de capital et les apporteurs de travail, et un deuxième niveau qui serait élargi à toutes celles et à tous ceux qui sont concernés par les décisions de l’entreprise (encore les salariés et les employeurs, mais aussi les fournisseurs, les créanciers, l’Etat, les collectivités territoriales, etc.). Ceci devrait au moins conduire à la constitution de conseils de surveillance ou d’administration ouverts à toutes les parties prenantes.
En ce qui concerne les salariés, celles et ceux qui apportent leur travail, lequel est exploité par les détenteurs de capitaux, il convient certainement de faire cesser le privilège des capitalistes. En effet, dans le système capitaliste, la totalité du capital accumulé appartient aux actionnaires, alors que cette accumulation est le résultat de la combinaison du capital et du travail. A l’instar de la nuit du 4 aout 1789 où ont été abolis certains privilèges féodaux, il faut abolir le privilège fondateur du capitalisme et du salariat, le privilège qui octroie au capital seul la propriété de la totalité des moyens de production nouveaux créés par autofinancement, alors qu’ils sont le résultat de l’activité de l’entreprise quand, chaque année, les fonds propres augmentent par incorporation des bénéfices non distribués. Par ce biais, progressivement, les salariés deviendraient des travailleurs associés. En 1898, dans Socialisme et Liberté, Jean Jaurès écrivait : « En fait, il n’y a qu’un moyen pour tous les citoyens, pour tous les producteurs, d’échapper au salariat : c’est d’être admis, par une transformation sociale, à la copropriété des moyens de production ».
4 – Agir contre l’accumulation capitaliste.
 Agir contre l’accumulation capitaliste devient donc une orientation de l’organisation syndicale. Ceci commence par l’action quotidienne : vendre plus cher la force de travail, agir pour une augmentation des salaires, une réduction de la charge de travail et du temps de travail. Ceci conduit à revendiquer une augmentation de la contribution des entreprises aux dépenses sociales et budgétaires. Il convient d’aller vers un système fiscal qui ne favorise pas l’accumulation capitaliste par le jeu des amortissements du capital en déduction des bénéfices. La fiscalité doit mieux imposer les profits et les rentes : aujourd’hui, la fiscalité assise sur les revenus de la rente facilite l’accroissement du capital des rentiers et conduit à une concentration toujours plus grande des revenus et des patrimoines dans les mains d’une minorité. La « liberté » est celle laissée aux plus gros d’acheter les plus petits.
Agir contre l’accumulation capitaliste devient donc une orientation de l’organisation syndicale. Ceci commence par l’action quotidienne : vendre plus cher la force de travail, agir pour une augmentation des salaires, une réduction de la charge de travail et du temps de travail. Ceci conduit à revendiquer une augmentation de la contribution des entreprises aux dépenses sociales et budgétaires. Il convient d’aller vers un système fiscal qui ne favorise pas l’accumulation capitaliste par le jeu des amortissements du capital en déduction des bénéfices. La fiscalité doit mieux imposer les profits et les rentes : aujourd’hui, la fiscalité assise sur les revenus de la rente facilite l’accroissement du capital des rentiers et conduit à une concentration toujours plus grande des revenus et des patrimoines dans les mains d’une minorité. La « liberté » est celle laissée aux plus gros d’acheter les plus petits.
Agir contre l’accumulation capitaliste, c’est aussi freiner l’expansion de la finance à l’ensemble de la société et à l’ensemble de la planète. C’est s’opposer à toutes les manœuvres qui voudraient que le plus grand nombre de travailleurs soient intéressés à la réussite d’un système qui les exploite. C’est, par exemple, l’un des buts des fonds de pension qui veulent remplacer un système de retraite par répartition par un système basé sur la capitalisation.
5 – Réduire les droits liés au droit de propriété, dans l’entreprise et dans la société et, corrélativement, accroître les droits des travailleurs, dans l’entreprise et dans la société.
Là aussi, l’action syndicale commence dans l’activité quotidienne du syndicat, sur le lieu de travail, dans l’entreprise, et dans un rapport de forces pour faire reconnaître des droits aux collectifs de travail dans les entreprises. Le renforcement des CHS-CT, les droits et pouvoirs des élus DP et CE participent de cette installation de « coins démocratiques » dans les entreprises. Le statut de certaines sociétés de l’économie sociale et solidaire peut parfois être déjà un élément d’atténuation de la pression du capital à l’égard du travail. Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) instituées par une loi de juillet 2001 prévoient ainsi différentes catégories d’associés. Il s’agit donc de pouvoir agir notamment sur l’organisation du travail. L’élargissement de l’intervention des travailleurs devrait ensuite aller vers une reconnaissance du droit au collectif de travail de débattre de ce qui est produit par l’entreprise, de comment on le produit, de la finalité sociale de la production, etc. Le collectif de travail pourrait avoir un droit de véto sur certaines décisions.
Dans la société, tout ce qui pourrait réduire les pouvoirs de la finance et du capital doit figurer dans le cahier revendicatif de l’organisation syndicale. Ceci peut couvrir une multitude de domaines : la séparation entre les banques de dépôts et les banques d’affaires, la limitation du lobbying, la vigilance par rapport à la corruption, la protection des lanceurs d’alerte, le suivi des conflits d’intérêts, etc.
III – Mettre en pratique des parcelles de transformation sociale.
1 – Affrontement.
 En France, une partie du mouvement syndical porte encore l’idée que les travailleurs n’obtiendront la satisfaction de leurs revendications que par la lutte et que, de ce fait, ils ne peuvent compter que sur eux mêmes. A Solidaires, nous sommes de ce côté. Mais nous savons qu’il y a des regroupements, qui s’appellent et qui sont appelés « syndicats », et qui ne prônent que la discussion et le dialogue avec le « partenaire » patronal, sans installation d’un quelconque rapport de forces pour essayer d’influer sur la décision du « partenaire ». A Solidaires, nous ne comptons pas que sur la pertinence de nos démonstrations et de nos argumentaires, ni sur l’humanité et le sens de la justice du patronat ou d’un gouvernement et de ses représentants hiérarchiques, pour voir satisfaites nos revendications.
En France, une partie du mouvement syndical porte encore l’idée que les travailleurs n’obtiendront la satisfaction de leurs revendications que par la lutte et que, de ce fait, ils ne peuvent compter que sur eux mêmes. A Solidaires, nous sommes de ce côté. Mais nous savons qu’il y a des regroupements, qui s’appellent et qui sont appelés « syndicats », et qui ne prônent que la discussion et le dialogue avec le « partenaire » patronal, sans installation d’un quelconque rapport de forces pour essayer d’influer sur la décision du « partenaire ». A Solidaires, nous ne comptons pas que sur la pertinence de nos démonstrations et de nos argumentaires, ni sur l’humanité et le sens de la justice du patronat ou d’un gouvernement et de ses représentants hiérarchiques, pour voir satisfaites nos revendications.
Dans nos réunions militantes, dans les assemblées générales et les Congrès, bien souvent les débats débouchent sur la question des mobilisations nécessaires et des moyens d’action. Et nous savons qu’il y a toute une « gradation », le summum étant généralement la « grève ! », la « grève générale ! », et surtout la « grève générale interprofessionnelle reconductible ! ». Les congressistes de 1906 préconisaient « comme moyen d’action la grève générale ». Depuis de nombreuses années, nous continuons de porter ces appels, très souvent sans être entendus, y compris par bon nombre des adhérentes et adhérents des fédérations et syndicats membres de Solidaires. Un tel affrontement, pour avoir quelques chances d’aboutir, nécessite forcément le nombre, et pas seulement la détermination extrême de quelques individus. Il faut donc en passer par des appels avec d’autres organisations syndicales, ce qui nous met à la merci de leur lâchage en rase campagne, quand il s’agira, par exemple, de proposer la reconduction de la grève de jour en jour. A défaut de mieux, nous continuons d’appeler à des grèves de « 24 heures sèches », en proclamant qu’elles seront avec des lendemains et des suites, lesquelles se font toujours attendre. Et quand il y a effectivement appel à la grève, quand, dans quelques secteurs, il s’agit même de grève reconductible, très souvent le résultat obtenu par la lutte n’est pas du tout à la hauteur de l’engagement, de l’enthousiasme, et des sacrifices des grévistes. Les obstacles sont multiples : crainte des mesures de rétorsion du patron dans un environnement fait de 5 millions de chômeurs, crainte des difficultés financières dans un contexte de fins de mois déjà difficiles, sentiment que la lutte sectorielle menée ne suffira pas et que son élargissement est une opération irréalisable. Pendant le même temps, ceux d’en face ne restent pas inactifs : laisser « pourrir » la grève, en jouant sur le temps (qui coûte cher pour les grévistes) : ne pas « négocier », laisser les grévistes dans le vide (pas d‘interlocuteurs privés et publics, pas d’échos dans la presse, etc.). Et, à un certain moment, engager la répression : déchaînement des discours et des médias contre les grévistes, sanctions à l’égard des « meneurs », envoi des forces de police, etc.
L’affrontement est d’autant plus difficile que, de plus en plus souvent, dans un capitalisme largement mondialisé où l’Etat-nation s’intègre progressivement à un Etat Transnational, le décideur semble de plus en plus éloigné. Le patron de l’entreprise locale dépend d’une décision d’une multinationale, le gouvernement de tel Etat nation est lié par des accords internationaux qui « l’obligent » et l’enserrent dans un réseau global, étape d’une nouvelle organisation de la planète. Les prolétaires de tous les pays sont très loin d’être tous unis. Le capitalisme hégémonique peut plus facilement assurer sa domination sur les classes subalternes : les Grecs vivent très brutalement cette situation. Tout ceci rend l’affrontement compliqué, car le système dominant dispose non seulement des moyens d’aliénation et de répression, il est organisé pour avoir de plus en plus de moyens d’esquiver et d’échapper à l’affrontement.
2 – Contournement.
L’affrontement avec le patron, avec l’employeur, c’est toujours, plus ou moins, même si les participantes et les participants à la grève n’en ont pas conscience, un affrontement avec le système social existant. L’expérience que nous pouvons avoir des luttes passées, y compris des luttes qui, sur le moment, ont été victorieuses, est bien que rien n’est jamais acquis, qu’aucune victoire n’est définitive. Aujourd’hui, les salarié-e-s ont retrouvé leur travail, aujourd’hui un « repreneur » a racheté l’entreprise (et a acheté les travailleurs en même temps), mais demain l’entreprise sera délocalisée, ou le patron aura demandé aux salariés de travailler plus, pour le même salaire, voire pour un salaire réduit. Aujourd’hui la multinationale ne ferme pas son usine en Bretagne, après la grève menée, mais celle de Bordeaux sera fermée, ou celle de Madrid, ou de Casablanca. Même des victoires, même de telles victoires, nous confortent dans la nécessité de faire vivre un syndicalisme de transformation sociale. Pour autant, aucune lutte n’est inutile. Les échecs, plus nombreux que les victoires depuis beaucoup trop d’années, sont, au moins, un apprentissage de l’action, un moyen de conscientisation pour certaines et certains camarades, etc.
L’affrontement avec le système social a pour objectif de faire reculer le système pour faire naître de nouveaux droits, de nouveaux pouvoirs pour les travailleurs, et ceci jusqu’à un renversement de ce système. Nous constatons tous les jours que c’est une œuvre de longue haleine, de très longue haleine même, et qui a désespéré bien au-delà de Billancourt ! Parallèlement à la poursuite du développement de ces pratiques et de ces luttes, notre volonté de transformation sociale devrait certainement nous conduire à mener des actions de contournement du système. Il ne s’agirait plus seulement de dénoncer un système, de s ‘y opposer, mais de tenter de faire vivre, à côté, un autre système.
 Ainsi, nous pouvons continuer de dénoncer les OGM, de faire des manifestations contre Monsanto, le Roundup, les pesticides toxiques, contre un modèle agricole accro à la chimie et aux manipulations du vivant, productiviste et destructeur. Mais nous pouvons aussi participer au développement d’une agriculture respectueuse de la vie et de la santé des producteurs comme des consommateurs, réduisant les pollutions par le choix des circuits courts, etc. Ceci devrait concrètement signifier que l’organisation syndicale soit capable de lancer des appels à consommer autrement, et pas seulement des « appels à la manif ». Ceci impliquerait que l’organisation syndicale, directement, considère que les actes de consommation de ses membres sont aussi des moyens d’action et des moyens de lutte collective. Nos actions intersyndicales ne seraient plus seulement des regroupements avec d’autres salariés pour s’opposer à une politique patronale et/ou gouvernementale. Elles seraient aussi des mobilisations et des actions menées avec d’autres partenaires, et sur d’autres terrains, un terrain où le syndicalisme n’est pas attendu.
Ainsi, nous pouvons continuer de dénoncer les OGM, de faire des manifestations contre Monsanto, le Roundup, les pesticides toxiques, contre un modèle agricole accro à la chimie et aux manipulations du vivant, productiviste et destructeur. Mais nous pouvons aussi participer au développement d’une agriculture respectueuse de la vie et de la santé des producteurs comme des consommateurs, réduisant les pollutions par le choix des circuits courts, etc. Ceci devrait concrètement signifier que l’organisation syndicale soit capable de lancer des appels à consommer autrement, et pas seulement des « appels à la manif ». Ceci impliquerait que l’organisation syndicale, directement, considère que les actes de consommation de ses membres sont aussi des moyens d’action et des moyens de lutte collective. Nos actions intersyndicales ne seraient plus seulement des regroupements avec d’autres salariés pour s’opposer à une politique patronale et/ou gouvernementale. Elles seraient aussi des mobilisations et des actions menées avec d’autres partenaires, et sur d’autres terrains, un terrain où le syndicalisme n’est pas attendu.
Si nous nous engageons dans cette construction d’un espace décalé par rapport au système social dominant, au fur et à mesure que nous avancerons nous découvrirons certainement que nous pourrons en élargir et en approfondir le contenu. Ainsi, nous pouvons dénoncer la pensée unique qui suinte des médias « de masse », zapper chaque fois que sur le petit écran défile un « expert » au service du système, manifester contre la privatisation de tel ou tel service de l’audiovisuel public, pétitionner contre la mainmise des dirigeants de multinationales sur la plupart des secteurs de la presse écrite, radiophonique, télévisée. Et, pendant le même temps, nous pouvons faire vivre notre propre espace public, éventuellement partagé avec d’autres portant les mêmes valeurs et les mêmes objectifs de transformation sociale. Nous pouvons construire notre propre lieu d’information et d’échange en utilisant Internet et les réseaux sociaux.
Dans de multiples domaines, il est possible de faire vivre d’autres relations sociales et humaines. : dans l’économie sociale et solidaire, la culture, l’agriculture, la citoyenneté urbaine, les solidarités rurales, les sciences, le transfert de savoirs, les médecines, l’éducation, le sport, etc. L’ensemble de ces pratiques devrait donner naissance à un « début d’autre monde », à côté du monde dominant. Dans le même moment, nous aurions un monde, le monde « ancien », qui continue de vivre et de nuire, et un monde naissant qui devrait traduire nos aspirations par de nouvelles pratiques. C’est un peu ce que Antonio Negri et Michael Hardt appellent des « communs », qui sont à la fois des « biens communs » mais aussi des « pratiques de la communauté ». Par cette démarche, les travailleurs pourraient « grignoter » plus ou moins régulièrement de nouveaux espaces de liberté et d’autonomie. La critique du capitalisme induirait ainsi un comportement citoyen, et ceci devrait être considéré comme de l’action syndicale participant à la transformation sociale.
3 – Du « micro » au « macro ».
Ici, nous retrouvons un peu l’idée d’une réflexion et d’une action allant du local au global, mêlant le micro et le macro. Nous savons que la démocratie ne s’importe pas de l’extérieur, dans aucune société, dans aucun Etat, mais qu’elle peut se créer ou se recréer à partir d’actes de citoyenneté, qui peuvent être considérés comme des actes de résistance. Ce sont ces nouveaux comportements, additionnés par chacun et chacune d’entre nous tout au long de nos jours et de nos semaines, et s’agglomérant avec ceux d’autres « résistants » qui préfigureraient le monde nouveau en train de se faire. Ces actes de résistance iraient au-delà des actes de désobéissances. Il est probable qu’une telle pratique syndicale serait un élément de crédibilisation de nos discours syndicaux : notre « faire » donnerait sens à notre « dire ». Une telle pratique serait donc un élément de crédibilisation aux yeux des salariés qui nous entourent et qui entendent nos discours, lisent nos écrits, voient nos comportements. Elle serait aussi un moyen de « tester » nos alternatives envisagées. Nous savons que c’est en faisant que nous nous faisons, et que c’est ensemble que nous inventerons un autre monde. Il n’est pas possible que nos pratiques d’aujourd’hui soient contraires à nos discours et aux aspirations que nous formulons. Gandhi nous conseille : « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Il est impossible qu’une transformation démocratique d’une société ou d’un système économique se fasse par des moyens ou des procédures eux-mêmes non-démocratiques. Notre union syndicale ne peut prétendre démocratiser la société que si nous sommes, nous mêmes, plus démocratiques que le système auquel nous nous opposons, tant dans nos objectifs que dans notre fonctionnement interne. Nos luttes pour une transformation sociale doivent être en même temps des luttes pour élargir les espaces de liberté, de justice, d’égalité. Il ne s’agit pas seulement de renverser un rapport de forces externes, il faut aussi avoir la capacité intérieure de se libérer des entraves du système et de préfigurer entre nous des relations que nous prétendons proposer à l’ensemble de la société.
L’action syndicale prend alors une nouvelle dimension. Il ne suffit pas de s’opposer à des adversaires, et d’inverser en notre faveur collective le rapport de forces, il nous faut aussi surmonter des difficultés subjectives, celles qui partent de la réalité, complexe, des hommes et des femmes. L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. Il s’agit donc que chacune et chacun sorte de la « servitude volontaire » dont La Boétie nous a rappelé, il y a plus de 450 ans, qu’elle était la matrice de nos asservissements : « Soyez résolus à ne plus servir, et vous serez libres ». Cette conquête d’espaces libérés, libérés par l’action syndicale collective tournée vers la transformation sociale, serait une conquête de droits nouveaux participant à l’émancipation collective.
Conclusion : tout ceci, c’est du syndicalisme.
A Solidaires, notre volonté de faire du syndicalisme doit signifier que nous voulons faire aboutir nos revendications. Nous avons à « défendre les intérêts matériels et moraux de nos membres ». La défense des intérêts matériels, ça commence notamment par la défense des salaires et du pouvoir d’achat. Dans une société capitaliste, ceci doit amener le mouvement syndical à contester un système juridique et global qui permet que les travailleurs soient exclus d’une partie des richesses qu’ils ont contribué à créer. Ca veut bien dire que la réflexion sur le droit de propriété dans l’entreprise est du ressort du mouvement syndical, de même que celle sur la démocratie dans l’entreprise. Cette « besogne », nous devons la mener en toute indépendance, notamment en toute indépendance par rapport aux partis politiques, aux appareils politiques. Nous savons que ceci implique que nous soyons nous mêmes très « politiques », c’est-à-dire que nous débattions entre nous, à l’intérieur de l’organisation syndicale, et démocratiquement, de toutes les questions auxquelles nous sommes confrontées.
Gérard Gourguechon – 23 octobre 2015
- Droits de l’enfant - 17 juin 2021
- Réformes des retraites et lutte des classes - 7 juillet 2020
- Construisons une sécurité sociale du XXIe siècle - 10 juin 2020



