Mai 1981, la gauche au pouvoir et le syndicalisme qui assiste ou regarde
Étant à l’époque permanent du Syndicat national unifié des impôts -SNUI- depuis février 1974 et secrétaire général depuis octobre 1980, j’ai traversé cette période de l’après-10 mai 1981, sans, bien entendu, tout comprendre de ce qu’il se passait et des enjeux, et sans bien savoir ce qu’il faudrait assurément faire, et ne pas faire. Du poste où j’étais, je pouvais voir et entendre certaines choses, mais bien peu par rapport à tout ce qu’il faudrait étudier aujourd’hui pour essayer d’avoir une vision d’ensemble. Les pages qui suivent ne sont donc qu’un éclairage, personnel, sur cette période et sur le constat qui est fait des relations entre les syndicats et les partis politiques, avec les moyens qui sont principalement ceux de la mémoire, laquelle n’est pas une totale garantie d’exactitude *.
* Le texte original transmis par Gérard Gourguechon est environ deux fois plus long que la version publiée ici. Il sera repris en intégralité dans un ouvrage en préparation reprenant diverses contributions de l’auteur.
Gérard Gourguechon, ex-secrétaire général du Syndicat national unifié des impôts (SNUI, aujourd’hui Solidaires Finances publiques), a été porte-parole de l’Union syndicale Solidaires jusqu’à son départ en retraite, en 2001. Il est aujourd’hui responsable de l’Union nationale interprofessionnelle des retraité∙es Solidaires (UNIRS).

Un Président de la République, une Assemblée nationale et un gouvernement de gauche, pour « changer la vie »
Le 10 mai 1981, l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République ouvre une nouvelle phase dans la vie politique française : pour la première fois depuis 1958, la France connaît une alternance politique. Le soir de l’élection, une grande fête populaire, Place de la Bastille à Paris, rassemble une partie du « peuple de gauche » qui chante sous la pluie, saute sur place, et scande sur tous les tons « on a gagné » ! Dans l’ensemble du pays, la « liesse populaire » éclate également, sauf dans les « beaux quartiers », dont le triangle d’or parisien Neuilly – Auteuil – Passy. Mais la lutte de classes continue pendant la fête, et ça se confirme notamment avec la fuite des capitaux qui commence immédiatement, autant à grande échelle que par les comportements de nombreuses personnes. Face aux capitaux, et surtout face aux détenteurs et détentrices des capitaux, le gouvernement, la majorité parlementaire, les organisations syndicales et les électeurs et électrices de gauche seront globalement soit démunis, soit ignorants et naïfs, soit conciliants voire complices de fait.
Quand le pouvoir d’État est en partie dans les mains de la gauche, le pouvoir économique est toujours allié à la droite. Lorsque la gauche arrive au pouvoir, la première des choses à faire n’est peut-être pas de fêter la victoire en s’illusionnant qu’on « a gagné ». En effet, c’est là que les choses sérieuses commencent, et la journée du 10 mai 1981 et les journées qui vont suivre le confirment largement.Les « forces de droite », celles de la finance, les détenteurs et détentrices de capitaux, toutes et tous estiment être les seul∙es à avoir la légitimité du pouvoir. Alors, qu’arrivent au pouvoir d’État, à la suite d’élections régulières, des forces de gauche qui disent qu’il faut rompre avec le capitalisme et qui, par ailleurs, s’associent au gouvernement avec des ministres communistes, c’est le monde qui s’écroule. Pourtant, la droite qui a été au gouvernement pendant des décennies n’a pas à être bien fière de son bilan : le gouvernement de gauche va « hériter » d’une situation économique désastreuse, avec un chômage déjà endémique et une inflation à deux chiffres depuis plusieurs années.

Au lendemain du 10 mai 1981, un mouvement de panique s’est développé dans les grandes entreprises, chez les possédants, et probablement chez nombre de notables. Celles et ceux qui étaient propriétaires pouvaient avoir peur d’être dépossédés, craindre que leurs entreprises soient nationalisées, etc. Le collectivisme allait s’installer en France. Michel Poniatowski, ancien ministre de l’Intérieur dans le premier gouvernement Barre, annonçait même « les chars russes à la Concorde ». Cette panique était d’autant plus forte, que, quelques jours avant, les mêmes n’y croyaient pas. Ainsi, le 24 avril 1981, deux jours avant le premier tour de la présidentielle, la Bourse de Paris, anticipant la réélection de Giscard, grimpe de 2 %. Et elle gagnera encore 2,5 % le jeudi qui précède le second tour, du fait de l’engouement de spéculateurs pour les titres des sociétés nationalisables, convaincus qu’ils sont qu’ils bondiront dès que la perspective de la nationalisation sera oubliée avec la réélection de VGE. Mais le lendemain du 10 mai, les choses sont tout à fait différentes. Lundi 11 mai, la Bourse de Paris ouvre sous un tel afflux d’ordres de vente que seulement dix sociétés peuvent être cotées. Les 13 et 14 mai, la Bourse de Paris perd 13,9 % puis 9,5 %. Parallèlement, le marché des changes est très fortement secoué.
Le cours du franc suisse s’emballe, et la Banque de France dépense 5 milliards de dollars pour soutenir le franc, soit le tiers de ses réserves en devises. Pendant ce temps de l’interrègne – entre le 10 mai et l’installation de Mitterrand à l’Élysée le 21 mai – nombre de celles et ceux qui possèdent des biens de valeur qui peuvent être assez facilement déplacés et transportés vont se précipiter pour les mettre à l’abri, notamment en Suisse. Des coffres de voitures sont remplis de bijoux, de lingots d’or, de billets de banque, etc. Et les capitaux étrangers prennent aussi la fuite. Le souffle de la panique va légèrement retomber, dix jours plus tard, quand François Mitterrand s’installe à l’Élysée : son premier gouvernement, dans l’attente des élections législatives, ne compte pas de ministres communistes. Et c’est Jacques Delors qui s’installe à l’Économie et aux Finances. Jacques Delors rassure ces gens-là : il a été chargé de mission auprès de Jacques Chaban-Delmas, premier ministre de 1969 à 1972, et il a élaboré à ses côtés le projet de « nouvelle société », il paraît donc, comme nous dirions en 2022, très « compatible » avec le maintien du système capitaliste.
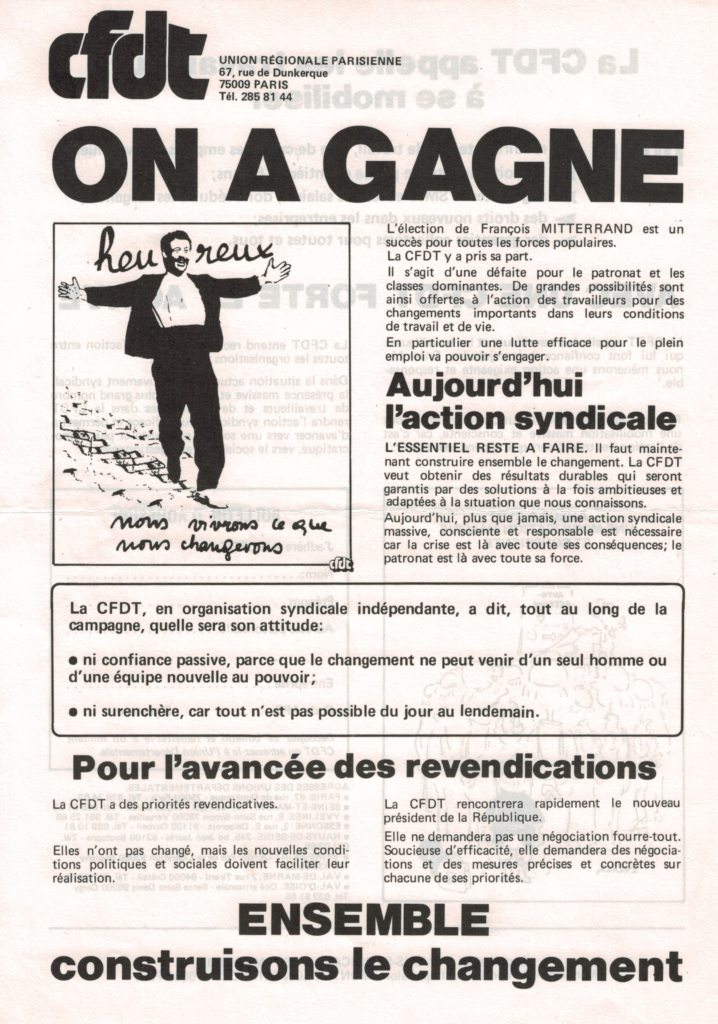
Le 21 mai 1981, pendant que François Mitterrand dépose avec solennité une rose sur les tombeaux de Jean Moulin, de Jean Jaurès et de Victor Schoelcher, Jacques Delors et Pierre Mauroy rédigent les premières mesures de contrôle des changes destinées à redresser le franc. Le 26 mai, François Mitterrand reçoit tour à tour André Bergeron (FO), Edmond Maire (CFDT), Georges Séguy (CGT), Guy Georges (FEN), Jacques Tessier et Jean Bornard (CFTC), Jean Menu et Paul Marchelli (CFE-CGC). Chaque organisation expose certaines de ses revendications. On parle d’augmentation du SMIC et des allocations familiales, de réduction du temps de travail, mais personne ne s’alarme des attaques menées par les détenteurs de capitaux qui sont toujours à l’offensive. De nouvelles craintes pour les détenteurs et détentrices de capitaux vont apparaître avec les élections législatives qui donnent 58 % des sièges à l’Assemblée nationale au Parti socialiste (44 député∙es PCF, et 285 député∙es PS et MRG) [1], lequel pourra donc appliquer son programme législatif.
Au sein du gouvernement, très rapidement quelques ministres conseillent de « s’adapter au contexte économique », c’est-à-dire de se plier aux demandes des détenteurs et détentrices de capitaux, ce qu’il faut faire quand on n’est pas en mesure de leur imposer quoi que ce soit. Michel Rocard, ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire entre 1981 et 1983, est de ceux-là. Jacques Delors, ministre de l’Économie et des Finances du gouvernement Mauroy, en est aussi. Dès le 4 octobre 1981, après la première dévaluation du franc, Delors formule le vœu de réduire le train de vie de l’État (c’est un discours que nous ne cesserons d’entendre par la suite, et encore aujourd’hui, en 2022, et qui se traduit normalement par une réduction « de la voilure » du secteur public, une réduction des missions, des suppressions d’emplois publics, et un gel des salaires des fonctionnaires). Il veut aussi améliorer la « compétitivité » des entreprises, et c’est toujours le discours qui nous sera tenu, y compris pour augmenter, en réalité, les dividendes des actionnaires. En novembre 1981, Delors sera le premier à préconiser une pause dans les réformes : décidément, celles et ceux qui s’affichent « réformistes » semblent avoir vite fait le plein des « réformes ». Très rapidement d’ailleurs, le mot « réformes » sera repris un peu de tous les côtés pour avancer des contre-réformes, des reculs sociaux, un accroissement des inégalités.
Le 9 juin 1982, François Mitterrand, faisant le point, lors d’une conférence de presse, sur la situation économique, annonce la « deuxième phase » du changement. Le 12 juin, à Bruxelles, les ministres des Finances des Dix [2] (Delors pour la France) décident de réajuster les parités de quatre monnaies au sein du système monétaire européen : le mark et le florin sont réévalués, tandis que la lire et le franc sont dévalués. À la sortie, le franc perd 9,59 pour cent par rapport au mark allemand. Les journaux retiennent que le gouvernement français s’est vertement fait rabrouer par le capitalisme rhénan. C’est déjà la deuxième dévaluation du septennat après celle d’octobre 1981. Le 13 juin 1982, Mauroy et Fabius annoncent un ensemble de mesures destinées à accompagner la dévaluation, officiellement en réduisant l’inflation à moins de 10 %, sans mettre en cause la croissance ni sans aggraver le chômage.
Un blocage total des salaires et un blocage partiel des prix sont annoncés jusqu’au 31 octobre 1982. Le déficit budgétaire, en 1983 comme en 1982, devra se limiter à 3 % du PIB. Une contribution en faveur des chômeurs et chômeuses sera demandée aux fonctionnaires et aux professions libérales qui, jusqu’alors, ne cotisaient pas à l’UNEDIC. Le 28 juin 1982, le projet du gouvernement sur les prix et les salaires est adopté par l’Assemblée nationale : le blocage des salaires, c’est la nouvelle phase du changement ! Jacques Delors, des années plus tard, pourra se vanter d’avoir été capable d’engager le premier la désindexation des salaires sur les prix sans provoquer de grève nationale ! Les faiblesses du gouvernement face à la finance et face aux détenteurs et détentrices de capitaux se constatent aussi en ce qui concerne la fuite des capitaux. Le constat a été fait par les agents des douanes, particulièrement par celles et ceux affecté∙es à la frontière entre la France et la Suisse. C’était aussi une déclaration faite à La Tribune de Genève par le représentant des banquiers privés suisses dès le 15 mai 1981. Le 13 mai 1981, Alain Mauger, secrétaire général du syndicat CGT des Douanes, déclare, lors d’une conférence de presse, que « la direction générale des douanes ne semble pas avoir la volonté d’empêcher la fuite des capitaux ». Le syndicat CGT estime que le renforcement du contrôle des voyageurs et voyageuses aux frontières est une mesure alibi, inadaptée à la réalité. Le syndicat réclame « la priorité absolue à la surveillance des banques et des entreprises nationalisables, car elles peuvent transférer des capitaux par de simples jeux d’écriture ou des virements sur des comptes privés ». Le syndicat a même ajouté que « si la Direction Générale des Douanes ne modifie pas sensiblement son attitude, il envisageait de demander à ses adhérents d’intervenir sur leur propre initiative chaque fois qu’un soupçon de fraude existerait, comme les règlements le prévoient ». De son côté, le syndicat CFDT des Douanes a envoyé un télégramme à M. Mitterrand lui demandant une nouvelle définition des missions des douaniers. Rétrospectivement, ce sont là des attitudes « allant dans le bon sens » de quelques organisations syndicales mais s’arrêtant avant toute mise en pratique : le constat était fait que les capitaux s’engageaient radicalement dans la lutte de classes mais le mouvement ouvrier le plus conscient restait l’arme au pied ! La mort de la relance et le virage vers la « rigueur » du gouvernement, confirmés en 1983, vont enrayer l’hémorragie de capitaux, et François Mitterrand, en avril 1983, se rendra en Suisse en visite officielle (une première depuis 1910) : désormais, le gouvernement a fait la paix avec le capital, et le capital sait qu’il a toujours la clé de la maison France.
Les faiblesses premières, les reculs rapides et les dérives progressives du gouvernement dans la lutte contre le capital
Pour analyser déjà les faiblesses programmatiques de la gauche, il convient de revenir sur le contenu du Programme commun de gouvernement, adopté le 27 juin et signé le 12 juillet 1972. Il s’attaque aux problèmes des salaires, de l’emploi, de la santé, de l’urbanisme, de l’éducation, de la recherche scientifique, du sport, des loisirs, de la promotion de la femme, de la famille, de la jeunesse. C’est un très bon programme social destiné aux travailleurs et travailleuses, complété par des propos sur la démocratisation du travail et la planification économique. Mais il s’inscrit dans une société capitaliste : 80 % de l’appareil de production demeurerait dans le cadre de la propriété privée et le profit resterait la logique du système. Le 13 octobre 1976, sur le thème « Les socialistes face aux responsabilités économiques », les dirigeants du PS rencontraient les dirigeants du patronat lors d’un Forum de l’Expansion. Et Mitterrand précisait : « Il est vrai que la liberté d’entreprise doit avoir des limites. S’agit-il de refuser l’esprit d’entreprise, les lois du marché, la naissance et le développement du profit : Non. C’est ainsi, même si l’on peut rêver, moi, je ne rêve pas ». Et Rocard ajoutait « … on ne biaise pas avec le marché, sa logique est globale : et, fût-elle publique, une entreprise qui produit dans une économie ouverte est obligée d’en respecter les contraintes ». Des nationalisations sont encore prévues, mais avec le versement d’indemnités avantageuses qui permettront aux détenteurs et détentrices du capital de retrouver des capitaux disponibles pour d’autres investissements novateurs. Très rapidement, avant même l’arrivée au pouvoir de 1981, des glissements idéologiques ont donc déjà eu lieu. Nous sommes déjà loin de la recherche de la rupture avec le capitalisme préconisée par les éléments de gauche du CERES [3] et loin de l’ouverture en direction du socialisme, portée par le PCF [4].
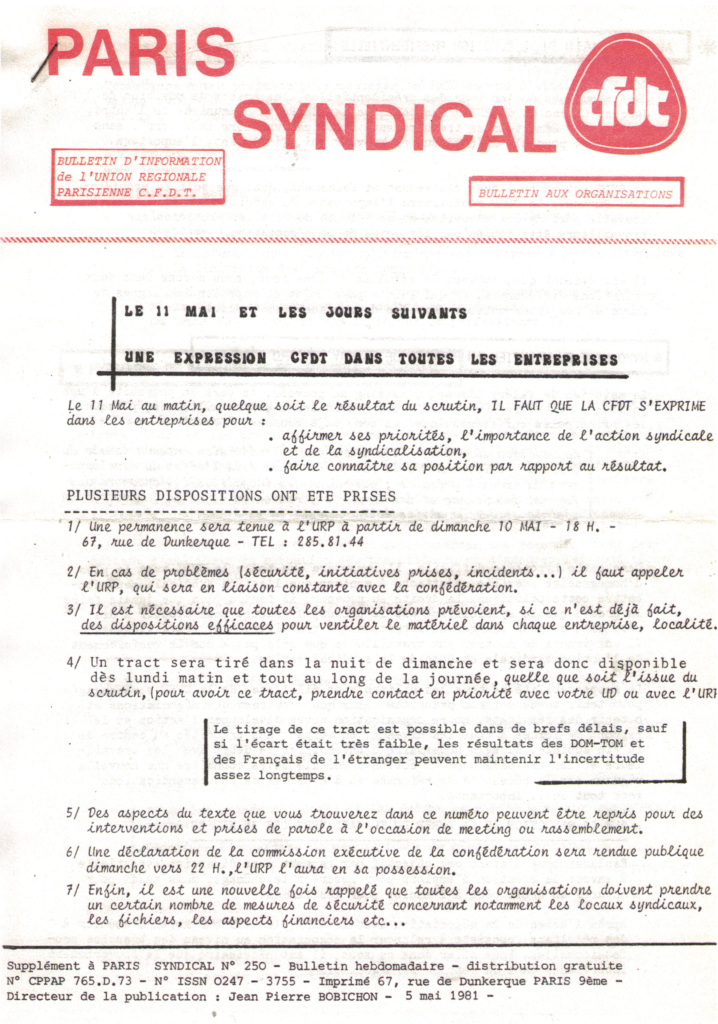
La confiance à l’égard des partis de gauche devient le discours dominant à gauche. Les « luttes » auront leur débouché par les élections. Un électoralisme s’installe et domine les esprits. Il entraînera plus ou moins un suivisme des organisations syndicales par rapport aux partis politiques de gauche, lesquels ne veulent pas d’une situation sociale explosive dans les entreprises. S’inscrivant dans le respect du droit de propriété, le Programme commun repose, de fait, sur le respect de la légalité bourgeoise, et il va donc, plus ou moins, contribuer à cadrer les luttes : des luttes sont engagées et, quand elles échouent, la réponse est que c’est le bulletin de vote qui débloquera la situation. Les 110 propositions du candidat François Mitterrand sont ratifiées par le congrès de Créteil du PS, le 24 janvier 1981 ; elles sont inspirées du projet socialiste, lui-même marqué par le compromis entre le PCF, le PS et les Radicaux de gauche que représentait le Programme commun de 1972. En matière économique, les propositions s’inscrivent totalement dans le cadre de l’économie de marché capitaliste, même si elles peuvent représenter des avancées sociales pour les salarié∙es : plan de relance, investissement, grands travaux, soutien à la recherche, création d’emplois, planification, nationalisations, renforcement syndical, 35 heures, augmentation du SMIC, impôt sur la fortune, économies d’énergie, etc.

Très rapidement, les travailleurs et les travailleuses vont voir qu’ils et elles ont peut-être « gagné » le 10 mai 1981, mais que ce ne sont pas eux et elles qui sont au pouvoir. Le premier gouvernement de Pierre Mauroy comporte 7 énarques, soit 20 % des ministres. Parmi les gens influents qui se rencontrent dans les ministères, à l’Élysée et à Matignon, puis rapidement à la tête d’administrations centrales ou de grandes entreprises publiques, gravitent principalement des hommes qui ont adhéré au PS, notamment pendant leur passage à l’ENA au cours des années 70. On y trouve probablement des personnes sincères, progressistes, et qui voulaient réellement améliorer la situation du plus grand nombre, et très certainement aussi des personnes qui étaient venues là pour accéder au pouvoir, pour faire et agir, quel que soit peut-être le sens, et aussi pour réussir leur plan de carrière. Il faudrait connaître le tréfonds des âmes pour classer Jean-Pierre Chevènement, Pierre Joxe, Laurent Fabius, Lionel Jospin, Jean-Paul Huchon, Jean-Cyril Spinetta (par ailleurs instigateur d’une section CFDT à l’ENA), Daniel Lebègue, Michel Rocard, François Hollande, Ségolène Royal, des noms qui reviennent, comme ça, et d’autres. Tout aussi rapidement, à l’Élysée, à Matignon, dans les cabinets ministériels, des hommes et des femmes vont s’accoutumer sans peine à leurs nouvelles fonctions, aux rouages de la machine étatique, aux codes de l’administration, aux ors de la République, au chauffeur qui assure votre déplacement, mais, pour montrer qu’on est « peuple », on va s’asseoir à côté du chauffeur, et pas derrière, comme le faisaient les gens de droite. François Mitterrand qui, en 1964, avait publié un essai titré Le Coup d’État permanent, où il dénonçait la lettre de la Constitution de la Cinquième République et la pratique du pouvoir personnel qui néglige les corps intermédiaires, va très facilement s’adapter au présidentialisme, en privilégiant les rapports personnels et en laissant prospérer une multitude de courtisans.

Le 21 mai 1982, depuis Épinay-sur-Seine, Pierre Mauroy déclare, devant les délégués des sections et groupes socialistes d’entreprises : « Les hausses nominales excessives des revenus et des salaires entretiennent l’inflation et privent notre économie des moyens de créer des emplois ». Ainsi, seulement un an après le 10 mai 1981, le Premier ministre socialiste affirme que les hausses de salaires sont la cause du chômage, et même seulement les « hausses nominales », quand bien même l’inflation serait supérieure et qu’il y aurait, de fait, baisse du pouvoir d’achat réel. On croirait entendre Yvon Chotard, le président du Centre national du patronat français (CNPF, devenu le MEDEF) : il faut baisser le pouvoir d’achat réel des salarié∙es, il faut un partage des richesses encore plus favorable au capital. Les militants et militantes « d’entreprises » du PS accusent le coup, mais il n’y a aucune rébellion. Et, en juin 1982, Pierre Rosanvallon, l’un des hommes qui parle au Président, met en avant les contraintes de ce qu’on n’appelait pas encore la mondialisation : « Dans une économie ouverte, la marge de manœuvre est étroite. On n’échange pas que des biens et des services, ce sont inévitablement des politiques économiques que l’on finit également par être contraint d’importer ». Tout ceci va se concrétiser le 28 juin 1982, par le vote par l’Assemblée nationale de la loi favorisant le capital au détriment du travail. En effet, le 13 juin 1982, avec le blocage total des salaires et le blocage partiel des prix, le gouvernement a décidé de baisser ses prétentions par rapport aux résistances des détenteurs et détentrices de capitaux. Le gouvernement et les partis qui sont au pouvoir ne dénoncent pas les attaques du capital et ils n’appellent pas les électeurs et électrices à venir défendre leur vote en descendant dans la rue, en faisant pression sur les patrons. Les directions des organisations syndicales restent également les bras croisés tout en commençant à constater les dégâts.
En mars 1983, le « tournant de la rigueur » confirmé marque le changement radical de politique économique, après le choix d’une politique de relance keynésienne dans le contexte d’attaques contre le franc maintenu dans le système monétaire européen. Deux tendances s’affrontent. Certains, tels Bérégovoy, Fabius, Chevènement, Riboud, préconisent une politique expansionniste mais coûteuse, avec un fort déficit, la sortie de la France du Système monétaire européen (SME) et un durcissement du contrôle des changes. D’autres, comme Mauroy, Delors, Peyrelevade, poussent pour l’adoption de la rigueur qui mène au renoncement au programme défendu durant la campagne de 1981 mais maintient la France dans la construction européenne. Mitterrand opte pour le maintien de la France dans la communauté européenne, ce qui implique un arrêt de la politique de relance, un freinage de l’inflation par la hausse des taux d’intérêt et la contraction des dépenses publiques. Ce seront les annonces faites le 21 mars 1983.
Le 3e gouvernement Mauroy, qui durera du 22 mars 1983 au 17 juillet 1984, va s’inscrire totalement dans la politique de rigueur et entériner l’abandon des engagements pris devant les électeurs et électrices en 1981. Il regroupe des personnalités qui, hier, en 1982, étaient opposées quant aux choix politiques à prendre. Bérégovoy et Fabius, qui s’affichaient pour la sortie du SME, sont ministre de la Santé et ministre de l’Industrie, aux côtés de Rocard, ministre de l’Agriculture et surtout de Delors, ministre de l’Économie et des Finances qui, tous deux, prônaient un renforcement de la rigueur. Les revirements rapides seront aussi la marque d’une bonne partie de la classe politique, conduisant à accroître la désorientation des électeurs et électrices, qui voient bien qu’il est difficile de « faire confiance ». Malgré le choix délibéré de la rigueur, il y a encore quatre ministres communistes dans ce gouvernement : Charles Fiterman aux Transports, Marcel Rigout à la Formation professionnelle, Jack Ralite à l’Emploi et Anicet Le Pors à la Fonction publique. Charles Fiterman, qui avait été au sein du PCF, dans la période précédant le 10 mai 1981, le principal tenant de la ligne « autogestionnaire » fondée sur le développement de luttes « à la base », pour faire pression tout à la fois sur le patronat et sur le PS et pour garantir l’application du programme commun, devint donc ministre d’État en juin 1981, ministre des transports [5], et sera, de fait, un frein à tout développement des luttes, en particulier à la SNCF. Les communistes vont accompagner les ralentissements progressifs de la politique de réformes entreprise dans les premiers mois du septennat. C’est surtout à partir de ce moment que le grand écart va commencer entre l’appareil politique du PCF et une bonne partie de sa base militante comme entre des dirigeants de la CGT et un grand nombre d’adhérentes et d’adhérents. Quand, de temps en temps, le PCF émet une critique à l’égard de la politique menée, François Mitterrand fronce les sourcils : « Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le gouvernement et un pied dehors ». Et tout rentrait dans le rang.
Les choses seront plus claires à compter du 17 juillet 1984, avec l’installation du gouvernement Fabius, qui durera jusqu’au 20 mars 1986 (début de la première cohabitation avec Jacques Chirac). Ce gouvernement ne comporte plus de ministres communistes. Malgré les demandes et propositions de Mitterrand et de Fabius, et malgré les souhaits des ministres communistes sortants, le Comité directeur du PCF vote contre leur participation à ce nouveau gouvernement. Pierre Bérégovoy à l’Économie et aux Finances va ouvrir la voie à un processus de privatisation qui ne cessera plus pendant plusieurs décennies jusqu’à maintenant, en 2022. Les marchés financiers sont partiellement dérégulés, marquant délibérément que le gouvernement leur sert la soupe en leur permettant progressivement de pouvoir se déplacer sans limites ni contrôles sur toute la planète. C’est ainsi que les détenteurs et détentrices de capitaux seront en mesure de mettre en concurrence les systèmes fiscaux et sociaux des États et leurs budgets publics. Une concrétisation sera la baisse de l’impôt sur les sociétés, de 50 % à 45 % selon que les bénéfices sont réinvestis dans l’entreprise ou distribués en dividendes aux actionnaires. En 1986, Chirac s’inscrira dans cette voie en élargissant la baisse, et c’est ainsi que nous arriverons à un taux de 25 % en 2021. En septembre 1989, le Premier ministre Michel Rocard enterre les espoirs d’Europe sociale maintes fois mis en avant : « Nous avons une majorité de gouvernements conservateurs dans la communauté. Ils pensent que la meilleure façon de faire de l’expansion, c’est de laisser les gens gagner de l’argent n’importe comment, de ne pratiquement pas taxer le capital et ses revenus. Les règles du jeu du capitalisme international sanctionnent toute politique sociale audacieuse. Il faut assumer les règles de ce jeu cruel pour faire l’Europe ». La chute du Mur de Berlin quelques jours plus tard continuera de donner raison à Madame Margaret Thatcher et à celles et ceux qui veulent maintenir les choses en l’état et le capital maître du jeu : « Il n’y a pas d’alternative ». Si tant est que l’alternative se trouvait au-delà du Mur… Pour celles et ceux qui veulent toujours changer radicalement la société, l’espoir qu’un autre monde est possible ne sera en rien remis en cause.

Pour marquer l’ampleur des dérives du PS, l’exemple du parcours de Pascal Lamy peut être retenu. Pascal Lamy est membre du PS depuis 1969. Il est à l’ENA de 1973 à 1975 (promotion Léon Blum !) et en sort inspecteur général des Finances. Il est conseiller au cabinet de Jacques Delors d’avril 1981 à juillet 1984 et également membre du cabinet de Pierre Mauroy en 1983-1984, c’est un homme d’influence. Il est auprès de Jacques Delors à Bruxelles de 1985 à 1994, puis directeur général du Crédit Lyonnais jusqu’à sa privatisation en 1999. C’est dire si, avec une telle carte de visite, un tel socialiste est rassurant pour devenir directeur de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de mai 2005 à 2013. Là, il pourra participer à organiser l’ordre libéral international. Ce qu’il fera excellemment. Ainsi vont triompher progressivement les discours de la fatalité feinte et la pédagogie de la soumission. De plus en plus, ce sera essentiellement le Parti socialiste qui poursuivra cette dérive droitière à laquelle échappera plus ou moins le PCF après avoir quitté le gouvernement en juillet 1984. Mais le PCF sera tout de même fortement bousculé par des positionnements difficiles et qui vont créer tant des tensions internes que des ruptures avec une partie de l’opinion publique qui aurait pu lui être favorable, par exemple lors de la création du syndicat Solidarnosc en Pologne, en 1980-1981, et, plus tard, en novembre 1989, lors de la période qui s’ouvre avec la chute du Mur de Berlin. Des vagues de militantes et de militants dont les yeux vont être régulièrement décillés vont être fortement déboussolés et souvent sans autres références solides à quoi se raccrocher.
Un syndicalisme majoritairement suiviste par rapport au gouvernement
Le 13 juin 1981, Georges Séguy, secrétaire général de la CGT, dans un entretien avec un journaliste, porte une appréciation positive sur les premières mesures du gouvernement Mauroy, qui ne durera que du 22 mai au 23 juin, et n’a pris, à la date du 13 juin, que quelques décisions (dont une hausse du SMIC de 10 % et une hausse de 25 % des allocations familiales). À noter que le Conseil des ministres du 3 juin 1981 de ce premier et court gouvernement Mauroy, confirme l’abandon du camp militaire du Larzac et de la construction de la centrale nucléaire de Plogoff. Georges Séguy ajoute que son organisation passera d’un syndicalisme de contestation à un syndicalisme de participation et de négociation, tout en affirmant qu’il préservera l’indépendance du syndicat et son autonomie d’action. C’est bien encore le fait de dire une chose et son contraire dans une même phrase. Du 13 au 18 juin 1982, la CGT tient son 41e congrès à Lille, et Henri Krasucki va succéder à Georges Séguy comme secrétaire général. Le congrès va qualifier le blocage des salaires « d’erreur économique » et de « faute politique », mais personne n’appelle à l’action pour s’y opposer. Krasucki, nouveau premier dirigeant de la CGT et membre de la direction du PCF, déclara bien « encourager » les travailleurs à « hausser le ton », mais il n’y eut pas même une journée d’action. C’est probablement ce qu’il faut appeler un syndicalisme de participation et de négociation. Mais le « grand frère communiste » aura la même attitude conciliante : le 22 juin 1982, à Ajaccio, Georges Marchais estime que le blocage des salaires est « injuste » et « pas du tout nécessaire », mais pas plus d’agressivité ni de dénonciation d’un quelconque « scandale ». Il faut croire que la présence de quatre ministres communistes au gouvernement était considérée comme un élément plus important que tout. Majoritairement, la direction du PCF va cautionner le tournant idéologique très concret que représente le « tournant de la rigueur », commencé en juin 1982 et largement confirmé en mars 1983. Très majoritairement, la direction de la CGT va également suivre. La CGT va aussi être marquée par la présence de « camarades » dans les cabinets ministériels, un peu chez Fiterman aux Transports, et particulièrement à la Fonction Publique, avec René Bidouze qui assure les fonctions de directeur du cabinet du ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, Anicet Le Pors. Le parcours de ce militant syndical et politique peut illustrer ce qu’il en est, en réalité, des relations entre le syndicat, en l’occurrence la CGT, et le parti politique, en l‘occurrence le PCF. René Bidouze adhère aux Jeunesses communiste de France à 14 ans, en 1936. Et dès qu’il commence à travailler, aux Contributions indirectes, il adhère à la CGT. Sans renoncer à sa participation à des travaux du PCF, il devient secrétaire du Syndicat national CGT des Contributions indirectes de 1958 à 1963, puis Secrétaire général de la Fédération des Finances CGT de 1963 à 1970, puis Secrétaire général de l’Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT (UGFF-CGT) de 1970 à 1978 et membre de la commission exécutive de la CGT de 1969 à 1975. Quand Anicet Le Pors lui propose d’être directeur de son cabinet, on peut comprendre que le ministre veuille avoir à ses côtés un camarade compétent et en qui il puisse avoir confiance. Et, vue de la CGT, la présence d’un camarade syndiqué peut être considérée comme une garantie que les revendications et les propositions du syndicat seront bien portées au ministère. Ce qu’il faut régler alors, c’est l’autonomie de l’organisation syndicale par rapport aux choix qui seront arbitrés par le pouvoir exécutif. Il ne faut pas que l’organisation syndicale soit soumise au pouvoir politique, désormais plus ou moins exercé par des « camarades ». Les arbitrages retenus par l’exécutif vont plus ou moins prendre en compte des rapports de forces, et là, il est indispensable que l’organisation syndicale demeure un élément déterminant dans le rapport de forces. L’organisation syndicale doit même être un élément qui vient peser sur l’exécutif pour le contraindre à prendre en compte les revendications. Car, pendant le même temps, les représentants des patrons, petits et grands, des médecins et d’autres catégories des classes moyennes et supérieures s’agitaient et défendaient leurs intérêts y compris dans la rue. Pendant ces premières années de « la gauche au pouvoir », premières années au cours desquelles les premières dérives s’engagent, le mélange des genres peut se faire de différentes façons, qui, toutes, mettent mal à l’aise l’organisation syndicale. Ainsi, parfois, l’ancien « camarade » n’est pas dans un cabinet ministériel, mais devient « patron », ou « directeur » d’une administration. Jacques Roché, un camarade syndiqué, va faire une brillante carrière ; il sera un temps même directeur d’une prestigieuse direction des Impôts, celle des « Vérifications nationales et internationales » (DVNI) en 1982, et chargé de mission, également en 1982, auprès du ministre du Budget (Laurent Fabius), puis même Directeur général adjoint de la Direction générale des impôts : les camarades du syndicat CGT des impôts n’étaient pas tellement à l’aise quand il présidait une réunion face aux organisations syndicales ! Ils avaient par ailleurs déjà fort à faire avec leurs conflits internes à la CGT, entre PS et PCF, et aussi entre militant∙es PCF selon qu’ils et elles étaient pour un syndicalisme de masse ou pour être la courroie de transmission syndicale du Parti, et aussi et encore à l’occasion de conflits uniquement « politiques » comme ceux liés à l’alignement du PC français sur le PC de l’URSS dans le domaine de la politique internationale.
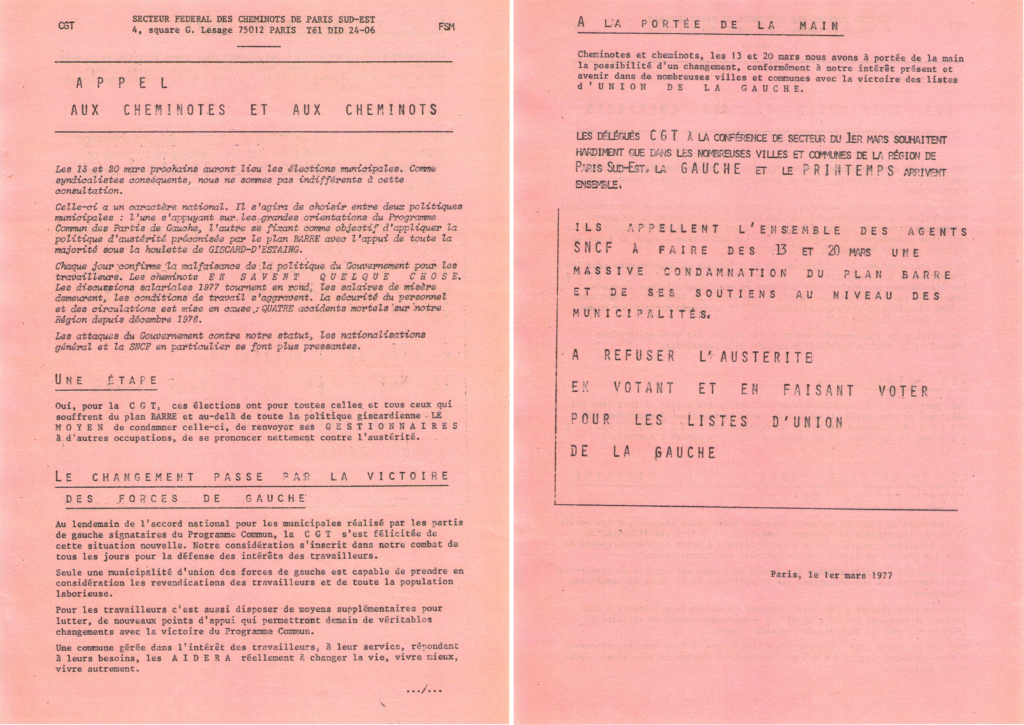
En 1981, l’arrivée de la gauche au pouvoir est, pour la direction de la CFDT, une divine surprise. Immédiatement elle va oublier le « recentrage » adopté quelques années avant et la prise de distance avec le politique. Au soir du 10 mai, la C.E. confédérale publie une déclaration intitulée « Ensemble, construisons le changement ». Et elle précise sa position « La CFDT a dit, tout au long de la campagne et au nom de son indépendance syndicale, quelle sera son attitude : ni confiance passive, parce que le changement ne peut venir d’un seul homme ou d’une équipe nouvelle au pouvoir, ni surenchère, car tout n’est pas possible du jour au lendemain ». Le 14 mai, Edmond Maire rencontre officiellement François Mitterrand, et une délégation CFDT est reçue à l’Élysée le 26 mai. Elle remet au nouveau Président de la République son Mémoire sur les priorités revendicatives de la CFDT, dans lequel elle insiste notamment sur la négociation collective et l’organisation de celle-ci dans l’entreprise sur les questions essentielles pour les travailleurs et travailleuses, à savoir les salaires, la formation professionnelle, l’organisation du temps de travail, le droit d’expression. Très rapidement, de nombreux responsables de la CFDT vont investir les cabinets ministériels. La CFDT s’affiche comme un laboratoire d’idées, particulièrement avec les lois Auroux de 1982 et au ministère de l’Éducation nationale, en concurrence avec la FEN [6]. Elle va tout aussi rapidement approuver le choix de la rigueur en acceptant de limiter les revendications salariales. Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, est un « pro » du double langage ; ainsi déclare-t-il, lors de son discours d’ouverture du 39e congrès de la CFDT, le 25 mai 1982 à Metz : « Le projet socialiste autogestionnaire de la CFDT se trouve, désormais, confronté à des possibilités historiques nouvelles sur lesquelles nous voulons nous appuyer au maximum. Aucun préalable n’existe plus pour avancer dans la construction du socialisme… cependant, un lourd handicap est rapidement apparu. La victoire de la gauche n’a pas provoqué de bouillonnement social, de développement d’initiatives multiples dans les entreprises et les localités … Pendant ce temps, les groupes de pression des catégories privilégiées commençaient à agir pour contrecarrer la politique nouvelle…Il ne s’agit pas de faire du mouvement syndical un relais ou un soutien passif du pouvoir politique … mais la classe ouvrière a tout à gagner à une politique de rigueur et de vérité ». Il est d’autant plus facile de regretter l’absence d’initiatives « de la base » que tout a été fait pour éviter qu’elles soient prises, notamment en multipliant les discours affirmant que la réponse aux revendications viendrait du bulletin de vote. C’était déjà le sens de l’engagement de la CFDT dans les Assises du socialisme, en octobre 1974. Lors de ce congrès, des oppositionnel∙les se feront tout de même voir et entendre, particulièrement chez les cheminots dont certains participeront ensuite à la création de SUD Rail en 1996.
À la CFDT, les exemples de militants « défroqués » vont être nombreux, qui choisissent plus ou moins leur plan de carrière plutôt que des convictions anciennes affichées. Ainsi, après le « tournant de la rigueur » de 1983, Jacques Chérèque, ancien sidérurgiste à Pompey (Meurthe-et-Moselle), et ancien dirigeant confédéral (il a été secrétaire général adjoint de la CFDT en 1979), accepte, début 1984, sur proposition de Laurent Fabius, alors ministre de l’Industrie, d’être Préfet délégué pour le redéploiement industriel en Lorraine pour s’occuper de la restructuration de la sidérurgie. Il fera si bien le « job » qu’en 1986, Jacques Chirac, le nouveau chef du gouvernement de cohabitation, le conserve à ce poste. Ses compétences pour servir le système lui permettront de devenir, de 1988 à 1991, ministre de l’Aménagement du territoire et à la reconversion industrielle du gouvernement Rocard. Aujourd’hui, la désertification de trop nombreuses régions et la désindustrialisation du pays sont probablement redevables en partie aux talents de ce syndicaliste, passé, comme d’autres, à l’ennemi. Mais lui devait dormir sur ses deux oreilles, content d’avoir fait une belle carrière, de sidérurgiste à ministre, terminant en puissance, comme Attila dévastant les plaines qui l’ont vu naître. Le fils, François, marchera dans les pas de son père. Les explications à trouver aux trahisons ne sont pas forcément facilement évidentes ; il y a certainement le souci de réussite sociale personnelle de pas mal d’individus, certains pour un poste de ministre, mais d’autres peuvent se satisfaire d’une promotion professionnelle, d’un passage par le Conseil d’État ou la Cour des comptes, puis d’un retour au bercail administratif d’origine avec une très belle promotion. Certains peuvent perdre le goût des autres et le goût des choses pour n’avoir plus que le sens des affaires.
Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, pas mal de militantes et de militants de la FEN vont également être aspirés dans les ministères, particulièrement au Ministère de l’Éducation nationale avec Alain Savary. Leur secrétaire général depuis 1974, André Henry, va même quitter son poste pour devenir ministre du Temps libre, du 21 mai 1981 au 22 mars 1983. C’est Guy Georges, secrétaire général du SNI-PEGC, qui fera l’intérim pendant quelques semaines avant que Jacques Pommateau ne devienne le nouveau secrétaire général de la FEN. La FEN, elle aussi, est donc mouillée dans la gouvernance du pays et le discours sur l’indépendance du syndicat par rapport aux partis politiques a des difficultés à être entendu quand des militantes et des militants passent directement d’un poste de permanent syndical à un poste de membre d’un cabinet ministériel, voire à un poste de ministre, pour André Henry ! L’imbrication entre la FEN et le PS peut se mesurer dès le lendemain des élections législatives de 1981 : de nombreux élu∙es viennent de l’Éducation nationale, et un bon nombre sont adhérentes ou adhérents de la FEN. Les statuts de la FEN affirment l’indépendance vis-à-vis des partis politiques et la FEN refuse le cumul des mandats politiques et syndicaux, mais ceci va voler en éclats. Lors du congrès de la FEN de février 1982, Jacques Pommateau souligne le changement radical des perspectives : « Les données sont aujourd’hui totalement bouleversées ; le pouvoir n’est plus synonyme de « patronat » et de « force de droite » ; le syndicalisme ne peut plus être seulement synonyme de « résistance » et « d’opposition ». Il nous faut réapprendre ensemble à nous situer dans ce nouveau contexte, à être, certes toujours force de contestation chaque fois qu’il le faudra, mais à redevenir avant tout force de proposition, d’impulsion, de construction de l’avenir ». Et ceci se confirme dans les positionnements de la FEN par rapport à la politique menée par le gouvernement : la FEN proteste modérément contre les tournants de la rigueur de 1982 et de 1983. La FEN va même tenter d’élargir l’assise syndicale du PS. Jacques Pommateau, secrétaire général de la FEN de 1981 à 1988, lance l’idée, en janvier 1986, de « recomposition syndicale ». La direction de la FEN prend des contacts avec des militantes et des militants du PS par ailleurs syndicalistes dans la mouvance autonome (FASP, SNUI, etc.), à FO et à la CFDT. Ceci se fait probablement en liens avec certains courants du PS (Laurent Fabius, Henri Emmanuelli, etc.). L’idée, pour le PS, est d’avoir un relais syndical et de créer un courant réformiste face à la CGT qui, désormais, s’affiche plus souvent critique à l’égard de la politique menée par le PS. Au sein de la FEN, le courant Unité et action (UA, proche du PCF) dénonce la mise en place d’un syndicat social-démocrate lié au PS et abandonnant le terrain revendicatif. La chose est rendue publique à l’issue du Bureau fédéral national de la FEN du 12 juin 1986, ce qui va provoquer quelques surprises et quelques remous et réactions dans un certain nombre d’organisations (dont le SNUI). Mais la volonté des dirigeants de la FEN d’être le relais syndical du PS continue de s’exprimer. Les contacts, souvent menés par Jean-Paul Roux pour la FEN, se consolident avec des représentants de la mouvance autonome (FASP, FGAF, FMC, FGSOA [7], etc.), et des militants de FO (principalement Jacques Mairé et Jean Grosset). Le cas de Jean Grosset illustre assez bien lui aussi, le niveau de mélange des genres auquel il est possible de parvenir quand, semble-il, rien ne sert de repère à une personne si ce n’est son intérêt personnel. Jean Grosset sera approché par la FEN dès 1989, au moment où Marc Blondel devient secrétaire général de FO, en rupture avec la ligne de Bergeron auquel il succède. Il entre à l’UNSA lors des départs de militants FO en 1996. Il en sera Secrétaire général adjoint. A l’automne 2014, il est désigné par l’Élysée (François Hollande) comme personnalité qualifiée au Conseil économique, social et environnemental. En mars 2015, il devient conseiller social de Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, alors qu’il était encore la veille responsable à l’UNSA ; il faut dire qu’ils se connaissent bien, depuis 40 ans, quand ils étaient, l’un et l’autre, membres de l’Organisation communiste internationaliste (OCI, trotskiste). En février 1993, c’est la création de l’UNSA (avec le courant UID de la FEN, et des organisations venant du Groupe des Dix, la FGSOA, la FMC, la FAT et d’autres organisations autonomes, la FGAF et la FASP).

Tout ceci va marquer les syndicalistes dès les premières années de « la gauche au pouvoir » : « on » a des camarades dans les ministères, et on sous-entend que c’est un peu « comme si » on était soit même au gouvernement ! Dès lors, quand des critiques commencent à être formulées, ça revient vite en boomerang : « il faut leur laisser le temps », « il faut leur faire confiance », « tu veux le retour de VGE, c’est ça que tu veux ! », « il faut leur laisser les mains libres », « ce serait encore pire avec les autres ». Et ainsi de suite, de glissements en glissements, de compromis en compromis, de reculades en reculades, les travailleuses et les travailleurs, avec les syndicalistes, majoritairement, ont perdu les élections politiques qu’ils et elles croyaient avoir gagnées. Pour autant, au fur et à mesure des reculs du gouvernement et, plus ouvertement dès le plan de rigueur de 1983, des critiques vont venir du terrain. C’est alors que les appareils politiques et syndicaux vont distiller le discours de la sagesse. Pour les opposants et oposantes « de gauche » aux choix politiques retenus par le gouvernement, ce sera plus facile et plus explicite après le départ des ministres communistes du gouvernement en juillet 1984.

Une indépendance syndicale qui cherche à s’exprimer de diverses façons
Nous venons de le rappeler, pendant les premiers mois, voire les premières années de l’installation de la gauche aux « rênes du pouvoir », les directions des principales organisations syndicales sont restées très majoritairement passives. Assez souvent tout de même, cette position majoritaire de la confédération (à la CFDT et à la CGT notamment) est critiquée par des équipes syndicales qui tentent plus ou moins d’organiser l’opposition à cette position majoritaire et, au moins, à faire vivre un débat. Ainsi, malgré cet attentisme dominant dans les appareils syndicaux, des débats se sont développés à l’intérieur des organisations comme entre militantes et militants d’organisations syndicales différentes. Les oppositions à l’attentisme ont parfois même pu aller jusqu’au déclenchement de grèves et, aujourd’hui encore, si nous consultons les statistiques annuelles du ministère du Travail en matière d’arrêts de travail, des chiffres significatifs figurent pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984.
Des grèves : le syndicalisme n’est pas resté totalement inactif au lendemain du 10 mai 1981. Effectivement, il y a eu encore des journées de grève, le plus souvent dirigées contre des patrons, rarement contre le gouvernement ou contre les orientations politiques du gouvernement. Quand il y a des conflits, ce sont très rarement des conflits généralisés qui supposeraient plus ou moins l’intervention de l’appareil syndical, comme par exemple des journées d’action nationales, des grèves plurisectorielles, des grèves affectant une branche ou un secteur d’activité dans son ensemble. Le plus généralement donc, ce sont des conflits locaux, mais qui montrent que des équipes syndicales ont bien conscience, soit qu’elles ne peuvent attendre tout du pouvoir politique, soit qu’elles n’auront que ce qu’elles exigeront, notamment à l’égard de patrons particulièrement réticents à tout changement allant dans le sens du progrès social.
Plusieurs de ces grèves de salariés et de salariées d’entreprises ont tout de même marqué la période. Dès l’hiver 1981, les ouvrières de l’usine Chantelle (lingerie féminine) de Saint-Herblain, à proximité de Nantes, engagent une grève où il y aura une occupation de l’usine et une forte solidarité régionale pendant plusieurs mois. En 1982, des sidérurgistes de Vireux, dans les Ardennes, se mettent en grève, là encore avec occupation de leur usine. Toujours en 1982, des salariés immigrés initient des grèves à Citroën Aulnay et à Talbot Poissy. Le 1er mars 1982, Jack Ralite, ministre PCF de la Santé, précise les modalités de la disparition du secteur privé dans les hôpitaux publics, qui devra être totale le 31 décembre 1986. Le 3 mars, 14 syndicats de médecins, opposés à la disparition du secteur privé et qui veulent le maintien de cette source supplémentaire de revenus, s’opposent à cette orientation favorable au service public et appellent le corps médical hospitalier à une journée nationale de protestation. Cet appel est suivi à 75 %. Nous avons là, plutôt à faire avec une grève « réactionnaire ». Il y aura aussi des actions catégorielles auxquelles s’opposeront les équipes CFDT et CGT, comme à la Société générale en avril 1982.
Dans la première année du gouvernement de gauche, il n’y a, semble-t-il, qu’un conflit « national », engagé par des organisations syndicales nationales et sur une base progressiste. C’est à la Direction générale des impôts, une administration qui, à l’époque, connaissait un fort taux de syndicalisation avec une présence syndicale effective dans tous les immeubles administratifs ou presque et une dynamique syndicale unitaire, sous l’impulsion, plus ou moins, et selon les phases, de la CGT et du SNUI. Déjà, lors des rencontres des organisations syndicales avec les nouveaux ministres Delors et Fabius, la CGT et le SNUI avaient essayé d’obtenir des engagements précis des ministres. La première rencontre avait été une catastrophe, non préparée entre les syndicats, et la plupart des organisations avaient exposé leur catalogue revendicatif, sans opérer une quelconque hiérarchie. Lors de la troisième rencontre, à l’initiative de la fédération des Finances CGT, l’idée était d’être concis dans nos demandes, et d’attendre des engagements concrets du ministre. Le SNUI et la CGT ont essayé d’obtenir une réponse de Delors, mais les autres organisations n’ont pas cessé de délayer les demandes. Ensuite, le travail collectif a pu s’améliorer. Et, le 2 juillet 1982, à l’initiative des syndicats SNUI, SNADGI-CGT, SGI-FO, SNI-CFDT, les agents de la Direction générale des impôts sont appelés à faire grève une demi-journée, le matin. L’appel à la grève vise à s’opposer à l’orientation politique nouvelle du gouvernement de « blocage total des salaires et de blocage partiel des prix ». Ce choix gouvernemental est analysé comme une attaque contre les salarié∙es, dès lors que les prix, donc les profits, continueront d’augmenter, quand les salaires seront bloqués, c’est-à-dire que le pouvoir d’achat des salarié∙es ira en diminuant du fait de l’inflation (en 1982, l’inflation sera de 9,7 %). Ce choix signifie que le gouvernement privilégie le capital contre le travail. Quelques jours avant le 2 juillet 1982, les quatre organisations avaient pu rencontrer « leur » ministre de l’Économie et des Finances, Jacques Delors, de retour de Bruxelles, pour lui expliquer leur opposition aux choix retenus. Le pourcentage de grévistes se situa entre 15 % et 20 %, ce qui était très bas, à l’époque, par rapport aux appels très souvent unitaires faits par ces quatre organisations. Cet appel a été possible notamment car les trois syndicats confédérés avaient tous une pratique unitaire forte et n’étaient pas toujours « aux ordres » de leur appareil confédéral. En outre, les directions des quatre organisations pouvaient s’appuyer sur l’affichage officiel d’indépendance de leur syndicat, et c’est ce qu’elles feront pour répondre aux critiques internes auxquelles elles auront à répondre pendant plusieurs mois, critiques venant particulièrement des militantes et des militants PS présent∙es dans les quatre organisations syndicales. L’appel à la grève mettait en cause très directement le choix politique du gouvernement, le blocage total des salaires, ce qui allait donc bloquer le salaire des agents des impôts, dont les organisations syndicales avaient la légitimité de défendre le pouvoir d’achat. Cette unité syndicale et cette indépendance syndicale ont peut-être une explication, à savoir le métier exercé, celui d’agent des impôts, métier où on acquiert vite une notion de ce qui est juste, et injuste, dans la société, où on comprend vite les mensonges des gouvernements et les décalages entre des discours et des politiques réellement menées, en l’occurrence favorables aux détenteurs et détentrices de capitaux. En mars 1983, lors du second tournant de la rigueur, les réserves internes quant aux critiques à formuler à l’égard des choix politiques du gouvernement seront déjà moins fortes. Ainsi, le SNUI avait mandat de son Conseil syndical de dire à Delors que ses choix étaient « insupportables, inacceptables, et intolérables ». Ce que Delors n’a pas trop supporté.
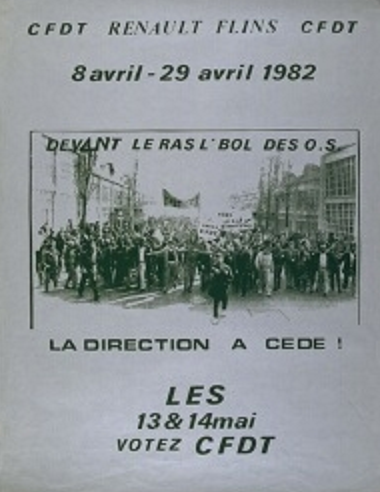
Au fur et à mesure que le gouvernement va reculer face aux exigences des « forces de l’argent », il y aura des mouvements de protestation de salarié∙es dans les administrations et dans les entreprises publiques qui ont pour employeur plus ou moins direct l’État et ses représentants. Parallèlement, le gouvernement va réduire sa pression à l’égard des patrons privés, lesquels vont rapidement comprendre qu’ils n’ont plus tellement à craindre du gouvernement et vont donc pouvoir remettre la pression sur les salarié∙es. Des grèves vont de nouveau se développer dans le secteur privé. Dans les premières années, il y aura rarement des appels à des journées nationales d’action de la part des appareils confédéraux. Par contre, des mouvements seront lancés à l’initiative d’équipes syndicales, CGT et aussi CFDT. Il y aura aussi des grèves lancées « spontanément » par des collectifs, des coordinations, pouvant regrouper des personnes syndiquées et des personnes non syndiquées. Avec l’arrivée du gouvernement Rocard, en mai 1988, il y a une montée des luttes dans différents secteurs : Peugeot, les infirmières, les camions jaunes de la Poste, les Impôts et les Finances, etc. Tous ces conflits mériteraient de longs développements car ils illustrent comment, dans le contexte d’un gouvernement « de gauche », la conflictualité sociale parvient tout de même à s’exprimer. La grève aux Finances était une grève dirigée contre la politique gouvernementale (suppressions d’emplois, casse des administrations chargées du contrôle des entreprises, etc.). Par sa durée (de mai à novembre 1989) et par sa radicalité (notamment plus de 50 milliards de francs en chèques TVA bloqués dans les armoires syndicales et autres lieux) elle a exacerbé les tensions, particulièrement les tensions entre militant∙es qui privilégiaient leur appartenance politique et d’autres, beaucoup plus nombreux et nombreuses, qui privilégiaient leur appartenance syndicale. Dans certains départements, des autodafés de destruction de cartes PS ont été mises en scène, signe des ruptures que tout ceci signifiait. Lors de ces conflits, les structures syndicales « supérieures », les fédérations, les fédérations de fonctionnaires, les confédérations, la FEN, etc., ont toujours été aux abonnés absents. Ainsi, Jean-Paul Roux, responsable de la FEN sollicité début septembre 1989 pour « élargir l’action au niveau de la fonction publique » répondant : « l’actualité n’est pas au renversement du gouvernement Rocard ».

Des débats et des rapprochements syndicaux : des débats ont tout de même eu lieu et même des syndicats ont cherché à s’organiser pour combler le vide laissé par les directions confédérales. Ainsi, peu de temps après l’élection présidentielle du 10 mai 1981, Maurice Ragot, secrétaire général de la FGSOA prend l’initiative de contacter tant la confédération CGT que la confédération CFDT. La FGSOA pense que le changement politique aurait pu être l’occasion d’un rapprochement entre les organisations syndicales, comme ce fut le cas en 1936 entre la CGT et la CGTU. En 1936, la réunification a été un élément important dans le dynamisme revendicatif et dans le développement des luttes. C’est la dynamique unitaire qui a aidé au développement d’initiatives, aux occupations d’usines et de lieux de travail afin d’obliger les patrons à lâcher plus qu’ils ne l’auraient fait en l’absence de rapport de force. Et le doute régnait dans le monde ouvrier quant au volontarisme des partis de gauche à transformer le pays compte tenu de leurs passages récents au gouvernement. En 1981, en fait d’unité syndicale, la direction de la CGT comme celle de la CFDT pensaient principalement à ce que les syndicats en quête d’unité rejoignent leur confédération. Ce n’était pas l’objectif recherché, et la FGSOA a pris l’initiative de rencontrer en bilatérale un certain nombre d’organisations syndicales autonomes, indépendantes, non confédérées. Le 10 décembre 1981, toutes ces organisations se sont retrouvées ensemble pour faire notamment le constat qu’elles étaient presque toutes nées de la scission entre la CGT et la CGT-FO et de leur refus, à l’époque, en 1947-1948, de choisir entre les deux, en privilégiant, elles pensaient provisoirement, leur unité à la base, dans l’attente d’un retour, un jour, à « la grande CGT réunifiée ». En plus de la FGSOA, il y avait le SNUI, le SNJ, la FGAF, la FADN, la FGAAC, la FAT, le SNCTA, la FASP et le SUACCE [8]. Le sentiment est partagé que la référence à 1936 est d’actualité : pour obliger les patrons à reculer, pour aider, ou obliger, le nouveau gouvernement à prendre des mesures progressistes, la meilleure garantie, c’est l’intervention des salarié∙es sur le lieu de travail, pour faire pression. Sans bien s’en rendre compte à l’époque, c’est bien la question de l’indépendance syndicale qui est posée, la question de l’autonomie ouvrière. Ces dix organisations décident de se revoir régulièrement, en précisant qu’il n’est pas du tout question de créer une structure confédérale supplémentaire ni d’agir contre les confédérations : c’est l’unité la plus large qui est souhaitée. Elles se rencontreront, de plus en plus régulièrement, sur des thèmes de plus en plus nombreux, jusqu’à donner naissance, de fait, à un nouveau pôle syndical autonome. Dans le prolongement de cette rencontre, en janvier 1982, un appel à la réunification syndicale est signé et rendu public par le Syndicat national des instituteurs (Guy Georges), la Fédération autonome des syndicats de police (Bernard Deleplace), le Syndicat national unifié des impôts (Gérard Gourguechon), le Syndicat national des journalistes (Daniel Gentot) et la Fédération générale des salariés des organismes agricoles (Maurice Ragot). Cet appel n’aura aucun écho à la CGT, à la CFDT comme à FO.

Quarante ans après, les dégâts ne sont pas réparés.
La « parenthèse de la rigueur » de 1982 … n’a jamais été refermée. Les partis politiques « de gauche » sont à la ramasse. Nous sommes en présence d’un mouvement syndical en questionnement [9]. […] En 1981, il fallait certainement faire « comme en 36 ». Mais les directions syndicales, très majoritairement, étaient dans l’attente d’une solution politique et électorale à leurs revendications. Et, très majoritairement aussi, les travailleuses et les travailleurs ont fêté « leur victoire » et ont laissé décliner les choses. En 1936, il y avait aussi l’enthousiasme lié à la victoire électorale des socialistes, mais ceci était accompagné d’une méfiance populaire vis-à-vis de la classe politique, suite notamment aux frustrations après les victoires de la gauche en 1924 et en 1932. Le fait qu’en 1981 les directions syndicales n’étaient pas à l’origine des grèves n’est pas exceptionnel : c’était à peu près la même chose en 1936. Les élections victorieuses ont lieu le 3 mai 1936, le Front populaire a gagné les élections législatives, mais le gouvernement de Léon Blum ne s’installera que le 4 juin. Mais tout commence le 11 mai, au Havre, dans une usine d’horlogerie, où les ouvriers déclenchent une grève pour demander la réintégration de collègues licenciés. Et ça va s’étendre, faire tache d’huile, se généraliser, pas à l’initiative de la confédération récemment réunifiée, mais sous l’impulsion des salarié∙es et des équipes syndicales dans les entreprises. Très généralement, ce sont des grèves avec occupation des lieux de travail, ce qui empêche le patronat d’employer « des jaunes ». Très rapidement, le 7 juin, les accords Matignon sont signés, des grèves vont continuer malgré tout, mais la fête est finie, Maurice Thorez, le 11 juin 1936 déclare : « Il faut savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été obtenue ». En 1936 non plus, malgré des avancées, le Grand soir n’a pas eu lieu ; les gens iront à la plage grâce aux premiers congés payés.
En 1981, si l’objectif final n’était pas que les partis politiques de gauche prennent plus ou moins le contrôle de l’appareil d’État, que le Chef soit fait Roi et règne en son Palais, entouré de courtisanes et de courtisans avides d’honneurs, d’avantages, de privilèges, de prébendes, que d’autres chefs soient faits Duc de Normandie, Duchesse de Bretagne, Comte d’Artois, de Nice ou du Poitou, que d’autres encore soient Directeurs ou PDG d’EDF, de la SNCF, d’Air France, du Crédit Lyonnais, ou d’autres joyaux de la couronne, alors il fallait faire comme en 36.
En 1981, si l’objectif final c’était de changer la vie, de donner une autre orientation à la Nation, pour aller vers la justice pour toutes et tous, la liberté, le partage, la solidarité, la reconnaissance, le respect, la démocratie partout et la prise en compte égale de chacune et de chacun, alors il fallait faire comme en 36 et aller plus loin, ne pas s’arrêter en chemin.
En 1981, si l’objectif final c’était de gagner au moins une fois face aux autres, pour voir leur mine déconfite, voire obtenir une augmentation du SMIC, des créations d’emplois, des droits syndicaux dans l’entreprise, une augmentation des jours de congé, une amélioration du système des retraites, alors on pouvait faire comme on fait en 1981 : laisser le gouvernement de gauche isolé face aux « forces de l’argent », et même s’il avait voulu résister, ça n’aurait pas duré longtemps.
Faire comme en 36, ça aurait été, dès que nous avons reconnu, sur les écrans de télévision, après les crânes dégarnis, qu’il ne s’agissait pas de Giscard mais de Mitterrand, que les salarié∙es qui étaient au travail à ce moment-là, celles et ceux qui étaient « en trois –huit » et d’autres, se réunissent pour décider de comment ils et elles allaient désormais gérer, en maintenant l’outil de travail. Il fallait qu’une partie de leurs camarades les rejoignent dans l’entreprise, pour qu’elle soit occupée le lendemain matin. Peut-être le soir encore, dans les sièges des entreprises, dans les bureaux, les banques, les administrations, les ministères, les journaux, les radios, les chaînes de télévision, partout où des invisibles nettoyaient les bureaux pour qu’ils soient propres lundi matin, il fallait que des employé∙es accourent et occupent aussi leur lieu de travail. Il fallait que, dès le lundi matin, mille LIP fleurissent, comme nous le clamions le 29 septembre 1973 dans les rues de Besançon.
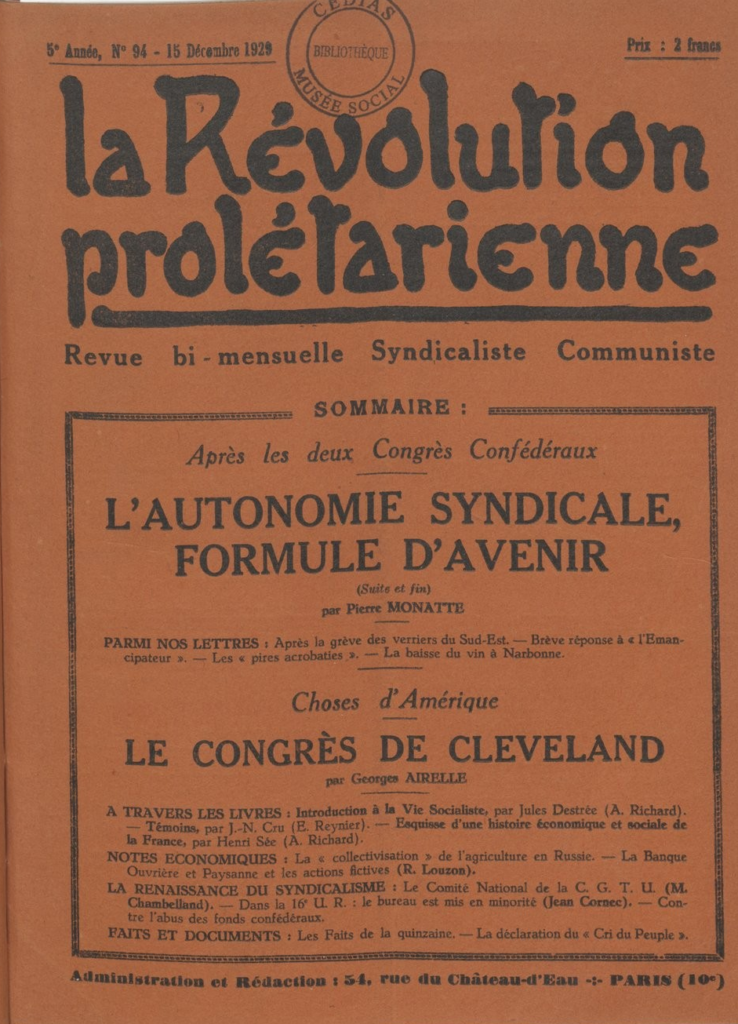
Le niveau d’engagement dans la lutte dépend effectivement du niveau de sincérité dans nos revendications : ou bien c’est un jeu, ou bien nous y croyons. Si nous y croyons, il nous faut un engagement collectif à la hauteur des enjeux. Tout ceci implique, de la part du monde ouvrier et de ses organisations syndicales, tout à la fois une réflexion collective et une grande détermination. Et c’est là que l’indépendance par rapport aux appareils politiques devient nécessaire. L’objectif des partis politiques, c’est notamment l’accession au pouvoir d’État. Dans les démocraties, il faut être élu par une majorité de votants et votantes. Il faut donc faire des promesses, qui n’engagent pas forcément. Et, dans les partis politiques, peuvent s’y rencontrer des personnes qui vont largement se satisfaire du seul fait d’avoir maintenant un poste de pouvoir. Pour les organisations syndicales, c’est un moment où il faut être particulièrement vigilant : « eux c’est eux, et nous c’est nous ». Les objectifs peuvent vite se révéler opposés. Thorez disait qu’il faut savoir arrêter une grève dès que nos revendications sont satisfaites. Il faut donc savoir quelles sont nos revendications. S’il s’agit d’une légère augmentation des salaires, ce qui n’est pas négligeable et qui améliore un peu, et tout de suite, la situation des personnes concernées, en sachant que demain l’inflation pourra nous reprendre tout, nous savons aussi que ça ne va pas changer nos vies, et encore moins la vie, alors nous pouvons arrêter la mobilisation dès qu’un tel accord a été obtenu. Mais s’il s’agit de faire cesser l’exploitation capitaliste, alors là, les enjeux sont tout autres et la détermination dans la lutte ne devra pas s’arrêter à une soirée électorale. La soirée électorale, la victoire des partis de gauche, ce n’est pas négligeable dans la construction du rapport de force en faveur des travailleuses et des travailleurs et, plus globalement, du salariat et des victimes du système économique actuel. Ce nouvel environnement institutionnel peut aider pour l’adoption de lois plus favorables.
C’est à ce stade que « le débouché politique aux luttes » prend son sens. Mais si le mouvement ouvrier veut aller plus loin dans l’appropriation de son travail, dans le fonctionnement démocratique du pays, dont le fonctionnement démocratique des entreprises au-delà des quasi pleins pouvoirs laissés aux détenteurs des capitaux, alors il faut qu’il sache faire preuve d’indépendance par rapport aux partis politiques de gauche. Il ne faut pas que leur présence aux manettes de l’État ne devienne un piège. Il faut s’habituer à ne pas faire confiance et à privilégier le débat dans les organisations syndicales, et le débat sur toutes les questions ou presque. La meilleure garantie pour une organisation syndicale d’être indépendante des appareils politiques c’est probablement d’avoir, à l’interne, des débats très politiques, mais avec l’ensemble des adhérentes et des adhérents. Plus l’ambition de l’organisation syndicale est forte, plus elle souhaite participer à la transformation sociale, et plus elle devra démocratiser son fonctionnement, et plus elle devra élargir ses questionnements. Tout ceci avec l’ensemble de ses adhérentes et adhérents, en franchise devant les autres salarié∙es, en maintenant toujours le lien entre le concret de la situation des personnes au quotidien et la projection envisagée et mise en débat. Et alors, la pression sur les possédants devra être constante, et il faudra toujours essayer de l’élargir. Cet élargissement possible du mouvement à d’autres pays sera un élément important pour le rapport de force. Déjà, dans le passé, nous avons vu des poussées populaires converger dans le temps, et s’aider, se stimules les unes les autres, et aussi affaiblir l’adversaire commun, en 1848 et en 1968 notamment.
Avant 1981, l’illusion avait grandi tout au long des années qu’il suffisait d’une victoire électorale pour changer la vie. En 1974, Georges Marchais mettait en garde : « Nous provoquerions, même si on l’emportait dans ces conditions, des désillusions et on ferait reculer le mouvement ouvrier chez nous de cinquante ans au moins ». C’est chose faite avec la façon dont s’est déroulée le 10 mai 1981.
Gérard Gourguechon
[1] Parti communiste français. Parti socialiste. Mouvement des radicaux de gauche.
[2] De 1981 à 1986, « L’Europe des dix », qui deviendra ultérieurement l’Union européenne compte les pays suivants : Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Irlande, Royaume-Uni, Grèce.
[3] Le Centre d’études, de recherches et d’éducation socialiste est alors un courant qu’on situe dans la gauche du Parti socialiste, animé notamment par Jean-Pierre Chevènement.
[4] Avec toutes les limites de la réalité de celle-ci : voir « 1962-1984 : la CGT et le Programme commun de gouvernement », dans ce numéro.
[5] Charles Fiterman est ministre des Transports dans les 2ème et 3ème gouvernements Mauroy, donc de juin 1981 à juillet 1984. Il avait rang de ministre d’Etat de juin 1981 à mars 1983.
[6] La Fédération de l’éducation nationale, restée dans l’autonomie depuis 1947 lors de la scission CGT/FO, est largement majoritaire dans son secteur et souvent associée aux discussions et appels CGT et CFDT. Elle éclate en 1992 avec la création de la FSU, la FEN maintenue s’intégrant l’année suivante à l’UNSA (aujourd’hui UNSA-Education).
[7] Fédération autonome des syndicats de police, Fédération générale autonome des fonctionnaires, Fédération maitrises et cadres (SNCF), Fédération générale des syndicats des salariés, ouvriers et cadres d’organisations professionnelles agricoles. Autant d’organisations qui participeront à la création de l’UNSA et qui pour certaines en sont toujours membres, parfois sous des noms qui ont évolué depuis.
[8] Fédération générale des salariés des organisations professionnelles de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire, Syndicat national unifié des impôts, Syndicat national des journalistes, Fédération générale autonome des fonctionnaires, Fédération autonome de la Défense nationale, Fédération générale autonome des agents de conduite (FGAAC), Fédération autonome des transports, Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien, Fédération autonome des syndicats de police, Syndicat unifié des Caisses d’épargne.
[9] Ces trois aspects sont développés dans le texte intégral de Gérard qui sera ultérieurement publié.
