Une histoire syndicale de l’environnement
Selon un lieu commun persistant, revendications environnementales et organisations syndicales ne se seraient jamais conjuguées. En apparence inoffensif, ce préjugé nourrit pourtant une autre (fausse) évidence, autrement plus pernicieuse : si l’environnement ne préoccupa nullement les syndicats, alors ces derniers devraient se mettre à l’école d’acteurs extérieurs à leurs rangs (administrations, associations, etc.) afin de penser leur action environnementale.
Or, d’une part, cette approche conduit à nier le fait que les enjeux environnementaux sont l’objet de tensions entre groupes sociaux1. La définition même de l’environnement reflète toujours les aspirations d’une classe sociale : l’environnement des travailleurs-euses se compose d’objets et de préoccupations qui ne sont pas ceux qui fondent la politique écologique du patronat ou des pouvoirs publics. D’autre part, ce lieu commun d’un mouvement syndical indifférent à l’environnement reflète une réflexion repliée sur l’instant présent, induisant une amnésie historique. En effet, le passé environnemental du mouvement syndical est original et les confédérations ouvrières n’ont pas attendu l’invention d’un ministère dédié (1971) pour s’en préoccuper2.
Des limites du consensus productiviste (1944 aux années 1960)
 Au cours des années d’après-guerre, le mouvement syndical nourrit un intérêt pour l’environnement, à partir de trois enjeux ancrés dans ses missions constitutives. Premièrement, les effets sanitaires des produits utilisés dans le travail sont l’objet d’une attention ancienne. Les lois sociales de la Libération semblent concrétiser une série de mesures revendiquées par les organisations syndicales, à commencer par l’instauration d’un service de médecine du travail (loi du 1946) ou le classement de plusieurs pathologies dans le tableau des maladies professionnelles (MP), à commencer par la silicose (l’une des maladies les plus meurtrières du siècle, provoquée par l’inhalation de poussières de charbon). Toutefois, cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre juridique de la loi sur les MP (1919), qui consacrait une logique de compensation financière des risques au détriment de la prévention des facteurs pathogènes. La préoccupation syndicale pour les retombées des substances nocives trouve ainsi une première limite : sans recours juridiques plus satisfaisants, ce dispositif trouvait l’assentiment des syndicats parce qu’il permettait d’obtenir une reconnaissance minimale des préjudices sanitaires rencontrés par les salarié-es.
Au cours des années d’après-guerre, le mouvement syndical nourrit un intérêt pour l’environnement, à partir de trois enjeux ancrés dans ses missions constitutives. Premièrement, les effets sanitaires des produits utilisés dans le travail sont l’objet d’une attention ancienne. Les lois sociales de la Libération semblent concrétiser une série de mesures revendiquées par les organisations syndicales, à commencer par l’instauration d’un service de médecine du travail (loi du 1946) ou le classement de plusieurs pathologies dans le tableau des maladies professionnelles (MP), à commencer par la silicose (l’une des maladies les plus meurtrières du siècle, provoquée par l’inhalation de poussières de charbon). Toutefois, cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre juridique de la loi sur les MP (1919), qui consacrait une logique de compensation financière des risques au détriment de la prévention des facteurs pathogènes. La préoccupation syndicale pour les retombées des substances nocives trouve ainsi une première limite : sans recours juridiques plus satisfaisants, ce dispositif trouvait l’assentiment des syndicats parce qu’il permettait d’obtenir une reconnaissance minimale des préjudices sanitaires rencontrés par les salarié-es.
Deuxièmement, l’usage des ressources naturelles est l’objet d’une observation attentive de la part des syndicalistes (y compris à des fins de conservation), dans la mesure où elles sont perçues comme le soubassement de l’économie. Les années d’après-guerre sont l’occasion des nationalisations des secteurs de l’économie recourant amplement à l’extraction de ressources naturelles, à commencer par les industries énergétiques (charbon, électricité et gaz en 1946). Ces nationalisations sont réalisées sous la houlette du ministre de la production industrielle, Marcel Paul, également secrétaire de la fédération CGT de l’éclairage. À l’échelle confédérale, la CGT appuie alors une politique de grands travaux (construction de barrages), aspirant à une expansion continue de la production d’électricité fondée sur « l’asservissement de la nature ». En paraphrasant Lénine et en témoignant de l’influence du productivisme soviétique, la CGT explique que « l’électrification plus la démocratie égale l’indépendance de la France et le bonheur du peuple ». De fait, dans l’après-guerre et jusqu’aux années 2000, la CGT nourrit le sentiment d’être en partie dépositaire de « l’esprit » d’EDF, c’est-à-dire d’une entreprise nationalisée guidée par l’idéal d’un service public rendant l’énergie accessible à coût modique sur l’ensemble du territoire. Cette croyance nourrit amplement le productivisme cégétiste et ne paraît s’éroder que sous l’effet des mesures de privatisation dans les années 2000.
Enfin, toutes les organisations syndicales nourrissent un intérêt régulier pour l’aménagement des lieux de vie des salarié-es. Cette préoccupation se manifeste par des demandes de réorganisation des réseaux de transports ou par l’organisation de colonies de vacances afin de permettre aux enfants des quartiers pollués d’accéder à « l’air pur ». D’une part, ces réflexions conduisent à alerter sur l’exposition inégale des groupes sociaux aux pollutions : dans des débats menés au Conseil économique et social au début de la décennie 1960, les représentants CGT et CFTC soulignent que les classes populaires vivant dans le XIIIe arrondissement parisien (alors fortement industrialisé) ou dans la vallée de la Maurienne (marquée par l’industrie d’aluminium) sont plus exposées aux violences environnementales que les classes aisées – qui disposent, en outre, de moyens financiers pour se soustraire aux pollutions. Le terme « d’inégalités environnementales » n’apparaît pas encore, mais sa logique est bien présente. D’autre part, des militant-es imaginent des utopies urbaines : Maurice Belorgey, syndicaliste du bâtiment (CFTC-CFDT), forge la notion de « dédensité » qu’il oppose à la concentration urbaine. Il propose de « retourner délibérément à la nature, d’abandonner le système des grandes villes, et même celui des villes nouvelles où l’on réserve quelques ”espaces verts” étriqués. On ne peut retrouver la nature que dans de petites cités-villages, dont chacune sera entourée d’une grande superficie de campagne. C’est là le principe de la dédensité ». En conciliant une faible concentration démographique et une aspiration à assurer les productions essentielles localement, Maurice Belorgey défendait également « une décroissance des transports ».
Si le mouvement syndical des années d’après-guerre n’est pas « écologiste avant l’heure », il est toutefois bien conscient des inégalités environnementales. Ces préoccupations rencontrent toutefois des limites, à commencer par le cadre juridico-administratif qui fragmente l’action entre l’espace de travail et son environnement, ainsi que l’adhésion totale et sans critiques aux lois sociales de la Libération – en dépit de leurs impensés sociaux et environnementaux.
Un « environnementalisme ouvrier »
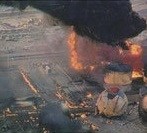 En janvier 1966, la raffinerie de pétrole de Feyzin (au sud de Lyon) explose, provoquant dix-huit décès. Cet événement apparaît traumatique pour les syndicats qui interrogent leurs modalités d’action dans et autour de ces établissements. En effet, cette déflagration affecte particulièrement les quartiers populaires environnants. Par-delà les revendications immédiates (service de sécurité propre au site, délégation permanente des syndicats dans le CHS, etc.), CFDT et CGT repensent leur action à l’échelle du territoire, afin de lutter contre les produits délétères aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des lieux de travail. D’un côté, la CGT soutient la fondation d’une Association pour la défense de la nature et la lutte contre les pollutions de la vallée du Rhône en 1971, animée par des élus communistes, dont Camille Vallin (qui sera à l’origine de la fondation du Mouvement national de lutte pour l’environnement, MNLE dont la CGT est membre fondateur en 1982). Les sections CGT de la chimie fournissent ponctuellement des informations sur les pollutions récurrentes, permettant à l’association d’entamer des procès contre des industries chimiques de la vallée du Rhône. De l’autre côté, la CFDT forme des Unions Interprofessionnelles de Base (UIB) : contrairement aux UL, les UIB ne sont pas un simple outil de coordination entre sections syndicales d’entreprises, mais rassemblent des membres des classes populaires (incluant des non-salarié-es) en vue d’agir sur un territoire. Selon la responsable d’une UIB du Rhône :
En janvier 1966, la raffinerie de pétrole de Feyzin (au sud de Lyon) explose, provoquant dix-huit décès. Cet événement apparaît traumatique pour les syndicats qui interrogent leurs modalités d’action dans et autour de ces établissements. En effet, cette déflagration affecte particulièrement les quartiers populaires environnants. Par-delà les revendications immédiates (service de sécurité propre au site, délégation permanente des syndicats dans le CHS, etc.), CFDT et CGT repensent leur action à l’échelle du territoire, afin de lutter contre les produits délétères aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des lieux de travail. D’un côté, la CGT soutient la fondation d’une Association pour la défense de la nature et la lutte contre les pollutions de la vallée du Rhône en 1971, animée par des élus communistes, dont Camille Vallin (qui sera à l’origine de la fondation du Mouvement national de lutte pour l’environnement, MNLE dont la CGT est membre fondateur en 1982). Les sections CGT de la chimie fournissent ponctuellement des informations sur les pollutions récurrentes, permettant à l’association d’entamer des procès contre des industries chimiques de la vallée du Rhône. De l’autre côté, la CFDT forme des Unions Interprofessionnelles de Base (UIB) : contrairement aux UL, les UIB ne sont pas un simple outil de coordination entre sections syndicales d’entreprises, mais rassemblent des membres des classes populaires (incluant des non-salarié-es) en vue d’agir sur un territoire. Selon la responsable d’une UIB du Rhône :
« à force de prioriser l’action sur le lieu de production, on arrive à oublier l’action nécessaire dans le cadre de vie. Le syndicalisme dans la seule entreprise, c’est le risque de l’intégration à l’entreprise et à l’économie libérale. Par contre, le syndicalisme interprofessionnel rassemble les salariés (…) afin de les aider à prendre en charge tous les aspects de leur cadre de vie. »
Dans la confédération CFDT, les UIB sont un temps perçues comme des outils pour « un élargissement du champ d’intervention » et des expériences similaires sont menées dans plusieurs régions (en Bretagne, le sigle UIB devient « Union de Pays »). Surtout, la formation de ces structures territoriales se produit simultanément à l’élaboration d’une réflexion cédétiste sur le « cadre de vie ». Ce terme est rapidement utilisé pour contester celui « d’environnement » au moment de la fondation du ministère du même nom (1971). Pour les cédétistes, le mot « environnement » correspond à une notion « fourre-tout » née de pratiques technocratiques, alors que la notion de « cadre de vie » reflète le vécu des salarié-es.
Enfin, la réflexion sur le cadre de vie réfute une approche environnementale qui se fonderait sur la protection d’une « nature » sauvage, mythifiée et éternelle. Au contraire, le cadre de vie est un environnement incessamment reconstruit par des choix sociaux, dans une interaction constante entre les sociétés et les éléments biophysiques (ou “naturels”). Dans cette perspective, la défense du cadre de vie met en cause d’abord les critères d’aménagement du territoire et d’organisation de la production dans les industries polluantes. Une réflexion critique du productivisme s’affirme ainsi dans les analyses proposées par Frédo Krumnow, alors secrétaire confédéral de la CFDT :
« la production [façonne] elle-même (…) le modèle de civilisation sans tellement tenir compte des besoins réels des gens. Quand on dit que la production commande le développement du modèle de société, ça veut dire qu’on ne veut pas, pour des raisons de rentabilité, tenir compte de tous les éléments de nuisance autant humains que matériels (…) et, en plus, on a la volonté d’individualiser la consommation. (…) Nous pensons qu’il faut intercaler une structure de décisions démocratique au niveau du lancement du modèle de société. C’est tout le problème de savoir comment dans le cadre de la planification démocratique, on arrivera à mettre sur pied une procédure qui permette avant qu’un produit ne soit lancé (…) de tenir compte des besoins mais aussi des éléments de nuisance »
Dans cette perspective, répondre aux enjeux environnementaux impose de rompre avec les dynamiques capitalistes de croissance de la production et d’individualisation de la consommation. Au contraire, la CFDT oppose alors la nécessité d’associer les salarié-es et la population à une définition démocratique des productions à partir de leurs besoins essentiels. Ce thème s’inscrit en conformité avec le projet syndical de socialisme autogestionnaire : « quand la CFDT se bat pour la démocratisation de l’entreprise (…), ce n’est pas pour laisser le profit régner hors de l’entreprise. La démocratisation du cadre de vie et sa mise en autogestion relèvent du même combat ».
De la santé au travail à la santé environnementale
Le déplacement vers le territoire est aussi pensé par les syndicalistes impliqué-es sur les enjeux de santé au travail. En 1971, l’UD-CFDT du Rhône affirme d’emblée que « l’hygiène et la sécurité doivent être imposés comme faisant partie intégrante : de la production dans l’entreprise ; de l’environnement hors de l’entreprise ». La pollution industrielle est désignée comme un désagrément propre aux « agglomérations ouvrières situées près des complexes industriels ».
Toutefois, la première moitié de la décennie 1970 est surtout marquée par l’éclosion de conflits en santé au travail portés par des travailleurs-euses immigrant-es, souvent peu syndiqué-es et rencontrant des difficultés pour faire reconnaître leurs droits à l’indemnisation des MP. Pour cette raison, ces salarié-es mettent en cause le paradigme de la compensation financière des risques. Dans les conflits de Penarroya à Lyon (exposition au plomb) ou Amisol à Clermont-Ferrand (amiante), ces ouvrier-es obtiennent le soutien actif de médecins militant-es, avec lesquels ils-elles élaborent collectivement une expertise sur leur situation sanitaire. De plus, des réseaux de scientifiques militant-es (comme le Comité de liaison pour la sécurité et l’amélioration des conditions de travail – CLISACT, etc.) renforcent les liens entre salarié-es et riverains des industries, en soutenant plusieurs conflits à la croisée de la santé au travail et de la santé environnementale.
 Initialement bousculées par ces conflits, les organisations syndicales s’impliquent peu à peu, jusqu’à se saisir de ces rencontres scientifiques-salarié-es pour repenser leur intervention. Ainsi, la fédération CFDT chimie fonde un « Groupe Produits Toxiques » (GP-Tox) en 1974, réunissant des scientifiques et des syndicalistes, dont la mission est de fournir une expertise sur les produits délétères dans l’espace de travail et en intégrant une « préoccupation du cadre de vie (pollution, effet sur le consommateur, etc.) ». De la même manière, ingénieur-es et ouvrier-es du syndicat CFDT de l’énergie nucléaire rédigeront Le dossier électronucléaire (1975) et produiront le film Condamnés à réussir (1977), qui deviennent des supports de référence pour les opposant-es au programme nucléaire au cours de la décennie 1970.
Initialement bousculées par ces conflits, les organisations syndicales s’impliquent peu à peu, jusqu’à se saisir de ces rencontres scientifiques-salarié-es pour repenser leur intervention. Ainsi, la fédération CFDT chimie fonde un « Groupe Produits Toxiques » (GP-Tox) en 1974, réunissant des scientifiques et des syndicalistes, dont la mission est de fournir une expertise sur les produits délétères dans l’espace de travail et en intégrant une « préoccupation du cadre de vie (pollution, effet sur le consommateur, etc.) ». De la même manière, ingénieur-es et ouvrier-es du syndicat CFDT de l’énergie nucléaire rédigeront Le dossier électronucléaire (1975) et produiront le film Condamnés à réussir (1977), qui deviennent des supports de référence pour les opposant-es au programme nucléaire au cours de la décennie 1970.
Ces analyses essaiment largement : le conflit de Penarroya provoque ainsi plusieurs répliques dans des usines utilisant du plomb à Marseille ou en Île-de-France. Il mène également des UIB CFDT à contester l’implantation d’usines chimiques utilisant du plomb à Marckholsheim (Bas-Rhin), en occupant physiquement le lieu prévu pour l’implantation de l’usine. Lorsque l’industriel envisage de déplacer le projet vers Guengat (Finistère), l’UD CFDT y recycle l’argumentaire produit par le GP-Tox pour marquer son hostilité à une implantation pourvoyeuse de « dangers, tant pour les travailleurs que pour l’environnement (faune et flore) ».
De la contestation d’une substance nocive ou d’un procédé ancré dans un lieu de travail, l’échange entre salarié-es et scientifiques conduit progressivement à la mise en cause de l’ensemble d’une chaîne de production et de consommation. Dans la foulée de sa critique de l’expansion des industries nocives ou du nucléaire, la CFDT alerte sur « les dégâts du progrès3 » et entrevoit « un autre mode de développement ».
Le dilemme « emploi-environnement » : stratégie industrielle et carcan juridico-administratif
Jusqu’au milieu des années 1970, le chômage reste faible et rend improbable le « chantage à l’emploi », qui parait aujourd’hui si présent dès qu’un syndicat agit en matière d’environnement. Pour beaucoup, ce dilemme serait uniquement le produit d’une stratégie industrielle. En effet, cette rhétorique incite les salarié-es à défendre « l’outil de production existant » au nom de « l’emploi », en opérant une confusion entre ces deux termes. De plus, cette rhétorique divise salarié-es et riverains ou écologistes. Pourtant, expliquer ce dilemme comme le simple produit d’une stratégie industrielle confère non seulement une bien grande capacité d’imagination au patronat, mais elle néglige surtout des facteurs plus durables et moins spectaculaires, qui sont à identifier dans les traditions juridiques et l’organisation des administrations publiques.
Par exemple, au lendemain de l’explosion de l’usine chimique Givaudan-France à Lyon (provoquant un décès et plusieurs blessés), le 29 juin 1979, l’UIB-CFDT provoque une réunion des salarié-es, des riverains, des partis politiques et d’un représentant du CLISACT. Ensemble, ils et elles dénoncent « l’opposition fiction » entre emploi et environnement, l’UIB expliquant que « la lutte permanente pour les conditions de travail dans l’entreprise est inséparable de celle qui doit être menée pour l’amélioration du cadre de vie (…). Ces deux approches sont les deux faces d’une même réalité : l’exploitation par le système capitaliste du citoyen-travailleur ».
Ces différentes organisations entament une enquête collective, appuyée par l’expertise du CLISACT et du GP-Tox, au cours de laquelle il apparaît que des responsables juridiques distincts (inspection du travail, inspection des établissements classés, collectivités locales, etc.) s’appuient sur un « maquis de réglementations, souvent contradictoires », qui permettent de « noyer le poisson de la responsabilité ». Or, cette multiplicité de compétences est facteur de division parmi les groupes mobilisés : lorsque les salarié-es se réfèrent au droit du travail, les écologistes usent prioritairement du droit de l’environnement. Cette démarcation est renforcée par la faible communication entre une administration publique du travail dont la culture est d’abord fondée sur une formation juridique, alors que l’administration de l’environnement dispose d’une formation plus technicienne (et souvent plus proche des industriels).
Dès lors, le dilemme « emploi-environnement » s’appuie d’abord sur des dispositifs étatiques qui fragmentent certains textes juridiques et pratiques administratives. Les stratégies industrielles de « chantage à l’emploi » ne font qu’instrumentaliser cette séparation des lois, dans l’écart desquels se renforce l’autorité de l’employeur sur l’organisation de la production, bien que quelques dispositifs (à commencer par les CHS-CT) confèrent aux salarié-es des possibilités d’expression et d’alertes sur les retombées environnementales de la production.
La justice climatique, le nouveau défi du syndicalisme
 Au cours des dernières années, le mouvement syndical a repris l’initiative en matière environnementale, dans la foulée du Sommet de Copenhague sur le climat (2009). De fait, le décalage majeur entre l’intervention environnementale des années 1960-70 et les années 2000 réside dans l’émergence du réchauffement climatique comme problème politique. Le mouvement syndical est désormais contraint de penser son projet de transformation sociale dans les limites de cette configuration nouvelle, en liant transformation sociale et réponse au basculement climatique.
Au cours des dernières années, le mouvement syndical a repris l’initiative en matière environnementale, dans la foulée du Sommet de Copenhague sur le climat (2009). De fait, le décalage majeur entre l’intervention environnementale des années 1960-70 et les années 2000 réside dans l’émergence du réchauffement climatique comme problème politique. Le mouvement syndical est désormais contraint de penser son projet de transformation sociale dans les limites de cette configuration nouvelle, en liant transformation sociale et réponse au basculement climatique.
Si l’ampleur du défi actuel est certainement incomparable avec les expériences passées, il n’en reste pas moins que le mouvement syndical dispose d’une histoire incluant des pratiques et des réflexions environnementales pour forger son intervention présente. Le constat des inégalités environnementales persistantes permet d’attirer l’attention afin que la transition vers un système de production et de consommation soutenable soit réalisée en tenant compte des aspirations des salarié-es. De plus, la capacité d’intervenir à l’échelle des territoires pour mettre en cause les productions climaticides, en outrepassant les séparations juridico-administratives entre l’espace du travail et son environnement pour mieux lier salarié-es et non-salarié-es, pourrait constituer l’un des leviers les plus originaux et les plus efficaces pour que le mouvement syndical reprenne l’initiative dans une lutte pour la justice climatique.
1Sur la définition conflictuelle de l’environnement en fonction des classes et groupes sociaux, Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille. Essai d’écologie politique, Paris, Zones, 2014 ; Émilie Hache (dir.), Écologie politique. Cosmos, communautés, milieux, Paris, éditions Amsterdam, 2012.
2Pour ne mentionner que les travaux les plus accessibles en français sur le sujet, voir Descolonges M. (dir.), « Syndicats et transition écologique », Écologie et Politique, n°50, 2015 ; Podcast de la journée d’études L’environnement des travailleurs au XXe siècle, Paris, 26 juin 2013. En ligne : http://leruche.hypotheses.org/2036 ; Flipo F., Edouard M., Grisoni A., Felli R. (dir.), « Le travail contre nature ? Syndicats et environnement », Mouvements, 80, 2014 ; Descolonges M, Les démarches de la CGT en matière d’environnement. Droits nouveaux et enjeux d’apprentissage, Paris, IRES, 2011 ; Kahle T., « Un environnementalisme par la base », Contretemps Web, 6 octobre 2014 ; Barca S., « Travailleurs et écologistes de tous les pays, unissez-vous ! », Contretemps Web, 23 juin 2014. En ligne : www.contretemps.eu
3CFDT, Les dégâts du progrès, Paris, Seuil, 1977.
- Une histoire syndicale de l’environnement - 19 mars 2017



