Financement de la Sécurité sociale et lutte de classes.
Il faut placer la question du financement de la sécurité sociale dans le cadre de la lutte de classes pour comprendre les débats et les combats qui s’y rattachent. La question de la Sécurité sociale et celle de son financement sont des points d’affrontement essentiels dans la lutte de classes. Les réponses qui y sont apportées déterminent le niveau des solidarités mises en place, l’étendue de leur champ et le niveau des prises en charge. Les solutions retenues éclairent aussi sur l’apport respectif des différents contributeurs (travailleurs et détenteurs du capital). Décider des recettes de la Sécurité sociale, c’est décider de l’application concrète du principe qui voudrait qu’en matière de solidarité « chacun contribue en fonction de ses moyens », pour qu’ensuite « chacun reçoive en fonction de ses besoins ».
Les revanchards à l’offensive
En France, depuis le milieu des années 1980, celles et ceux qui, en 1945-1946, faisaient profil bas, ont plus que relevé la tête : ils et elles sont passés à l’offensive et ont attaqué tous azimuts contre « l’Etat social ». C’est ce que nous précisait déjà Denis Kessler, alors vice-président du Medef en 2007 : « Le modèle social français est le pur produit du Conseil National de la Résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer, et le gouvernement s’y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d’importance inégale, et de portées diverses : statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la Sécurité sociale, paritarisme… A y regarder de plus près, on constate qu’il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes ? C’est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance ! A l’époque se forge un pacte politique entre les gaullistes et les communistes. Ce programme est un compromis qui a permis aux premiers que la France ne devienne pas une démocratie populaire, et aux seconds d’obtenir des avancées – toujours qualifiées d’« historiques » – et de cristalliser, dans des codes ou des statuts, des positions politiques acquises ».
Les principaux détenteurs du capital sont désormais en mesure de remettre en cause ce modèle d’organisation politique également connu sous le nom d’Etat providence, basé sur l’accord entre travailleurs.ses (le plus souvent, leurs « représentant.es ») et capitalistes, selon lequel les premiers renoncent à la lutte pour la révolution socialiste, en échange du mieux-être social et de l’augmentation des niveaux de vie. Dans un tel compromis, les gouvernements engagent une série de mesures sociales, qui visent à calmer les ardeurs insurrectionnelles des travailleurs et travailleuses, par un « Etat social », c’est-à-dire par l’allocation de ressources pour le travail : éducation, santé, sécurité sociale, loisirs, sports, aides pour les transports en commun et les loyers, etc. Tout ceci entraîne une redistribution des revenus en faveur du travail et au détriment du capital. Très souvent, un cadre législatif et réglementaire impose des restrictions au droit de propriété des détenteurs du capital dans les entreprises elles-mêmes : application d’un droit du travail limitant les conditions d’exploitation (conditions de travail, conditions d’emploi, salaire minimum, etc.) et nationalisation de certaines entreprises (pour aider certains secteurs utiles à l’ensemble du système économique, en y accordant plus de droits aux salariés). Mais la condition de cet Etat social, c’est tout à la fois une démocratie délégataire et représentative et le maintien de la propriété privée des moyens de production.
Le compromis de 1945 et son évolution dans les premières années qui ont suivi

Ce qui s’est passé en France en 1945-1946, correspond plus globalement au compromis social passé dans un certain nombre de pays développés occidentaux dans la même période. Roosevelt1 avait donné l’exemple avec son New Deal, appliqué entre 1933 et 1938 pour relancer l’économie des Etats-Unis après le krach de 1929 et la Grande Dépression qui a suivi aux Etats-Unis. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans plusieurs pays, les forces en guerre contre l’Allemagne nazie imaginaient déjà, en cas de victoire, ce qu’elles feraient de celle-ci. Beveridge, l’auteur du rapport intitulé « Social Insurance and allied services », publié en Grande-Bretagne en novembre 1942, écrira « … En abolissant toutes les barrières, la guerre crée la possibilité de faire œuvre neuve. Une époque révolutionnaire comme celle que le monde traverse actuellement appelle, non des replâtrages, mais des transformations révolutionnaires ». Beveridge a voulu tirer profit de la situation en fondant son plan sur l’unité nationale née de la guerre (la Grande-Bretagne n’a pas été vaincue ni occupée, et les forces de collaboration ou d’acceptation du projet nazi y étaient très minoritaires). Avec son plan, Beveridge entendait maintenir, voire renforcer cette unité nationale après la guerre grâce à l’universalité et à l’unité du système de Sécurité sociale. Pendant le même temps, les résistantes et les résistants du CNR élaboraient un projet, pour après la victoire. Et Pierre Laroque, que les Français appellent le « père fondateur de la Sécurité sociale », et que les auteurs anglo-saxons qualifient de « Beveridge français », expliquera en 1955 que la période de 1945-1946 était favorable en France à une réforme d’envergure.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les économies capitalistes occidentales ont immédiatement fait appel à « toutes les forces vives de la Nation » pour relancer la production. Un minimum de consensus social a été jugé nécessaire pour y parvenir. Ceci s’est fait par ailleurs sous l’impulsion des Etats-Unis qui, par leur stratégie politique d’endiguement, décident de stopper l’extension de la zone d’influence soviétique au-delà de ses limites atteintes en mars 1947 et de contrer les Etats susceptibles d’adopter le « communisme ». Les dollars envoyés avec le Plan Marshall vont être l’illustration de cette politique. Tout ceci sera le début de la guerre froide, avec le refus de l’URSS et de ses Etats satellites de recevoir les dollars américains. C’est dans ce cadre que, notamment, les systèmes de Sécurité sociale ont été améliorés, qu’ils reposent principalement sur des cotisations ou principalement sur des impôts (comme en Grande-Bretagne avec le système beveridgien inspiré du rapport Beveridge de novembre 1942). Ce compromis social historique est aussi à replacer dans le cadre de la tension entre le noyau dur des pays capitalistes et les pays du « communisme réellement existant ». Ces raidissements ont été rendus plus visibles dès le refus de l’URSS de s’inscrire dans le Plan Marshall. Les gouvernements occidentaux ont été amenés à « lâcher du lest » pour montrer à leurs classes ouvrières que le système capitaliste leur était plus profitable que le rêve communiste, particulièrement en Europe occidentale dès la mainmise de l’URSS sur l’Europe de l’Est. L’exemple qui illustre le plus cette concurrence du capitalisme d’avec le « communisme » est celui de l’Allemagne de l’Ouest, la République Fédérale d’Allemagne (RFA), où une place importante a été accordée à l’Etat social, avec, tout particulièrement, un rôle accordé aux organisations syndicales, tant dans l’entreprise (cogestion) que dans la gestion économique et sociale du pays. Les comparaisons qui pouvaient être faites au sein des familles soudainement séparées par un « rideau de fer » ne pouvaient qu’être favorables à la gestion capitaliste.
Le compromis de 1945 devenu obsolète du fait de la libération du capital

Le compromis restait bien entendu un compromis, donc un état d’équilibre instable. Une grande partie du patronat français, et, au-delà, du patronat des pays les plus développés, a toujours vécu cette situation comme un état provisoire et transitoire, en attendant des jours meilleurs plus favorables à leurs pouvoirs, leurs profits et leurs privilèges. Ceci s’est fait par une bataille culturelle, en parvenant progressivement à survaloriser les idées de liberté d’entreprendre, puis de liberté de circulation des capitaux, de plus en plus totale et globale, puis de liberté de circulation des marchandises et des services, avec de moins en moins de normes à respecter et de moins en moins de contrôles aux frontières, lesquelles ne sont maintenues que pour une majorité de l’humanité, les minorités privilégiées se jouant de ces pointillés sur les mappemondes ! Pendant le même temps, la fin du « communisme réellement existant », à partir de la chute du Mur de Berlin en novembre 1989, puis de l’implosion de l’URSS, a permis à la domination du capital de s’exprimer encore plus fortement : il devenait moins nécessaire de s’autolimiter dans l’exploitation des travailleurs et travailleuses, dès lors qu’il n’y avait « plus d’alternative2 », que n’existait plus le risque que des majorités politiques changeantes fassent basculer un Etat « de l’Ouest » vers le « communisme ». L’existence de pays dits communistes avait plus ou moins « aidé », dans les pays capitalistes, celles et ceux qui voulaient résister aux excès du capitalisme, du fait de cette peur de certains gouvernements d’un basculement politique dans leur pays. Mais cette existence du communisme tel que pratiqué en URSS et dans les Etats satellites avait aussi empêché toute victoire sociale décisive dans les pays occidentaux, la réalité globale des « pays de l’Est » étant trop peu attractive dans de multiples domaines pour qu’une majorité de la population d’un « pays de l’Ouest » aspire réellement à de telles orientations, cependant qu’une partie de celles et ceux qui se croyaient progressistes étaient captés par le suivisme à l’égard du Parti communiste de l’URSS.
Avec la progressive totale liberté de circulation des capitaux et la chute du Mur de Berlin, les détenteurs de capitaux ont pu multiplier leurs moyens de pression sur les apporteurs de travail. Ils ont pu croire qu’ils avaient définitivement gagné la partie. C’était ce à quoi rêvait Fukuyama3 quand, en 1992, il développait sa thèse sur « La fin de l’Histoire ». Les « partageux » étaient finis, et le marché libre avait triomphé, pour toujours. La concurrence libre et non faussée a pu être instituée en dogme régentant le monde, primant même progressivement les droits sociaux et les droits humains. Warren Buffet, milliardaire américain4, traduisait bien cette situation en 2005 en déclarant : « Il y a une guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner ».
Le seul retour sur les politiques menées par les différents gouvernements en France depuis une trentaine d’années, ne serait-ce qu’en matière de réforme des retraites, nous montre la continuité des attaques : en 1987, avec un gouvernement Chirac, les salaires portés au compte pour le calcul de la retraite ne sont plus revalorisés en fonction de la croissance des salaires mais en fonction de l’inflation ; en 1993, ce sont les pensions liquidées qui, chaque année, sont désormais indexées en fonction de l’inflation et le gouvernement Balladur porte la durée de cotisations de 37,5 années à 40 années dans le privé ; en 1995, Juppé veut notamment « aligner » le public sur le privé mais se heurtera à un fort mouvement de protestation ; en 2003, la loi Fillon termine le travail voulu par Juppé et aligne les retraites du public sur celles du privé ; en 2010, l’âge de liquidation est repoussé de 2 ans ; en 2014, une loi du gouvernement Hollande allonge encore la durée de cotisations pour une retraite à taux plein. La lecture de toutes ces réformes est simple : il s’agit de réduire les retraites versées, dans leur montant et dans leur durée. Toute cette continuité donne à un grand nombre de personnes le sentiment que ces évolutions sont inéluctables, voire normales, ou, au mieux, que nous n’arrivons pas à nous y opposer. En tout état de cause, le constat est aisé : au mieux, les mobilisations, quand elles réussissent, parviennent à retarder les régressions, mais celles-ci ont tout de même lieu. A chaque fois, la réforme est présentée comme étant celle qui va résoudre les difficultés, mais, dès qu’elle commence à être mise en application, les discours alarmistes ressortent, et le pilonnage continue. Face à ces attaques, une petite partie du mouvement syndical se donne l’illusion de résister, constatant tout de même qu’elle vole de défaites en défaites. Pendant le même temps, une majorité du salariat est sidérée, tétanisée, fait le gros dos. Cette impression qu’un rouleau compresseur vient progressivement écraser les « acquis sociaux » a encore été ressentie au cours des plus récentes années avec la séquence des attaques contre le droit du travail. La loi travail I, dite loi El Khomri, a permis d’inverser les normes en matière de durée du travail. Et la loi travail II a complété avec l’inversion des normes en matière de rémunération.
Tout ceci devrait nous éclairer : pour les détenteurs du capital, le compromis social de 1945 n’est bien qu’un chiffon de papier. De notre part, s’accrocher au compromis de 1945, ce serait demander aux capitalistes de respecter leur engagement d’il y a 75 ans ! Ce serait nier le fait que ce sont des rapports de forces qui permettent ensuite d’établir un nouvel équilibre, qui durera, lui aussi, « un certain temps ». Dans l’affrontement actuel, nous devrions certainement faire état de nos exigences actuelles, en matière de démocratie, d’intervention directe du peuple, en matière de partage des richesses, de rôle des producteurs et productrices dans l’entreprise et dans l’économie, de solidarités nationales et internationales, d’équilibre entre production et consommation, de prise en compte de l’environnement et de l’élargissement de la vie. Tout commence par une bataille culturelle à engager, et à gagner, autour d’un projet de société émancipateur qui permettrait de fédérer les désirs et les volontés.
Le compromis politique et social de 1945 à travers la question du financement de la Sécurité sociale

C’est par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, qu’un système général de Sécurité sociale a été mis en place en France. Il y a donc près de 75 ans. La commémoration n’est pas forcément une démarche dynamisante. Elle peut être un moyen de ressourcement. Les 13, 14 et 15 mars 2004, pour les 60 ans du programme du CNR, Attac avait organisé à Nanterre un rassemblement autour d’un certain nombre de personnalités de la Résistance, dont Claude Alphandéry, Raymond Aubrac, Philippe Dechartre, Stéphane Hessel, Maurice Kriegel-Valrimont et Lise London. Ceci avait été un moment privilégié d’échanges et de débats. L’Appel des Résistants du 15 mars 2004 nous disait : « Soixante ans plus tard (…) notre colère contre l’injustice est toujours intacte ». C’est l’utilité des retours sur le passé : éclairer l’avenir. Nous savons que tous les progrès sociaux, comme tous les reculs sociaux, sont le résultat de tensions et de conflits, de rapports de forces entre intérêts différents, entre visions opposées, voire contradictoires, de la société. L’exemple de la Sécurité sociale l’illustre parfaitement.
La marque du Conseil national de la Résistance (CNR).
Par la grande Histoire, nous savons que le CNR a été le regroupement des différents mouvements de résistance en France, réalisé par Jean Moulin, qui avait été mandaté par le Général De Gaulle à compter du 1er janvier 1942. La première réunion du CNR a eu lieu à Paris le 27 mai 1943, réunion à laquelle participent les représentants de 8 mouvements de résistance, 2 représentants des syndicats (CGT et CFTC) et 6 représentants de partis politiques (PCF, SFIO5, Radicaux, Démocrates-chrétiens, un parti de droite modérée et laïque, un parti de droite conservatrice et catholique). L’éventail était donc assez large. Il excluait toutes les forces collaborationnistes. Le regroupement se faisait sur l’opposition, y compris bien entendu par les armes, à l’occupant nazi et à l’appareil d’Etat du régime de Vichy. La volonté commune était le retour à la souveraineté nationale et à la démocratie. Le CNR a chargé un Comité général d’étude de préparer une plate-forme politique pour la France d’après la Libération. Les points essentiels en seront entérinés en novembre 1943 à Alger par le Général de Gaulle.
Le programme du CNR sera adopté le 15 mars 1944. Il comporte une partie intitulée « mesures à appliquer dès la Libération du territoire » qui constitue une sorte de programme de gouvernement. A ce titre, le programme comporte des mesures visant à réduire la mainmise des collaborationnistes sur le pays et des mesures de moyen terme comme le rétablissement du suffrage universel, les nationalisations et la Sécurité sociale. Ce programme représente le compromis auquel sont parvenues entre elles toutes les tendances représentées au sein du CNR. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les nationalisations, l’idée même de « nationalisation » est déjà conçue comme un recul pour le PCF (« Les nationalisations ne sont pas des mesures socialistes…La première condition de l’introduction du socialisme dans un pays, c’est l’institution d’un Etat socialiste »). Et la formule retenue dans le texte du CNR, « le retour à la Nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques », provoquera ensuite de vives controverses quand il s’agira de mettre en pratique cette disposition.Sur le plan social, le programme adopté par le CNR le 15 mars 1944 annonce « un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’Etat ». C’est tout ce qui est écrit dans le programme du CNR en matière de Sécurité sociale. Il est dit qu’il s’agit d’assurer ces moyens d’existence « à tous les citoyens », c’est donc bien un régime universel qui est envisagé, mais aucun projet plus précis ne sera adopté avant la Libération.
La période de la Libération : des gouvernements issus de la Résistance.
Par la grande Histoire encore, nous savons que dès le 3 juin 1944, le Gouvernement provisoire de la République française est devenu le gouvernement de la France, après la fin du Régime de Vichy de collaboration avec l’occupant nazi. Il perdurera jusqu’au 27 octobre 1946, avec l’entrée en vigueur des institutions de la Quatrième République. Le premier gouvernement De Gaulle débute le 10 septembre 1944. Il comporte essentiellement des ministres de la SFIO, du MRP, des Radicaux, et deux ministres du PCF (Charles Tillon, ministre de l’Air et François Billoux, ministre de la Santé publique). C’est Alexandre Parodi qui est ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Parodi a été maître des requêtes au Conseil d’Etat, résistant, et a succédé, en février 1944, à la tête du Comité Français de Libération Nationale auprès du CNR, à Emile Bollaert, qui lui-même avait succédé à Jean Moulin le 1er septembre 1943 (Jean Moulin est mort le 8 juillet 1943). En octobre 1944, Parodi confie à Pierre Laroque la Direction générale des assurances sociales au sein de son ministère avec pour mission de préparer la réforme. Pierre Laroque a commencé sa carrière politique en entrant, en 1931, au cabinet du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ; c’est ainsi qu’il va devenir un spécialiste des assurances sociales. Il entre au cabinet de René Belin, ministre de la Production industrielle et du Travail, du premier gouvernement de Vichy, en juillet 1940 mais est révoqué en octobre 1940 pour des origines juives. Il entre alors à l’organisation de résistance « Combat » et rejoint Londres en avril 1943. Il rentre en France en juin 1944 avec le général De Gaulle. En accord avec Alexandre Parodi, et s’inspirant du plan Beveridge, il va mettre en place la Sécurité sociale par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945. C’est seulement après un an de travaux, de discussions, de transactions, que des textes pourront être présentés à l’Assemblée consultative provisoire en août 1945. Deux ordonnances sont adoptées, le 4 octobre 1945 sur l’organisation de la Sécurité sociale, le 19 octobre 1945 sur les prestations. Par la suite, la mise en œuvre de ces ordonnances se fera notamment avec le deuxième gouvernement De Gaulle, le gouvernement Félix Gouin et le gouvernement Georges Bidault, en 1945 et 1946. Les ministres et les membres des ministères sont alors des personnes qui, toutes ou presque, sont issues de la Résistance. Ambroise Croizat, du PCF, poursuivra l’impulsion donnée à la mise en place de la Sécurité sociale pendant le temps où il sera ministre du Travail du Général De Gaulle, du 21 novembre 1945 au 26 janvier 1946, et ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 26 janvier au 16 décembre 1946 (gouvernement Gouin et Bidault) et du 22 janvier au 4 mai 1947 (gouvernement Ramadier, et fin de la participation communiste au gouvernement). Déjà, le 14 janvier 1944, Ambroise Croizat écrivait : « Dans une France libérée, nous libérerons le peuple des angoisses du lendemain ».

Le rapport de forces qui existe alors est donc essentiellement celui qui résulte de la libération du pays, libération grâce aux combats et aux actions des mouvements de résistance intérieure et libération grâce à l’intervention des forces armées alliées et grâce aux forces armées françaises (Français et étrangers6 volontaires engagés, ayant rejoint De Gaulle, soldats qu’on est allé chercher dans l’Empire colonial français et qui auront un rôle déterminant, notamment lors du Débarquement de Provence). Les mouvements de résistance intérieure regroupent des hommes et des femmes « de gauche » et aussi des hommes et des femmes « de droite ». Il faut relire le poème de Louis Aragon « La Rose et le Réséda » paru pour la première fois en mars 1943 pour mieux imaginer aujourd’hui la période : « Celui qui croyait au ciel / Celui qui n’y croyait pas / Tous deux adoraient la belle / Prisonnière des soldats / … / Tous les deux étaient fidèles / Des lèvres du cœur des bras / Et tous les deux disaient qu’elle / Vive et qui vivra verra / Celui qui croyait au ciel / Celui qui n’y croyait pas / Quand les blés sont sous la grêle / Fou qui fait le délicat / Fou qui songe à ses querelles / Au cœur du commun combat / (…) ». Ces mouvements de résistance disposent d’armes. Elles ont servi à combattre les Allemands et les forces françaises de collaboration. Elles sont un élément important du rapport de forces et les gouvernements s’efforceront rapidement de récupérer ces armes pour que « l’Etat » (et ceux qui sont à sa tête) retrouve son monopole de disposition des forces armées. Dans ce rapport de forces, toutes celles et tous ceux qui ont collaboré aux forces occupantes sont déconsidérés. Pendant un certain temps, toutes ces personnes se feront discrètes. Une grande partie du patronat est dans ce cas. Le poids de la CGT et du PCF dans les forces de résistance intérieure va marquer les orientations politiques des premiers gouvernements. Le rapport de force est aussi celui qui résulte des rapports militaires sur le terrain. L’Allemagne nazie a été battue grâce à l’action principale de l’URSS, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de son Empire colonial, et de troupes françaises. Les équilibres géopolitiques vont aussi peser dans les équilibres et les compromis politiques en France. Il faut avoir en tête que les accords de Yalta vont expliquer le comportement de Staline pendant un certain temps, et aussi celui des dirigeants du Parti communiste français qui s’inscrivent dans les décisions du PC de l’URSS (Maurice Thorez, Jacques Duclos, Benoît Frachon, etc.). Au sein du PCF, ils s’opposeront aux résistants plus soucieux d’indépendance à l’égard de l’URSS (principalement Charles Tillon, chef des FTP-FFI, et Ambroise Croizat, tous deux issus de la résistance et ministres communistes en 1945 et 1946).
Les ordonnances du 4 octobre 1945.
L’exposé des motifs de l’Ordonnance du 4 octobre 1945 donne bien la philosophie générale de la Sécurité sociale envisagée : « La Sécurité Sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain (…) Envisagée sous cet angle, la Sécurité Sociale appelle l’aménagement d’une vaste organisation nationale d’entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de grande généralité quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle couvre. Le but final à atteindre est la réalisation d’un plan qui couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité : un tel résultat ne s’obtiendra qu’au prix de longues années d’efforts persévérants (…) ».
L’article 1er de l’Ordonnance du 4 octobre indique : « Il est institué une organisation de la Sécurité Sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gains, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent. L’organisation de la Sécurité Sociale mesure dès à présent le service des prestations prévues par les législations concernant les assurances sociales, l’allocation aux Vieux Travailleurs Salariés, les accidents du travail et maladies professionnelles et les allocations familiales et de salaire unique aux catégories de travailleurs protégés par chacune de ces législations dans le cadre des prescriptions fixées par celles-ci et sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. Des ordonnances ultérieures procèderont à l’harmonisation desdites législations et pourront étendre le champ d’application de l’Organisation de la Sécurité Sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par les textes en vigueur ».
En ce qui concerne les ressources (on parle maintenant du « financement »), ce sont les articles 30 et 31 qui fixent les principes : « La couverture des charges de la sécurité sociale et des prestations familiales est assurée, indépendamment des contributions de l’Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations assises et recouvrées conformément aux dispositions ci-après ». « Les cotisations des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail sont assises sur l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires de chacune de ces législations (…) ». Les textes sont clairs : il est alors prévu un financement, d’une part par l’Etat (donc par l’impôt), d’autre part par des cotisations assises sur l’ensemble des revenus et des gains des personnes, et pas seulement sur les salaires des seuls salariés. Il était donc envisagé d’établir des cotisations (et pas des impôts) sur des revenus autres que des salaires.
Les textes sont clairs : l’objectif, à long terme, est de mettre en place une Sécurité sociale universelle, mais, en attendant, la Sécurité sociale ne concernera que les travailleurs.

La relecture des textes réellement retenus en 1944 et en 1945 devrait éviter de leur faire dire aujourd’hui autre chose que ce qu’ils disaient. La volonté politique était de garantir à chaque personne de pouvoir disposer des moyens de subvenir à sa subsistance et à celle de sa famille dans des conditions décentes. Ces ambitions ont été résumées ultérieurement par les 3 U (universalité, unité, uniformité), qui ont très rapidement suscité de nombreuses réticences. L’universalité figure déjà dans le texte du CNR de mars 1944, quand il précise que la Sécurité sociale doit concerner tous les citoyens. 18 mois plus tard, en octobre 1945, alors que le pays est maintenant libéré, et que les forces de la Résistance ont été « rentrées dans le rang », notamment en ayant rendu leurs armes (le 28 octobre 1944, le gouvernement provisoire de la République française ordonne, par décret, le désarmement des milices patriotiques, après l’incorporation des FFI – les Forces françaises de l’intérieur – dans l’armée régulière), la pression est moins forte et les particularismes commencent à se faire entendre. L’exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945 rappelle bien que le but est de couvrir l’ensemble de la population, pour l’ensemble des risques. Mais cette échéance paraît désormais lointaine, et l’article 1er parle seulement « des travailleurs », et plus « des citoyens7 », en ajoutant que des textes ultérieurs devront étendre le champ d’application de la Sécurité sociale à d’autres catégories de bénéficiaires.
En ce qui concerne le financement, les articles 30 et 31, nous l’avons déjà vu, font mention des « contributions de l’Etat ». On comprend mal, dès lors, les frayeurs de certains qui, aujourd’hui encore, tout en ne cessant de se référer « au CNR », rejettent toute idée de financement partiel de la Sécurité sociale par le biais de l’Etat (et, peut-être, de l’impôt). On ne comprend pas plus leur fixation sur un financement reposant uniquement sur une cotisation assise sur les salaires. En effet, l’article 31 annonce que les cotisations seront assises sur l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les bénéficiaires. Le fait que, finalement, seuls les « travailleurs » seront concernés par cette première Sécurité sociale, c’est donc un semi-échec dans ce qui n’était qu’un compromis ! Dans le débat qui, aujourd’hui encore, traverse notamment le mouvement syndical français, si nous déclarons que nous sommes pour une Sécurité sociale universelle, couvrant donc toutes les personnes vivant sur le territoire national, il nous faut dire que nous sommes pour que toutes ces personnes concourent au financement en fonction de l’ensemble de leurs revenus. Ceux qui, aujourd’hui, revendiquent une cotisation uniquement basée sur la masse salariale, devraient reconnaître qu’ils refusent l’universalisme et sont pour un système social spécifique aux seuls salariés, les autres catégories sociales (agriculteurs, professions libérales, commerçants, etc.) relevant d’autres régimes particuliers, sans parler des personnes sans emploi, sans activité professionnelle, qui n’auront qu’à aller voir ailleurs ! Et, dans le cadre de ce régime « salariés », il faut bien voir aussi que la limitation à la masse salariale, en ce qui concerne le financement « des travailleurs », résulte aussi d’un compromis « historique » propre à la période de la Libération. Par les accords de Yalta de février 1945, il a été décidé, entre les Etats-Unis et l’URSS, que la France resterait dans le monde capitaliste occidental. Dans le cadre d’une société capitaliste, le compromis appliqué par les premiers gouvernements a été de ne faire cotiser que les revenus du travail pour le financement de la Sécurité sociale des salariés. Il ne fallait pas faire appel aux revenus du capital, y compris ceux tirés du travail par l’exploitation capitaliste (les profits de l’entreprise tirés du travail de ses salariés). Il a été convenu qu’il fallait aider à la reconstruction de l’économie du pays, et donc favoriser l’investissement privé, et donc le capital privé. Au cours d’échanges avec M. Maurice Kriegel-Valrimont, en mars 2004, lors de la rencontre organisée par Attac, celui-ci nous a bien éclairé sur le sens du compromis alors accepté : « il ne s’agissait pas de tout bousculer ; pour le financement, nous allions continuer, en gros, comme avant, et il fallait reconstruire la France, aussi il a été retenu que les cotisations ne seraient établies que sur les salaires des entreprises ». Dès septembre 1944, le secrétaire général de la CGT, Benoît Frachon, a lancé la « bataille pour la production », et en 1945 le PCF porte le mot d’ordre : « Produire, c’est aujourd’hui la forme la plus élevée du devoir de classe ». Dans la même veine, Maurice Thorez déclarera en 1945 : « Retroussez vos manches. La grève est l’arme des trusts ». C’est là qu’il faut trouver l’explication de la non-contribution des revenus du capital au financement de la Sécurité sociale. Il s’agit bien, pour ces gouvernements, de participer à la « reconstruction nationale » d’un pays dont la structure reste capitaliste. C’est d’ailleurs aussi avec ce regard qu’il faut comprendre les nationalisations faites alors, qui sont, par nature, ambivalentes : elles renforcent le pouvoir de l’Etat au détriment des entreprises, tout en protégeant la propriété privée.
La Sécurité sociale, un lieu d’affrontements, aussi après les années 1945 – 1946.
Dans les premières années qui ont suivi la Libération, les mesures prises étaient inscrites dans la continuité des ordonnances de 1945. Puis, les rapports de force ont été progressivement modifiés au détriment des valeurs de partage et de solidarité. Les attaques ont été multiples, sur tous les aspects de la vie sociale. En octobre 2007, Denis Kessler a bien fixé le cadre des réformes voulues par le patronat et par les libéraux : « Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance ! ». Dans tous les pays ou presque, les gouvernements ont mis en cause les systèmes de Sécurité sociale existants Ces attaques ont été menées à des rythmes parfois différents, selon des séquences et des brutalités également différentes, mais l’objectif était partout le même : réduire les solidarités, fragiliser les apporteurs de travail par rapport aux détenteurs du capital. Dans les pays où le financement de cette protection sociale reposait principalement sur l’impôt, la part des impôts progressifs a été réduite, le niveau de l’imposition effective des bénéfices des sociétés, et principalement celui des multinationales, a été fortement diminué, la taxation des dividendes des actionnaires a été atténuée et la taxation des fortunes et des patrimoines a été le plus souvent évitée. Et ce sont les autres impôts et taxes qui ont été plutôt augmentés ; ainsi le financement des solidarités à l’égard des pauvres et des classes moyennes devenait de plus en plus un financement par les pauvres et les classes moyennes. Le même processus a été appliqué par les gouvernements où le système de protection sociale reposait principalement sur les cotisations. Là aussi, de fait, le capital et les revenus du capital ont été exclus du financement social. Les cotisations des employeurs n’ont cessé d’être réduites, au prétexte d’une « baisse du coût du travail qui sera favorable à l’emploi ». Les moyens de financement de la Sécurité sociale ont été compromis (limitation de la masse salariale servant de base aux cotisations sociales par le chômage de masse et par le blocage des salaires). Et partout, les prestations sociales et les prises en charge ont été diminuées (santé, médicaments, retraites, allocations chômage, etc.).
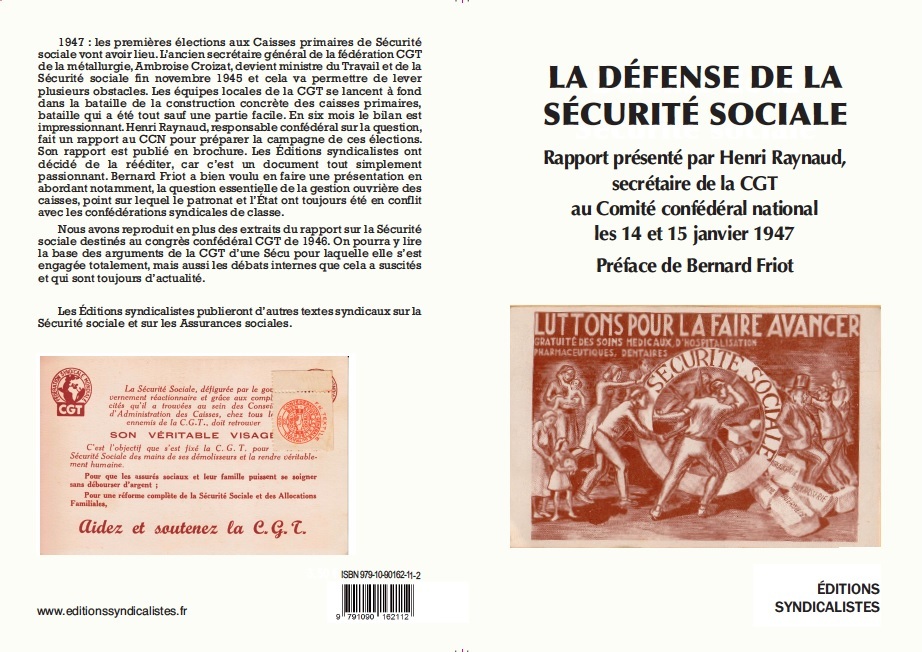
Il est utile de revenir sur les procédés employés par les gouvernements pour utiliser notamment la Sécurité sociale, comme outil de transfert de fonds du plus grand nombre vers les plus riches. Les gouvernements et les dirigeants des grandes entreprises commencent par organiser un chômage de masse, juste ce qu’il faut, beaucoup, mais pas trop, particulièrement en ne réduisant pas le temps de travail en fonction des gains de productivité, et en faisant travailler plus (par des conditions de travail dégradées) et plus longtemps (par les « réformes » des retraites qui repoussent toujours l’âge de départ en retraite) celles et ceux qui ont un travail. Ensuite, les gouvernements se lancent dans la course à la diminution des cotisations sociales des employeurs, au prétexte d’un coût du travail excessif et pour que les entreprises soient compétitives pour créer des emplois. Ces exonérations de cotisations sociales sont d’un effet quasi nul en matière de créations d’emplois, mais elles ont pour effet de réduire les recettes de la Sécurité sociale. Quand les gouvernements décident que le budget de l’Etat va compenser les pertes de recettes de la Sécurité sociale, ceci se fait à plus de 50 % par l’intervention de la TVA (qui représente plus de 50 % des recettes fiscales de l’Etat). Pendant le même temps, les gouvernements baissent l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des plus riches et l’impôt sur les dividendes, suppriment l’impôt sur la fortune, et augmentent certaines taxes payées par les consommateurs. Ainsi, les entreprises font plus de profits, du fait des exonérations de cotisations sociales, et cette opération est financée pour l’essentiel par les salarié.es ! L’organisation de l’endettement de la Sécurité sociale (le « trou de la Sécu ») participe aussi aux transferts de fonds du plus grand nombre vers les plus riches. La prochaine étape devrait être que le budget de l’Etat ne compense plus les exonérations de cotisations sociales ouvertes aux entreprises. L’impact sera direct sur le fonctionnement de la Sécurité sociale et sur ses possibilités de financer certaines prestations.
Nous le voyons, les « revanchards » ont déjà bien entamé le combat. A nous de savoir agir pour une Sécurité sociale universelle couvrant tous les risques sociaux, chacun.e selon ses besoins, et chacun.e participant selon ses moyens. En 2019, il n’y a plus lieu de favoriser, à ce point, le capital et ses détenteurs. Les entreprises privées ne sont plus en manque de possibilités d’investissements. Les marges de profits sont élevées, particulièrement pour les plus grosses entreprises, les multinationales. Il serait scandaleux que ces profits, non utilisés pour investir en France et y créer de l’activité et de l’emploi, continuent d’être distribués aux actionnaires et participent à la spéculation financière qui menace les budgets publics et les démocraties. Seul le travail est créateur de richesses. Un financement pérenne de la Sécurité sociale doit donc reposer sur l’ensemble des richesses créées par le travail dans l’entreprise, à savoir les salaires et les profits. Les salaires ne sont que le reflet du taux d’exploitation du travail, ils ne sont pas la mesure des richesses créées. Les entreprises doivent participer au financement de la Sécurité sociale au-delà de leur seule masse salariale, c’est-à-dire sur l’ensemble de leur bénéfice brut d’exploitation. Aujourd’hui, continuer de demander aux entreprises de ne financer la Sécurité sociale que sur leur masse salariale, c’est faire supporter ce financement uniquement sur les revenus obtenus par le travail, sur les revenus salariaux que le système capitaliste accorde aux travailleurs et travailleuses en rémunération de leur travail. Avec une telle assiette, plus le système capitaliste exploite les travailleurs et travailleuses, plus le taux de profit est élevé, plus la masse salariale est réduite (par le gel ou la baisse des salaires, par suite des licenciements, par remplacement du travail humain par des machines, par des délocalisations d’activités à l’étranger, etc.) et plus l’équilibre des comptes sociaux est difficile. Continuer de demander aux entreprises de financer la Sécurité sociale sur leur masse salariale, c’est faire gagner deux fois les entreprises qui réduisent leurs salaires et leur masse salariale en les exonérant, en proportion, de cotisations sociales. Ainsi, les entreprises qui créeraient de la demande sociale supplémentaire (par du chômage accru) seraient celles qui seraient moins appelées à contribuer, alors que celles qui embauchent, qui augmentent leurs salaires, verraient augmenter leur contribution !
Que faire aujourd’hui ? Décider ensemble de ce que nous voulons.
Jusqu’à présent, nos résistances ont échoué. Au mieux, nous sommes parfois parvenus à retarder l’échéance de réformes régressives. Mais les régressions continuent, semble-t-il, inéluctablement. Le rouleau compresseur libéral est toujours en marche. Les marchés financiers s’approprient progressivement l’ensemble de la planète, tout ce qui y pousse, tout ce qui y vit. Nous appelons nos concitoyen.nes à nous rejoindre pour « changer le monde », mais nous sommes très peu suivis et encore moins accompagnés. Nous « appelons » à plein d’initiatives, de rassemblements, de manifestations, voire de grèves ; nous sommes assez souvent seul.es, ou pas nombreux, mais qu’importe, nous continuons, et sans nous poser de questions. Il est probablement temps de s’interroger sur ce hiatus : nos concitoyens sont-ils mauvais ? Inconscients ? Insouciants ? En un mot, faut-il changer le peuple ? Ou bien, ce sont nos propositions qui sont mauvaises, inadaptées, incompréhensibles, incohérentes, impossibles à réaliser, etc. Et veut-on vraiment changer le monde, ou tout ceci n’est-il qu’un jeu entre nous, un divertissement comme l’entendait Pascal dans ses Pensées ? Nous devons poser ces questions pour mesurer le sérieux d’une démarche.
Imaginer un autre monde possible.
Quand nous examinons les politiques menées dans la plupart des pays depuis une trentaine d’années, nous y trouvons une tendance dominante : il s’agit de libérer les détenteurs de capitaux de toute obligation, de toute contrainte, de toute norme, de toute réglementation qui pourraient limiter leurs possibilités d’agir et de faire des profits. Quand Denis Kessler, en 2007, explique les politiques « tous azimuts » menées par Sarkozy, il nous dit que derrière cet apparent bric-à-brac, il y a une très grande cohérence : il s’agit de casser le compromis de 1945, et, derrière, de libérer les capitaux de toute entrave. Ses propos de 2007 nous expliquent les réformes multiples, incessantes, lancées par Macron depuis son arrivée en mai 2017. Ils nous expliquent les options de la BCE, les choix décisifs retenus par la commission de Bruxelles ; ils nous expliquent encore les contenus des traités commerciaux en cours de signatures.

Et nous, en face, trop souvent, nous ne savons, au mieux, qu’essayer de réagir aux attaques. Nous courons de tous les côtés, passons d’une lutte à une autre, essayons de coller au calendrier des « réformes » et des attaques des autres. Faute de mettre en avant un projet émancipateur, nous apparaissons très généralement comme les défenseurs de l’existant. Cet existant qu’à longueur d’analyses, de tracts, d’appels, etc., nous critiquons et dénonçons, subitement nous le mettons en avant pour lui opposer les casses que vont provoquer les « réformes ». Ainsi, trop souvent, ce sont les « casseurs » (casseurs des services publics, casseurs de la Sécurité sociale, casseurs du droit du Travail, casseurs de la justice fiscale, etc.) qui vont paraître comme les novateurs. Dans la « réforme » des retraites en cours, nous semblons défendre un existant qui est loin d’être un idéal, qui n’a rien d’universaliste, d’égalitaire, de solidaire. Et c’est le gouvernement qui tient le discours sur l’universalité ! Aujourd’hui, par exemple, nous avons probablement à imaginer une Sécurité sociale couvrant, comme le programmait l’exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945, « l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des insécurités ». Ceci serait financé par l’ensemble des revenus des personnes, de façon nécessairement progressive ; il s’agirait de cotisations et non d’impôts, et c’est directement la population qui participerait à la définition des besoins et des demandes et déciderait des prestations. La démocratie sociale se développerait parallèlement à la démocratie politique et aux aléas de cette dernière. Il nous faut montrer qu’une autre Sécurité sociale est possible, « une autre », et pas le rafistolage de l’existant. Et il est facile de comprendre que cette autre Sécurité sociale n’est possible que dans le cadre d’une autre société. Face au projet globalisant des détenteurs de capitaux, nous devons avoir un projet émancipateur lui aussi global. C’est dans un tel cadre qu’il nous faudrait inscrire nos exigences particulières, pour leur donner un sens et une cohérence. La cohérence des demandes et propositions qui seraient ainsi exprimées impliquerait d’appliquer des limites très fortes aux détenteurs de capitaux, en limitant notamment leurs totales et entières libertés actuelles et en leur appliquant des réglementations et des contrôles. Ce qui veut dire que nous devons débattre de la place qui serait laissée à la propriété privée des moyens de production, dans l’entreprise et dans la société. Et qu’il y aura lieu de débattre de la démocratie dans l’entreprise et de la démocratie dans la société. En 2019 / 2020, nous sommes très loin d’être dans une telle situation.
Libérer nos têtes pour bâtir l’autre monde.
Pour penser qu’il nous sera possible d’arriver un jour, collectivement, à cette élaboration collective, il faut certainement commencer par essayer de libérer nos têtes et nos esprits. Prenons encore l’exemple de la Sécurité sociale. Baser un financement sur les salaires, et sur les seuls salaires, c’est baser la couverture des insécurités sociales sur la prééminence du salariat, comme si le salariat était la finitude de l’humanité, après l’esclavage et le servage. Dire que le financement de la Sécurité sociale serait réglé par une augmentation des salaires -certes, augmenter les salaires, ça serait mieux- mais ce n’est que marchander sur la longueur de la chaîne ! Le compromis de 1945, redisons-le, n’était qu’un compromis. Aujourd’hui, il nous faut entreprendre d’imaginer « notre autre monde possible ». Nous ne pouvons le faire en valorisant nos chaînes ! Il nous faut relire la fable de Jean de la Fontaine « Le loup et le chien » : le chien, celui qui a le collier, magnifie sa situation où il bénéficie de « force reliefs de toutes façons, os de poulets, os de pigeons, sans parler de mainte caresse ». En contrepartie, il concède qu’il lui faut « donner la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire ». Pour décider de ce que nous voulons, il nous faut déjà libérer nos têtes de tous les freins auxquels nous avons été habitué.es, qui nous sont mis et remis, toutes les impossibilités qui nous sont avancées par celles et ceux qui ont intérêt à ce que rien d’essentiel ne change. Ceux et celles d’en face revendiquent toujours plus de liberté pour leurs capitaux, c’est-à-dire plus de pouvoirs, d’autonomie, de profits pour eux-mêmes. Nous devons avoir pour objectif plus de liberté, plus d’autonomie pour nous, pour celles et ceux qui apportent leur force de travail, dans l’organisation de leur vie, dont, bien entendu, leur vie professionnelle, et dans l’organisation de la cité.

Dès lors que nous aurons libéré nos têtes et que, collectivement, nous aurons esquissé l’autre monde que nous voulons, la bataille culturelle sera déjà commencée et nous pourrons être cette fois à l’offensive. S’il s’avère qu’une prochaine crise financière et bancaire mondiale se profile, plus forte que celle de 2007/2008, les tenants du système nous annonceront encore qu’il leur faut « sauver notre épargne », et donc sauver les banques, et donc mettre en place des plans de rigueur à l’égard des populations. Les exaspérations de ces populations provoqueront des tensions sociales et des crises sociales dans un certain nombre de pays. Il faudra alors être capables de fédérer les oppositions et les résistances pour promouvoir l’émergence d’autres mondes possibles basés sur la justice, la liberté pour toutes et tous, et l’émancipation.
1 Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), président des Etats-Unis de 1933 à 1945.
2 « There is not alternative », phrase/slogan emblématique de l’ère Thatcher (Première ministre du Royaume-Uni, de 1979 à 1990).
3 François Fukuyama a été un des inspirateurs de l’administration Reagan et du néoconservatisme américain.
4 Accessoirement propriétaire du groupe Lubrizol, dont l’incendie de l’usine de Rouen a récemment fait l’actualité.
5 Section française de l’internationale ouvrière : fondée en 1905, elle devient le Parti socialiste en 1969.
6 Dont ceux qui ont combattu Franco et défendu la Révolution espagnole et qui entreront les premiers dans Paris. Voir : www.24-aout-1944.org
7 Nous reprenons là les textes de l’époque, qui ignorent travailleuses, citoyennes, etc.
- Droits de l’enfant - 17 juin 2021
- Réformes des retraites et lutte des classes - 7 juillet 2020
- Construisons une sécurité sociale du XXIe siècle - 10 juin 2020
