Communs, Commune Se fédérer Autogestion Révolution
D’hier à demain, quel fil rouge autour de la Commune ? C’est ce à quoi répondent, partiellement sans doute, deux femmes et deux hommes investi·es dans le mouvement ouvrier d’aujourd’hui (et de la fin du siècle passé pour trois d’entre eux et elles). Quatre camarades qui ont déjà contribué aux Cahiers Les utopiques.

On célèbre les 150 ans de la Commune. La transmission de notre histoire collective est essentielle. Mais, en l’occurrence, qu’est-ce qui vous parait le plus important à retenir de ce moment ?
Ludivine Bantigny : D’abord cette transmission est essentielle pour que ces femmes et ces hommes ne soient pas morts en vain. La Commune savait que l’adversité serait maximale, sans pourtant imaginer que Thiers et la bourgeoisie lui mèneraient une guerre sans merci, dès le début d’avril, puis oseraient l’exterminer. Mais ce qu’elle savait aussi car les protagonistes avaient une très grande conscience historique, c’est qu’elle travaillait pour l’avenir. Transmettre non seulement les idéaux et les espoirs mais encore les projets et les pratiques concrètes de la Commune, c’est tout simplement rendre vivantes des alternatives possibles et tangibles : la démocratie vraie, la justice et la dignité, l’aspiration à l’égalité, des conditions de travail émancipées qui brisent avec la dictature du capital, la solidarité et la fraternité – nous ajouterions d’un mot qui n’existait pas alors mais qui aurait pu tant les femmes ont été présentes et agissantes : la sororité.
Pierre Zarka : A mes yeux, deux dimensions sont essentielles. Incontestablement oser la Révolution c’est-à-dire passer de rêves et d’aspirations individuelles à leur réalisation collective par la politique. Cette question taraude aujourd’hui des millions de personnes. Si la Commune n’a pas inauguré la Révolution, elle fait écho à notre contexte : ce n’est plus la Révolution contre la monarchie et l’aristocratie, c’est déjà le peuple qui veut s’affronte au capitalisme et veut inventer autre chose. Oser la quête d’une autre organisation de la société me paraît fondamental. Et cela me conduit à la seconde dimension : le peuple. Le peuple qui se définit par lui-même ; qui se compose comme force de pouvoir. La manière dont le peuple a osé bousculer les Républicains qui voulaient se contenter d’en finir avec Napoléon III et même bousculer une partie des organes de la Commune qui pensaient pouvoir parler au nom du prolétariat. Cet « oser bousculer » me paraît être une question d’actualité, pour ne pas dire LA question-clé de notre actualité.
Maryse Dumas : Le plus important ? Se rappeler que « chaque nuit recèle un matin », selon la belle formule de Louise Michel. La Commune c’est un message d’espoir pour tout mouvement populaire, de n’importe quelle époque, de n’importe quel pays. Les conditions dans lesquelles elle s’est soulevée et déployée sont uniques, mais sa portée elle, est universelle. Les révolutionnaires de tous les pays s’en sont inspirés tandis que les pouvoirs successifs après l’avoir réprimée dans le sang ont tout fait pour la faire oublier ou la dénaturer. La Commune démontre que rien n’est fatal, un peuple qui se soulève peut balayer le pire des pouvoirs dès lors qu’il parvient à s’unir et à faire de ses différences une force. Elle démontre aussi l’importance décisive, une fois aux commandes, de mettre en œuvre ce pourquoi le peuple s’est soulevé. Définitivement, la Commune démontre qu’il ne suffit pas d’avoir gagné la République, il faut encore que celle-ci soit démocratique et sociale. C’est un message de grande actualité !
Ludivine : La Commune va bien au-delà des quelques mesures que l’on cite en général et qui sont déjà énormes pour l’époque (sur le travail de nuit, la réquisition des ateliers abandonnés, la séparation de l’Église et de l’État, l’école laïque et gratuite, la reconnaissance des femmes non mariées et de leurs enfants…) Elle soulève des enjeux essentiels sur ce que pourrait être une « République sociale universelle ».
Christian Mahieux : Que retenir de ce moment ? La réponse n’est pas simple, parce que le moment n’est pas unique, il est multiple. A Paris, mais pas seulement ; durant les 72 jours du printemps 1871, mais aussi l’année précédente ; au comité central de la Garde nationale et dans les écoles ; au travail et sur les barricades ; internationaliste, tout en reposant initialement sur la défense nationale contre les Prussiens, etc. Mais s’il faut citer une chose : avec la Commune, le prolétariat fait la révolution, par lui-même, pour lui-même. C’est la grande différence avec 1789 qui porta (durablement !) la bourgeoisie au pouvoir. J’utilise volontairement le mot prolétariat : artisan·es et ouvrier´es qualifié·es du 19ème ne sont pas les ouvriers spécialisés et employés du 20ème, ni les télétravailleurs, télétravailleuses ou faux auto-entrepreneur·es du 21ème. Mais tous et toutes ne vivent, ou survivent, que par leur travail, pas par l’exploitation d’autrui (encore que l’exploitation domestique…). En 1871, la bourgeoisie est à Versailles, c’est de là qu’elle reconstituera « la République », après avoir massacré les communeuses et communeux. Leur république n’est pas la nôtre ! Sociale, égalitaire, internationaliste, féministe, laïque et antiraciste : c’est tout cela qu’ils massacrent en 1871 et qu’ils rejettent encore aujourd’hui. Mais l’histoire n’est pas finie.

En quoi la Commune de 1871 interpelle encore aujourd’hui « notre camp » ?
Maryse : Il y a quelques années, le musée d’Orsay a organisé une exposition des photos de la Commune. Les réactions entendues, dans le public, au cours de ma visite, me permettent de confirmer qu’aujourd’hui encore, il y a bien le camp de celles et ceux qui s’affirment solidaires des communard·es et les autres. Cette distinction en rejoint une autre : celle de la perception ou non de la division en classes de la société et de la nécessité de mettre un terme à l’exploitation capitaliste. En 1871, la classe ouvrière est montante, elle commence à s’organiser. Un peu partout des chambres syndicales sont en cours de constitution. Des Internationaux, ainsi appelés du fait de leur participation à l’AIT créée sous l’impulsion de Marx, sont très présents et actifs dans la Commune, ils portent des objectifs d’émancipation, d’égalité sociale, d’égalité entre femmes et hommes, et d’attention aux conditions de vie quotidienne de la population. Ils définissent un rapport essentiel entre luttes sociales et luttes politiques qui a longtemps imprégné le mouvement ouvrier et la gauche notamment en France mais qui s’est délité sous le feu notamment d’alternances sans alternatives, dans différents gouvernements.

Christian : Du côté de Marx et Engels, la Commune sera l’occasion de donner une « rédaction différente » à certains passages du Manifeste communiste de 1846. Ainsi, « la constitution communale aurait restitué au corps social toutes les forces jusqu’alors absorbées par l’Etat parasite » [Réédition du Manifeste en juin 1872]. Voilà qui rapproche considérablement des écrits, antérieurs à la Commune, de Bakounine. Pour autant, c’est cette même année qu’exclusions et scission de l’Internationale auront lieu !
Pierre : « Oser bousculer » est déjà une sacrée interpellation. Surtout dans un moment où ce qui caractérise tant de politiques, de syndicats, de mouvements, est qu’au nom du réalisme, on n’ose pas franchir -même mentalement- la frontière qui nous bouche toute vision du post-capitalisme. On ne retient de la Commune que le fait qu’elle a été écrasée dans le sang et peu ce qu’elle a produit. Marx disait d’elle que son grand acquis est « d’avoir démontré qu’il ne servait à rien au prolétariat de vouloir conquérir le pouvoir d’Etat pour le mettre à son service mais qu’il fallait inventer autre chose ». Voilà qui interpelle sacrément « notre camp ». Cherchons-nous les solutions dans le cadre établi par les pouvoirs institutionnels fondés sur la délégation de confiance et de pouvoirs ou commençons-nous à penser et agir en dehors de ce cadre ? Et cette mise en cause de la délégation de pouvoirs ne concerne-t-elle que l’Etat ou touche-telle à la conception de toute organisation aujourd’hui ? Je crois qu’ouvrir un tel chantier est à la fois urgent et une très grande remise en cause de notre culture.
Ludivine : La Commune soulève un grand nombre de questions stratégiques majeures. Et tout d’abord rien de moins que la prise de pouvoir. On connaît la position de Marx selon laquelle c’était sans doute trop tôt. Mais il faut aussi se rappeler celle d’Eugène Varlin qui, un an exactement avant la prise de l’Hôtel de Ville le 18 mars 1871, établissait le même diagnostic : il fallait encore accumuler des forces. Et finalement, après plusieurs tentatives manquées et réprimées (le 31 octobre 1870, le 22 janvier 1871), les femmes et les hommes de Paris, le peuple parisien, montent « à l’assaut du ciel » et montrent, non seulement avec leur assemblée communale mais encore avec les clubs populaires où l’on discute société, travail, quartiers, politique, que la chose politique justement appartient à tout un chacun et constitue un bien commun.

Pierre : Le mouvement ouvrier, tant la branche social-démocrate que léniniste ou syndicale (à quelque exception près) a confondu le fait que la Commune a été écrasée avec la notion d’échec. Dès lors, il ne fallait pas refaire comme elle. Terrible erreur : la Commune -on ne sait pas ce que l’Histoire aurait pu être- n’a pas échoué, elle a été écrasée. L’URSS n’a pas été écrasée elle a échoué. Ce n’est pas la même chose et je crains que nous payions encore aujourd’hui cette formidable confusion.
Christian : Les décisions et réalisations de la Commune nous interpellent : en 72 jours, dans un contexte de guerre, de siège de Paris, de faim et de misère, contre les tenants de la monarchie ou de l’Empire mais aussi contre la bourgeoisie « républicaine », l’œuvre est considérable ! Surtout, elle illustre la capacité de la classe ouvrière, de notre classe sociale, à prendre les choses en mains. Les barricades, le drapeau rouge, le drapeau noir, Louise Michel, … Bien sûr ; mais l’ouvrière Nathalie Lemel et l’ouvrier Eugène Varlin : quelles leçons ! présent·es dans les débats et sur le terrain, mais sur la base de leurs activités émancipatrices concrètes : les coopératives La ménagère ou La marmite, la chambre syndicale, l’Internationale, … Les débats internes aussi nous interpellent : la réaction de « la minorité » après la mise en place d’un Comité de salut public pointe bien des éléments qui seront ô combien d’actualité dans des révolutions ultérieures.

Ludivine : La Commune interpelle aussi sur l’idée même de se fédérer, donc de dépasser les clivages pour tendre vers l’unité : le foisonnement des courants politiques était réel, entre les blanquistes, les proudhoniens, le courant proche de Marx, les jacobins… Mais comme l’a fait la Garde nationale, avant même la Commune – ce qui a été décisif dans le mouvement révolutionnaire –, ils se sont fédérés. Cette Garde nationale, composé d’hommes en armes contre l’armée de métier, pose aussi l’enjeu, justement, des armes mais aussi celui de la fraternisation avec les soldats : on le sait, si la Commune a pu s’imposer, si le renversement de pouvoir a eu lieu, c’est qu’au matin du 18 mars, la troupe de ligne a mis crosse en l’air et fraternisé. Et aujourd’hui ? Quelles en seraient les conditions ? Que faire face aux forces de l’ordre ? Y a-t-il encore une mince brèche pour d’éventuelles fraternisations possibles, en misant sur la division au sein des corps de police ? La question n’a rien de naïf et la Commune montre bien quoi qu’il en soit la nécessité impérieuse de la poser.
Pierre : Et qui est le peuple ? On pense encore trop qu’être « près des gens », être « concrets » suppose de rester catégoriel. Et on ne produit pas de « commun » alors que la force du peuple se mesure à ce qu’il est dans sa totalité. De ce point de vue je note un début d’affirmation nouvelle de la notion de peuple dans la composition sociale des Gilets jaunes, comme dans la participation de l’Opéra de Paris à des concerts publics ou dans les gares pendant le mouvement pour les retraites.
La Commune de 1871, en quelques mots, ça signifie quoi par rapport à votre itinéraire personnel, à vos engagements militants ?
Pierre : L’idéal de l’action révolutionnaire incontestablement. Mais ce n’est qu’après la faillite du soviétisme que je me suis mis à chercher comment celle-ci ne devait pas conduire à renoncer à ce que je continue de qualifier de communisme. Jusque-là, l’image approximative que j’avais de la Commune ne servait essentiellement qu’au décorum. C’est au fur et à mesure que je me suis interrogé sur le rôle premier que devais jouer le mouvement populaire, sur le dépassement de la césure entre mouvement social et politique.
Maryse : J’ai passé le bac, en Gironde, l’année du centenaire de la Commune. Je ne me souviens pas avoir jamais entendu parler d’elle au lycée. C’est plus tard, en Région Parisienne, et en devenant militante, que j’ai découvert la Commune, par le bouche à oreille militant d’abord, puis par les commémorations et enfin par les lectures. C’est donc avant tout le message militant qui, pour moi comme pour bien d’autres, a compté. Se sentir, se situer en continuateurs de la Commune, définit un type de militantisme, une façon de concevoir les luttes et leur organisation. Ce que l’on retient c’est que nos prédécesseurs sont partis « à l’assaut du ciel » et qu’ils ont chèrement payé non d’avoir trahi leur idéal mais au contraire d’avoir tout fait pour l’atteindre. De ce point de vue, la semaine sanglante, la répression féroce qui s’en est suivie n’ont pas entaché la lumière de la Commune, elles ont au contraire contribué à son aura.
Christian : Je suis de la génération « loi Debré de 1973 ». J’ai « loupé » le centenaire de la Commune ; en 1971, j’avais 13 ans et demi. Du CP au Bac, je ne crois pas qu’on m’en ait vraiment parlé à l’école ! C’est donc à travers les premières lectures militantes que j’ai appris : Louise Michel bien sûr, et puis Lissagaray, Andrieu, Varlin bien plus tardivement, etc. Sans extrapoler a posteriori, la Commune c’est une révolution découverte à travers les premières formations et lectures syndicales dues à un milieu syndicaliste révolutionnaire : l’Union départementale Val-de-Marne ou les Cheminots CFDT de la fin des années 70, début des années 80). Il ne s’agit pas de préempter la Commune, mais il y a une filiation, avec le syndicalisme révolutionnaire !
Ludivine : Comme historienne et comme militante, la Commune vient à point comme une ouverture vers l’avenir, pas seulement un retour vers le passé. J’ai beaucoup étudié la guerre d’indépendance algérienne puis 1968. On sait qu’en 1968, la référence à la Commune était très présente, très vivante, comme un dialogue renoué avec l’histoire, un échange prolongé. De même, beaucoup de militantes féministes au sein par exemple des « groupes femmes » tout au long des années 1970 se tournaient vers les femmes de la Commune, telles Elisabeth Dmitriev, Nathalie Le Mel et bien sûr Louise Michel (mais il faudrait en citer bien d’autres qui ont été extraordinaires). Il me fallait y voir de plus près. Comme militante, j’avais surtout été marquée par les révolutions du XXe siècle qui m’importaient pour tous les enjeux qu’elles posaient : évidemment 1905 et 1917, mais aussi la situation révolutionnaire en Allemagne et en Hongrie après la première Guerre mondiale, puis la Chine, Cuba, le Vietnam, le Nicaragua. Revenir vers la Commune, c’est poser de tout autres questions, en particulier la réalité concrète de ce que peut bien signifier le « dépérissement de l’État ». Et ce bien qu’il y ait eu aussi des divisions dans la Commune à ce sujet, une « majorité » et une « minorité », aux abois devant la guerre civile (il faut tout de même se rappeler que dès ses premiers jours, la Commune vivait sous la menace des canons de Versailles et qu’elle comptait des dizaines de morts chaque jour, bien avant la Semaine sanglante : les conditions étaient effroyables). La « majorité » a fini par penser qu’il fallait concentrer la décision entre les mains d’un Comité de Salut public, en se référant évidemment à l’expérience de 1793-1794 ; la minorité n’en voulait pas et estimait n’en avoir pas le mandat. Ce sont des enjeux qui doivent aussi, et ô combien, être posés aujourd’hui. C’est aussi pour toutes ces questions que la Commune me passionne et que j’admire énormément ces femmes et ces hommes, dont la maturité politique comme le courage étaient exceptionnels. Il faut revenir à leurs textes, à leurs journaux, à leurs livres, à leurs pratiques, à leurs combats : l’essentiel y est déjà.
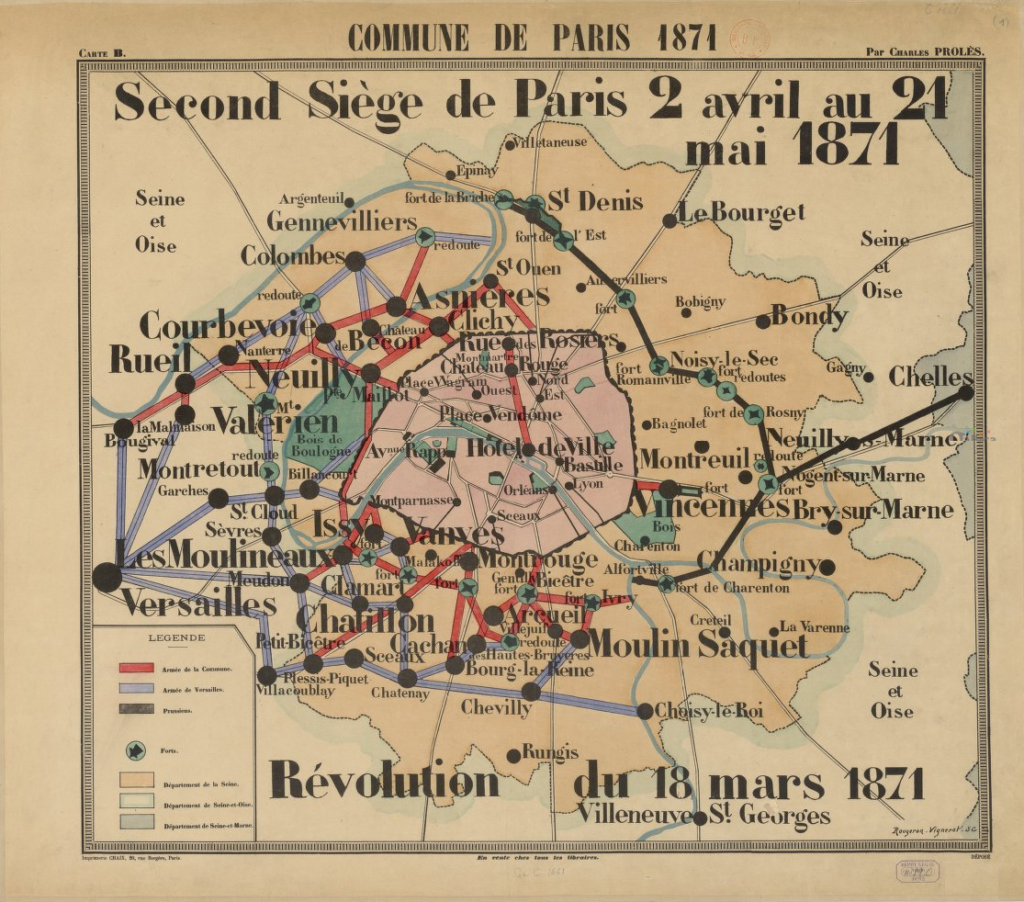
Au plus fort du mouvement des Gilets jaunes, un parallèle a été fait avec la Commune ; certains groupes de Gilets jaunes y ont fait explicitement référence. Quelles similitudes ? Quelles différences ? Quels antagonismes peut être ?
Pierre : Quelles similitudes ? Le « petit peuple » des anonymes qui se hisse sur le devant de la scène politique et qui fait durant deux ans la Une de l’actualité. Le peuple qui se refuse aux étiquettes et aux organisations qui ont été conçues sans lui, en dehors de lui et auxquelles on lui demande seulement de se joindre. C’était déjà un conflit durant la Commune. Le peuple qui bouscule les plans les mieux établis par les « sages » de la République.
Maryse : Que certain·es Gilets jaunes y aient fait référence confirme que « la Commune n’est pas morte » comme le disait Pottier. Mais je ne crois pas qu’ils ou elles aient été très nombreux. La mémoire de la Commune est essentiellement militante. Or les Gilets Jaunes vivaient, pour la plupart, leur première expérience de luttes même si des militants expérimentés d’organisations politiques et syndicales diverses ont cherché à apporter leurs contributions. Le point commun entre Commune et Gilets jaunes est sans doute leur caractère populaire. Mais, celui de la Commune était à la fois plus expérimenté et plus organisé. Il s’inscrivait dans une continuité d’actions révolutionnaires et de grèves ouvrières. Il avait déjà l’expérience de luttes dures, rarement victorieuses, l’expérience de la solidarité et de la fraternité de ces moments de combats, celle de la répression aussi.
Ludivine : La Commune n’a pas été la référence structurante du soulèvement, les Gilets jaunes se référaient d’abord et avant tout à la Révolution française. Mais c’est certain, la Commune a été beaucoup mentionnée par une partie du mouvement, on le voit bien sur les Gilets citant Louise Michel, ou Blanqui, ou tout simplement 1871 comme expérience « post-capitaliste », soit comme date seule, soit comme date inscrite dans une succession d’expériences révolutionnaires. Mais il est logique que ces allusions n’aient été portées que par la gauche radicale présente dans le mouvement et par les Gilets jaunes qui se sont organisé·es en assemblées des assemblées, débouchant d’ailleurs, en février 2020, sur la Commune des communes à Commercy. Logique parce que malheureusement la Commune est un événement historique très mal connu. On l’enseigne peu à l’école. Comme le montre le formidable livre de Jean-François Dupeyron, À l’école de la Commune, l’école de Jules Ferry, l’école de la République d’ordre a soigneusement occulté cette expérience et notamment, justement, en matière scolaire (la Commune et l’école émancipée, l’éducation intégrale, l’école de l’égalité vraie).

Christian : Toujours pareil : nous avons besoin d’analyser, de comprendre, de ne pas oublier, mais de ne pas mythifier non plus. Inventer et pratiquer la démocratie à grande échelle oblige sans doute à imaginer des solutions différentes et complémentaires, selon qu’on parle du collectif de travail, de communes fédérées, d’une production sur le plan national ou encore de l’utilisation des richesses naturelles. Si l’assemblée générale est le principe de base, comment en assurer l’émanation dès lors qu’il s’agit de se fédérer ? Mandats impératifs, contrôlés, révocatoires, tirage au sort, vote ou consensus… La solution est dans la complémentarité des méthodes, pas dans la recherche de « la » solution miracle, applicable à tous les périmètres et tous les sujets. Beaucoup de groupes de Gilets jaunes ont travaillé sur ces thèmes et d’autres (dont le referendum). Les « assemblées des assemblées » en sont une illustration. Mais gardons-nous de deux écueils : elles ne sont pas représentatives de l’ensemble du mouvement, les textes qui en sont issus n’ont jamais été une référence pour bien des groupes locaux ; à l’inverse, la démocratie en actes a été présente, durant des mois, dans nombres de villes, villages, quartiers !
Pierre : Je mentionnais de fortes similitudes entre la Commune et les Gilets jaunes, mais il y a aussi une immense différence : nous vivons après un siècle d’échec et de désillusion populaires : c’est vrai pour qui suivait le modèle soviétique…ou chinois ; de qui a cru dans le socialisme à la suédoise et qui a pensé que le développement technologique allait apporter le bonheur…Il faut avoir la couenne épaisse pour continuer à « y croire ». Les Communards avaient derrière eux les Sans-culotte et le souvenir de la Constitution de l’An II, les idéaux et des acteurs de 1848. Tout cela nourrissait la capacité à se projeter vers un « après ». Pour les Gilets jaunes ou les mouvements qui ont suivi, c’est plus difficile. Il faut tout inventer. Et pour cela il faut oser rompre avec ce qui paraît -à tort aller de soi- et oser explorer de l’inconnu et vouloir inventer.
Maryse : Présente dans les deux mouvements, la question politique de la souveraineté populaire a conduit jusqu’à la prise et à l’exercice du pouvoir par la Commune. Pour les Gilets Jaunes, elle s’est focalisée sur la demande d’un référendum qui même « d’initiative populaire » est loin de répondre à la problématique. Enfin, la Commune de Paris intervient aux débuts du capitalisme industriel, elle est le fait d’une classe montante, la classe ouvrière. Aujourd’hui, le capitalisme est à la fois financier et mondialisé, la classe des exploités est plus nombreuse mais elle est aussi plus éclatée. Loin d’être en phase ascendante elle se ressent menacée de « déclassement ». Cela change tout ! La perspective d’émancipation animait la Commune, aujourd’hui l’avenir semble bouché.
Ludivine : Si les Gilets jaunes pour toutes les raisons ici évoquées, et d’autres, n’ont pas brandi la Commune comme une référence majeure, il n’empêche qu’elles et ils ont posé des enjeux qui lui ressemblent : ce qu’un peuple peut faire et être quand il se constitue comme peuple, c’est-à-dire comme force politique réclamant l’égalité (à propos de la Commune, Jacques Rancière écrit : «Le peuple politique est le sujet qui exerce le pouvoir spécifique des égaux. ») Et tout ce qui en découle : la justice sociale, la prise de parole qui fait advenir des sujets politiques, la réflexion sur ce que pourrait être une démocratie véritable, l’attention à ceux qui, à suivre Macron, « ne sont rien » mais pourraient bien être « tout ».
Christian : La contribution des GJ au renouveau du débat sur la démocratie, et surtout à son enracinement dans de larges couches de la population, est indéniable. Mais ils et elles ont aussi redécouvert des choses auxquelles le mouvement ouvrier s’est confronté depuis longtemps !
De la Commune, on a tiré vers « les Communs ». Sans forcément entrer dans des discussions picrocholines qu’affectionnent certains milieux militants, comment définir ce que sont ces communs ? Y a-t-il des différences fondamentales avec les services publics auxquels se réfèrent plus traditionnellement une bonne partie du mouvement ouvrier et populaire ?
Maryse : Le mot «Commune » renvoie pour moi à des formes d’organisationcollective enracinées dans notre histoire depuis la féodalité. Je comprends ce que signifie la notion de « biens communs », mais le mot « communs » employé tout seul me parait beaucoup plus ambigu. De quoi parle-t-on ? d’espaces ? d’usages ? d’intérêts ? Mais alors pourquoi ne pas le préciser ? que fait-on des contradictions d’intérêts présents partout, parfois même dans chaque individu ? Comment éviter que certains s’approprient le « Commun » et deviennent ainsi « plus égaux que d’autres « selon la formule de Pierre Dac ? Je ressens cette expression comme un évitement de la question de la propriété. Les « Communs » sont communs à qui ? Aux actionnaires et aux salariés ? aux exploiteurs et aux exploités ? aux dominants et aux dominés ? Qu’il ne suffise pas de parler ou d’obtenir une appropriation publique pour que la population soit à la fois partie prenante et destinataire des biens et services produits, je suis d’accord. Qu’il faille travailler sérieusement sur les différentes formes de propriété, publique, sociale, coopérative etc. pour qu’elles correspondent aux objectifs d’émancipation et de démocratie me parait évident. Mais je ne retrouve rien de ces préoccupations dans le terme « Communs ». Quant aux services publics, remarquons que s’ils ne répondent plus aujourd’hui aux besoins sociaux et démocratiques, c’est précisément parce qu’on les somme d’être gérés comme des entreprises privées voire même qu’on les privatise. La Poste est aujourd’hui une société anonyme aux capitaux 100% publics mais qui rayonne sur 200 filiales de droit privé. Que nombre d’usagers ne reconnaissent plus la spécificité du service public dans ces conditions, on le comprend. Mais est-ce une raison pour renoncer à toute idée de service public, par la revitalisation des anciens, ou par la création de nouveaux service publics ? Le vrai problème c’est comment faire reculer le tout marché et la concurrence dite « libre et non faussée » qui gangrène la société.

Ludivine : Il est vrai que les « communs » apparaissent comme un thème central dans des réflexions et des pratiques renouvelées, pour partie inspirées des notes de Marx en 1844 : « Supposons que nous produisions comme des êtres humains : chacun de nous s’affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l’autre… J’aurais dans mes manifestations individuelles la joie de créer la manifestation de la vie, c’est-à-dire de réaliser et d’affirmer dans mon activité individuelle ma vraie nature, mon être-commun. Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l’un vers l’autre ». Les communs sont certes des ressources et des biens, parmi lesquels des ressources naturelles menacées par le désastre écologique né d’un capitalisme mortifère inspiré par la logique du « toujours plus » (Plusmacherei comme le disait encore Marx) ; mais ils renvoient tout autant à une façon de s’occuper de ces biens. Les communs ne sont pas forcément ou pas seulement des choses, des objets ou des biens : plutôt et tout autant des actions collectives et des formes de vie – des relations sociales fondées sur le partage et la coproduction. Les communs constituent moins un donné qu’une intelligence collective en acte et en action. Or la Commune a très clairement posé quelques pratiques pour une organisation non-capitaliste de la vie, avec toutes les formes de coopération (les coopératives de production, de consommation, d’alimentation… y étaient essentielles et la commission du Travail et de l’Échange s’en est beaucoup occupée durant le peu de temps dont elle a disposé), le partage du travail et surtout d’un travail émancipé de la logique brutale, aliénante et écrasante du profit. Il me semble dès lors que les communs se rapprochent certes des services publics, mais au sens alors d’un service public généralisé et qui ne toucherait pas simplement à quelques aspects de la vie sociale et économique (l’énergie, les transports, l’éducation, la culture…). Le communalisme, c’est l’idée que des assemblées populaires doivent décider de ce qui est juste et bon, dans tous les domaines. C’est peut-être la « forme enfin trouvée » de la démocratie vraie, pas seulement dans le champ politique, mais dans tout ce qui touche à nos vies collectives.
Pierre : D’abord, il y a une origine historique au mot Communs sur laquelle je voudrais revenir. Au début du XIVème siècle il y a eu en Angleterre ce qui, à ma connaissance, a été la première grève ouvrière (des ouvriers tisserands). Elle a tenté une jonction avec des paysans et a donné le mouvement des « Hommes Justes ». Avant de réussir à les passer par le fil de l’épée, les aristocrates les ont traités par le mépris en les qualifiant de « gens du commun ». A cela l’un d’entre eux Watt Tyler les a pris au mot en répliquant que le Commun c’était le mouvement des gens du commun. Quelques siècles plus tard, Marx dira du Communisme qu’il n’est pas un état mais le mouvement réel qui abolit l’ordre ancien. Pourquoi ce détour ? parce que nous en sommes restés à déléguer le devenir de ce qui nous appartient à l’Etat. Il paraît que vous et moi sommes propriétaires de la SNCF et de la Sécu. Personnellement à chaque mesure pondue par un gouvernement, je n’ai pas l’impression d’être propriétaire de quoi que ce soit. Pas même de moi. Il est grand temps d’y remédier. Revendiquer que « les gens du commun » se transforment en puissance publique tant pour demain gérer les secteurs publics (pour qu’ils le soient réellement) que dès maintenant pour définir la vie politique me semble être un verrou de la situation.
Christian : les Communs devraient être tout ce dont on a besoin pour vivre en société ; sur le plan matériel, mais aussi intellectuel, culturel. Le champ est vaste, bien au-delà des services publics ou de ce qu’il en reste. La période récente devrait nous pousser à retravailler ce sujet, à oser de nouvelles définitions, de nouvelles propositions : par exemple, l’alimentation, dans toute sa dimension, devrait être un « commun ». Mais au-delà de la définition, ce qui importe aussi, c’est la manière dont cela fonctionne. Des « communs » décidés et gérés par une élite, ça ne fait pas rêver ; d’une certaine manière ça a été testé. La démocratie directe, l’autogestion, le double pouvoir entre institutions (y compris révolutionnaires) et collectifs librement associés sont des éléments indispensables. En cela, à sa manière et toujours sans enjoliver, la Commune de Paris nous montre une voie. Les questions sociales ont été imposées par l’action des comités de vigilance, des clubs révolutionnaires (qui se réunissaient dans les églises), de la Garde nationale.
La Commune ? Ou les Communes ? Il y a eu des Communes proclamées dans plusieurs autres villes, une volonté de fédérer le communalisme ; on y revient dans ce numéro des Utopiques. Mais n’y-a-t-il pas là un sujet important à travailler aujourd’hui ? Comment fédérer nos initiatives, nos engagements, nos organisations aussi … ?
Ludivine : Si nous avions la réponse à cette question, « Comment fédérer nos initiatives, nos engagements… ? », nous serions à la veille d’un 18 mars qui irait « jusqu’au bout », comme on l’a dit aussi à propos de Mai-Juin 1968. Il n’empêche : la question est absolument cruciale. C’est bien pourquoi nous sommes beaucoup à mettre nos forces et nos énergies dans des collectifs qui ont pour but de décloisonner, de rompre avec la logique terrible de la division et du « chacun dans son couloir », tout en proposant de discuter vraiment autour d’enjeux stratégiques essentiels. La Commune nous est très utile pour cela. Elle s’est débattue pour constituer une République qui soit une fédération de fédérations. Elle a répété qu’elle n’entendait pas imposer le pouvoir de Paris au pays entier, mais elle invitait les villes à suivre ce chemin de l’autonomie, de l’auto-organisation et de l’émancipation. Très humblement, nous nous référons à cette expérience et à tout ce qu’elle peut encore nous apporter dans le collectif « Se fédérer ».

Christian : Au-delà de quelques appels « à la province », la Commune de Paris n’a, en réalité, guère fédérer au-delà de son champ géographique; tout d’abord, parce qu’il n’y avait pas beaucoup de Communes à fédérer et que, pour certaines villes, les moments forts avaient lieu plutôt fin 1870 ; aussi parce que le souci n’était pas unanimement partagé aussi des communeux et communeuses de Paris.
Pierre : Il y a eu à l’époque une confrontation entre Marx et Bakounine. Il en est resté que le second était « municipaliste » et le premier centralisateur et étatiste. Mauvaise lecture. La multiplicité réelle des Communes, notamment à Lyon, Saint Etienne ou le Creusot a été singulièrement occultée par l’Histoire officielle se limitant à Paris alors que le mouvement n’y avait pas commencé. Très vite est donc venue la question de la dimension réelle du mouvement. L’idée que les Communes se fédèrent a émergé. Le bémol de Marx est le suivant : l’addition des Communes ne suffira pas à faire un mouvement d’ensemble. Plus tard quelqu’un rajoutera que si je ne fais qu’additionner les éléments je ne puis pas comprendre comment l’eau qui est basée sur de l’oxygène et de l’hydrogène peu éteindre un feu. Il faut bien que la combinaison dépasse l’addition.
Maryse : Dès avant laCommune, Eugène Varlin ambitionnait de « fédérer les fédérations », volonté qui a donné lieu un quart de siècle plus tard, en 1895, à la fondation de la CGT, dont le premier terme, Confédération constitue un début de réponse. Mais ne nous voilons pas la face, le « Tous ensemble » fédérateur du mouvement de 1995, un siècle plus tard, est aujourd’hui beaucoup plus difficile à construire. Il nous faut rompre un cycle dévastateur : plus s’estompe la perspective d’un changement de société, plus on se réfugie dans des recherches de solutions immédiates. Réciproquement, les replis sur soi, voire les concurrences et les oppositions aggravent les difficultés à ouvrir des perspectives. Je ne vois qu’un intense travail de terrain au plus près de chacune des réalités, cumulé avec la recherche d’unité dans le respect des différences, qui puisse permettre de sortir de l’ornière. Mais c’est de longue haleine, je le reconnais !
Pierre : Pour se fédérer nous avons besoin de produire du sens qui dépasse l’opposition catégorielle aux mauvais coups. Qu’y a -t-il de commun entre un ouvrier de PSA et un chercheur en médecine ? Ni la revendication salariale, ni le concret de l’aménagement des conditions de travail, ni les pratiques culturelles mais tout cela est relié par deux dénominateurs communs autrement puissants : le besoin de mesurer que pour être satisfaites leurs revendications doivent puiser dans les dividendes versés aux actionnaires ; et le besoin de mesurer que pour être satisfaites leurs revendications ont besoin qu’ils aient le pouvoir.
Christian : Fédérer, c’est un concept important. Y compris au sein de nos organisations : est-ce qu’il faut qu’une majorité l’emporte sur une minorité ? Ne vaut-il pas mieux fédérer, travailler toutes et tous à la recherche de positions et décisions consensuelles, qui ne sont pas forcément synonymes de plus petit dénominateur commun ? Fédérer est aussi un besoin pour l’ensemble des forces de notre classe sociale : dans la période de création de la Première internationale, donc aussi de la Commune, les différentes formes de groupements du mouvement ouvrier étaient partie prenante, à égalité, de la dynamique émancipatrice. N’y a-t-il pas là matière à réflexion ? Dans un texte antérieur, avec Pierre nous écrivions : C’est le fameux « débouché politique aux luttes » qui est au cœur du débat. La plupart de celles et ceux qui s’y réfèrent ne parlent en fait que de débouché électoral dans le cadre institutionnel établi. En tout état de cause, ce n’est abordé que sous la forme de la prise du pouvoir d’Etat, en déléguant celle-ci aux partis. Dans la perspective d’une société autogestionnaire, cela mérite un autre examen.
Maryse : Exactement, et dans cet examen la question de l’émancipation du travail par « les travailleurs – et travailleuses- eux-mêmes » doit redevenir centrale.
Historienne, Ludivine Bantigny est membre du collectif Ni guerres ni état de guerre et co-anime les initiatives lancées autour de l’appel Se fédérer. Elle a publié 1968, de grands soirs en petits matins, Editions du Seuil, 2018 (rééd. 2020) ; Révolution, Éditions Anamosa, 2019 ; La plus belle avenue du monde. Une histoire sociale et politique des Champs-Élysées, Éditions La Découverte, 2020 ; La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, Éditions La Découverte, 2021.
Maryse Dumas est membre du Bureau de l’Institut d’histoire sociale de la CGT (IHS-CGT). Elue au secrétariat de la fédération CGT des PTT en 1979, elle en sera secrétaire générale de 1988 à 1998. Maryse Dumas a été membre du Bureau confédéral de la CGT de 1995 à 2009. Elle l’auteure, avec Rachel Silvera et Sophie Binet, de Féministe, la CGT ? : Les femmes, leur travail et l’action syndicale, Éditions de l’atelier, 2019 ; avec Robert Guédiguian (entretiens par Stéphane Sahuc), Parlons politique, Éditions Arcane 17, 2011.
Pierre Zarka a été secrétaire général de l’Union des étudiants communistes (UEC) de 1971 à 1973, avant d’être celui du Mouvement de la jeunesse communiste de France de 1979 à 1984. Directeur de L’Humanité, de 1994 à 2000, il quitte le PCF en 2009. Cofondateur de Observatoire du mouvement de la société (OMOS), il est un des animateurs de l’Association des communistes unitaires (ACU), membre d’Ensemble ! Il participe au collectif Se fédérer pour l’émancipation et au comité de rédaction de Cerises la coopérative.
Cheminot retraité, coopérateur des Editons Syllepse, Christian Mahieux est membre de SUD-Rail et de l’Union interprofessionnelle Solidaires Val-de-Marne. Il participe à l’animation du Réseau syndical
