Abolitionnisme : entretien avec Gwenola Ricordeau
Au tournant des années 1970-80 s’est formée la première vague de l’abolitionnisme pénal. Elle a profondément renouvelé le champ de la criminologie critique et les réflexions sur le crime, la peine et la prison. Gwenola Ricordeau fait découvrir ce courant de pensée qui inspire aujourd’hui les mouvements pour l’abolition de la police et de la prison, mais invite aussi à repenser la peine et le statut de victime.
Gwenola Ricordeau est professeure assistante en justice criminelle, à l’Université d’état de Californie, à Chico. Elle a publié Pour elles toutes. Femmes contre la prison, Editions Lux, 2019 ; (avec des textes de Nils Christie, Louk Hulsman, Ruth Morris), Crimes & peines. Penser l’abolitionnisme pénal, Traductions par Pauline Picot et Lydia Amarouche, Editions Grevis, 2021.
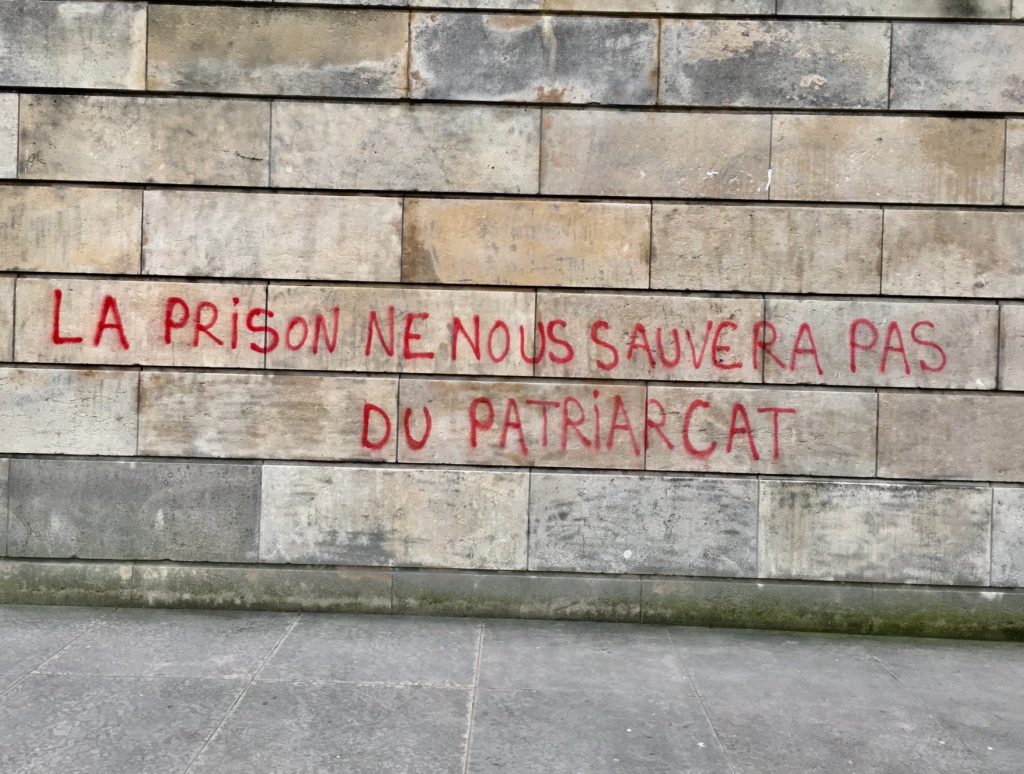
Peux-tu nous présenter ton dernier ouvrage, crimes et peines. Penser l’abolitionnisme pénal ?
Ce livre est construit autour de la traduction, inédite en français, de trois textes écrits entre 1977 et 1998 par des pionnier·es de l’abolitionnisme pénal : Nils Christie, Louk Hulsman et Ruth Morris. L’ouvrage débute par un prologue – un texte à la teneur plus personnelle qu’académique – et une introduction générale dans laquelle j’apporte un éclairage sur l’histoire des idées abolitionnistes. Chaque texte est accompagné par une explication sur le parcours intellectuel et politique de son auteur·e et sur le contexte dans lequel le texte a été écrit. Enfin, le livre se clôt sur un chapitre dans lequel je reviens sur les apports de ces textes et de ces auteur·es au développement des idées abolitionnistes et sur les enjeux politiques actuels des mouvements abolitionnistes.
Les trois auteur·es rassemblé·es dans ce livre ne constituent pas un « bloc ». En effet, leurs ancrages politiques, géographiques et disciplinaires sont divers : Nils Christie était un professeur de criminologie norvégien, Louk Hulsman un professeur de droit néerlandais et Ruth Morris était une quaker d’origine étatsunienne, qui a essentiellement vécu au Canada. D’ailleurs, Nils Christie représente plutôt le courant dit du « minimalisme pénal » (même si ses réflexions ont beaucoup inspiré les abolitionnistes), alors que Louk Hulsman et Ruth Morris plaident pour l’abolition du système pénal. Même s’il ne faut pas homogénéiser les réflexions de ces trois auteur·es, on trouve chez chacun·e une critique de la catégorie de « crime » et de ses usages. C’est notamment l’objet du texte de Louk Hulsman qui montre comment elle est liée à l’idée de la responsabilité individuelle, mais aussi à celle de la sanction. C’est pourquoi Louk Hulsman propose de réfléchir plutôt en termes de « situations-problèmes » plutôt que de « crimes ». Nils Christie, Louk Hulsman et Ruth Morris ont aussi en commun une critique des caractères afflictif et rétributif de la sanction pénale, et donc du recours à la punition. Si l’abolition du système pénal (la police, les tribunaux et la prison en particulier) est la définition stricte de ce qu’est le projet abolitionniste, il a néanmoins des liens puissants avec celui d’abolir l’enfermement (par exemple la rétention des personnes étrangères) ou le recours aux punitions (par exemple dans l’éducation).
Je ne peux pas revenir ici dans le détail sur les apports de chacun de ces textes, mais je voudrais souligner l’importance du texte de Nils Christie, « À qui appartiennent les conflits ? ». Il décrit comment le système pénal, en prenant en charge le traitement des crimes, dépossède les auteur·es d’infractions et leurs victimes, mais aussi le corps social dans son ensemble, de la « richesse des conflits ». Cette analyse du « vol des conflits » et des « voleurs de profession » (que sont notamment les avocat·es et les juges) a été non seulement une source d’inspiration importante pour les réflexions abolitionnistes ultérieures, mais aussi pour le développement de pratiques qui permettent de s’autonomiser du système pénal.
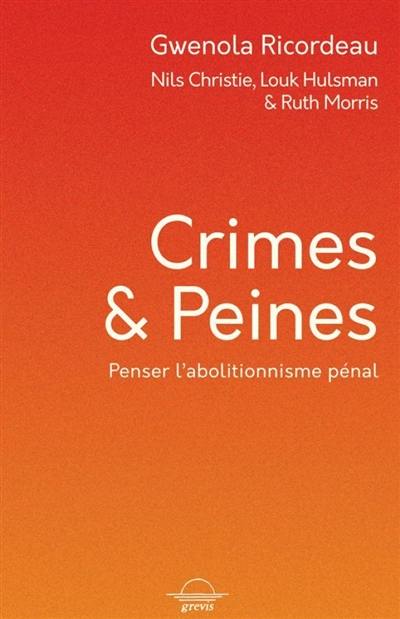
« La prison, ça peut arriver à n’importe qui mais c’est toujours les mêmes qui y vont », écris-tu. Qui sont-ils, qui sont-elles ?
On peut dire que, dans les pays occidentaux, les personnes incarcérées sont essentiellement des hommes, issus des classes populaires et/ou de l’histoire coloniale et de l’immigration.
Des hommes… En effet, ils constituent généralement plus de 95% des personnes incarcérées. Ils sont également surreprésentés parmi les personnes mises en cause ou jugées. En raison notamment de ce qu’on appelle le « paternalisme judiciaire », les femmes tendent à être moins souvent poursuivies et à être condamnées à des peines plus courtes (pour des faits similaires) – même si, à durée égale, une peine de prison a plus d’effets (matériels, sociaux, etc.) sur une femme que sur un homme.
Des pauvres… C’est aussi une caractéristique notable des personnes incarcérées. Non seulement parce que la criminalisation de certaines activités cible les pauvres, mais aussi parce que le parcours judiciaire des individus dépend de leur statut économique et social. Par exemple, les travaux de la sociologue Véronique Le Goaziou montrent que, en France, les hommes des milieux populaires sont très largement surreprésentés parmi les personnes condamnées pour des délits ou crimes à caractère sexuel – or ceci n’a rien à voir avec les caractéristiques sociales des auteurs de ce type de faits.
Troisième caractéristique importante de la population qui est incarcérée : elle est en grande partie issue de l’histoire coloniale et/ou de l’immigration. Là encore, il ne s’agit pas d’une exception française. Les mécanismes sociaux qui aboutissent à ce résultat sont multiples : il y a les discriminations raciales qui agissent à toutes les étapes du parcours judiciaire (depuis le « contrôle au faciès » des policiers jusqu’au prononcé des peines), mais également le fait que les personnes issues de l’histoire coloniale et/ou de l’immigration sont aussi parmi les plus pauvres et sont la cible de certaines politiques pénales. On peut évidemment penser aux politiques de criminalisation de la vente de certains produits stupéfiants, et plus récemment à la criminalisation du « harcèlement de rue », qui n’est destinée à punir que certains hommes (des hommes racisés, vivant dans des quartiers populaires).
C’est à mon sens important de souligner l’existence d’inégalités de classe et de race devant le système pénal – on pourra revenir sur le genre plus tard. Mais il faut aller au-delà : le fait que les pauvres et les minorités ethniques soient davantage criminalisées n’est pas le résultat de simples discriminations ou de dysfonctionnements. C’est un point important car il constitue une rupture entre les abolitionnistes et les réformistes : pour les abolitionnistes, la prison et plus généralement le système pénal fonctionnent parfaitement bien du point de vue de l’état, du système capitaliste et du suprématisme blanc. A l’inverse, les réformistes pensent qu’il a des dysfonctionnements qui doivent être réparés.
Justice de classe, justice injuste : en quoi l’abolitionnisme, qui vise le système pénal dans son ensemble et pas seulement la prison, rejoint-il ces constats, comment les dépassent-ils ?
J’ai évoqué le fait que Nils Christie, Louk Hulsman et Ruth Morris ne constituent pas un « bloc », et c’est évidemment vrai, plus généralement, de ce qu’on désigne par l’expression « abolitionnisme pénal ». Celle-ci fait référence à la fois à des développements théoriques et à des mobilisations politiques. On peut dire que c’est depuis le milieu des années 1970 que des personnes et des mouvements se réclament de l’ « abolitionnisme ». Bref, c’est un ensemble très riche de réflexions et de luttes qui est traversé par des débats théoriques et stratégiques. Par ailleurs, avant les années 1970 comme aujourd’hui, des mobilisations et mouvements sociaux peuvent avoir une ligne abolitionniste sans se réclamer explicitement de l’ « abolitionnisme ».
Ceci étant dit, l’expression « justice de classe » peut être entendue de diverses manières. Tout d’abord, elle dit les inégalités selon la classe face au système pénal : tout le monde sait que, si vous passez devant un juge, il vaut mieux être riche (et blanc) que pauvre (et noir, par exemple). Cette expression dit aussi que la justice est au service du capitalisme – et donc le caractère illusoire de placer des luttes pour l’émancipation sur le terrain judiciaire. Dire que la Justice est « injuste » peut renvoyer à un sens personnel de ce que serait une peine « juste », mais on peut l’entendre aussi dans un sens politique : cela souligne alors ce qui sépare la Justice de la « justice sociale ». Bref, dire que la Justice est une « justice de classe », qu’elle est « injuste », tout cela est incontestable, mais il ne faudrait évidemment pas oublier de dire qu’elle est aussi patriarcale et raciste notamment.
En fait, tous ces constats sont assez largement partagés et ils n’ont absolument rien de nouveau. Là où il y a une rupture entre abolitionnistes et réformistes, c’est que les discours réformistes entretiennent le mythe d’un système pénal qui pourrait se reformer. Or c’est un discours qui participe de la défense de légitimité de l’existence de la police, de la prison, et du système pénal dans son ensemble. D’un point de vue abolitionniste, il y a évidemment la nécessité de dépasser ces constats et de combattre les discours qui prônent la réforme du système pénal afin de faire entendre : le système pénal n’a pas des problèmes (qu’il faut résoudre), le système pénal est le problème.

Un des reproches faits à l’abolitionnisme est d’oublier les victimes. Le texte de Ruth Morris traite ce sujet. Tu peux nous en parler ? Mais, d’abord expliquer ce qu’est le Journal of Prisoners on Prisons, dans lequel il fut initialement publié en 1998 ?
C’est une question importante car ce reproche est fréquemment fait et il témoigne d’une méconnaissance de ce que sont les réflexions et mouvements abolitionnistes !
Le Journal of Prisoners on Prisons (JPP) est une revue académique canadienne qui a été fondée en 1988, suite à la troisième International Conference on Penal Abolition (ICOPA), qui s’est tenue à Montréal en 1987. ICOPA est une organisation importante dans l’histoire abolitionniste. La première conférence a eu lieu à Toronto en 1983 et se réunit aujourd’hui encore tous les deux ans environ, rassemblant des abolitionnistes du monde entier. Bref, JPP est une revue académique, publiée par les Presses de l’Université d’Ottawa et son comité de rédaction (dont Ruth Morris a été pendant un temps membre) est composé essentiellement d’universitaires. Mais c’est une revue un peu particulière car les auteur·es des articles sont pour la plupart en prison ou ont été incarcéré·es. Par ailleurs, la revue publie surtout des analyses radicales ou abolitionnistes du système pénal et de la prison. L’article « Deux types de victimes : Répondre à leurs besoins » de Ruth Morris est paru dans un numéro de JPP consacré à la question des victimes et à la montée en puissance des mouvements de victimes, qui sont souvent de type conservateur, voire réactionnaire. Ruth Morris y synthétise ses réflexions au sujet des victimes – des réflexions qu’elle avait déjà développées ailleurs, en particulier dans son livre Penal Abolition: The Practical Choice (1995). Elle évoque notamment l’influence sur sa pensée du travail d’Howard Zehr et des mennonites [1] autour de la justice restaurative, mais aussi de certains dispositifs inspirés des cultures autochtones, comme les cercles de sentence, les loges de guérison autochtones et les conférences communautaires.
Ruth Morris distingue deux types de victimes : les victimes de violences interpersonnelles et celles d’injustices systémiques, comme le racisme ou la pauvreté. Ruth Morris pointe ici un problème majeur du système pénal : il détourne notre attention des rapports de domination et des injustices qui ont un caractère structurel. Parmi celles-ci, Ruth Morris évoque le racisme, le classisme et le sexisme. D’autres mots, comme « capitalisme » et « patriarcat », seraient sans doute plus justes et on pourrait certainement ajouter à cette liste le (néo)colonialisme, le validisme et la destruction de l’environnement. Un autre aspect intéressant de l’article « Deux types de victimes : Répondre à leurs besoins » est la dénonciation par Ruth Morris de ce qu’elle appelle une « société pénalo-dépendante », c’est-à-dire « dépendante au » système pénal, et finalement peu soucieuse des besoins des victimes. Or, selon Ruth Morris, qu’elles soient victimes de violences interpersonnelles ou d’injustices systémiques, les victimes éprouvent toutes cinq besoins : obtenir des réponses à leurs questions, parfois triviales, sur les faits ; voir leur préjudice être reconnu ; être en sécurité ; pouvoir donner un sens à ce qu’elles ont subi ; et obtenir réparation.
La « dépendance au pénal » peut être illustrée de nombreuses manières, notamment par les appels à la création de nouveaux délits ou crimes pour résoudre des problèmes sociaux, par exemple en matière environnementale ou de lutte contre les violences faites aux femmes (féminicide, écocide, etc.). On peut aussi penser aux polémiques suscitées par la décision prise dans l’affaire du meurtre de Sarah Halimi de prononcer l’irresponsabilité pénale de l’auteur. En effet, de nombreuses voix se sont élevées pour dire qu’un procès était dû aux victimes.
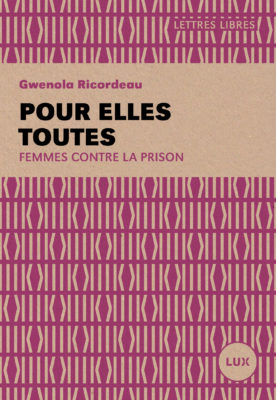
Comment les expériences révolutionnaires passées ou actuelles (Chiapas ? Rojava ?) intègrent-elles, ou non, une perspective abolitionniste ?
Il y a une forme de bizarrerie dans la formulation de cette question car, comme je l’évoquais, l’expression « abolitionnisme pénal » n’est pas toujours revendiquée ou utilisée par des mouvements ou des luttes qui aspirent néanmoins à la destruction du système pénal. On peut notamment penser aux mouvements anarchistes, aux mouvements de libération africaine-américaine comme les Black Panthers… Tous les mouvements révolutionnaires en arrivent à se poser la question de la justice, en raison de leur expérience de la répression qu’ils subissent et parce que cela fait partie des problèmes auxquels ils sont confrontés en cas de renversement de l’état ou de la libération de certains territoires. Je n’ai pas travaillé sur cette question, mais je pense qu’il y a forcément des sources d’inspiration à trouver dans des expériences révolutionnaires passées ou actuelles. Je dis « sources d’inspiration » car il faut garder à l’esprit que tout cela s’inscrit dans des contextes historiques et culturels et que les voies de l’émancipation sont multiples.
Si on a un tant soit peu des aspirations révolutionnaires, on ne peut qu’être profondément choqué qu’en France certaines centrales syndicales n’aient pas pris position contre la syndicalisation en leur sein des policiers ou des personnels pénitentiaires (je pense par exemple à la CGT Pénitentiaire ou à Sud Intérieur). Si on peut avoir de nombreuses discussions sur la stratégie révolutionnaire, il me semble peu discutable qu’on ne construit pas un mouvement social progressiste avec des personnels pénitentiaires et des policiers et sans interroger les fonctions qu’ils occupent dans notre société. Par ailleurs, il y aurait également beaucoup à dire sur l’illusion qui est entretenue dans une partie de la gauche sur la possibilité qu’il y ait des juges progressistes.

Une dernière question, qui porte sur ton précédent livre : Pour elles toutes. Femmes contre la prison. Tu peux nous en parler brièvement ?
Le point de départ de ce livre était un « nœud » : le fait que les luttes féministes et les luttes abolitionnistes soient souvent présentées, notamment en France, comme antagonistes. Les premières sont réputées plaider, dans leur ensemble, pour plus de répression, tout particulièrement à l’encontre des auteurs de violences faites aux femmes. Dans le même temps, les luttes abolitionnistes sont généralement soupçonnées de se désintéresser des victimes – ce qui, comme je viens de le dire, est totalement faux. Mon livre s’attaque donc à un ensemble de questions : Le système pénal protège-t-il les femmes ? Qu’est-ce que le système pénal fait aux femmes qui y sont confrontées ? Faut-il inscrire les luttes féministes sur le terrain du droit ? Pour y répondre, je propose une analyse – notamment à la lumière de la criminologie féministe – des manières dont les femmes sont affectées par l’existence du système pénal, et en particulier par celle de la prison. C’est à partir de cette analyse que j’entreprends de répondre à deux autres questions, d’ordre théorique et stratégique : Comment penser l’articulation des analyses féministes et abolitionnistes ? Quelles stratégies adopter pour s’émanciper du système pénal ?
Le livre débute par une synthèse des réflexions abolitionnistes à partir des fonctions généralement attribuées à la sanction pénale (la rétribution, la dissuasion, la réhabilitation et la mise hors d’état de nuire). Ensuite, je propose une analyse des différentes manières dont les femmes sont affectées par l’existence du système pénal à partir de trois catégories : les femmes victimes (quel que soit le type de victimation), les femmes criminalisées et enfin celles qui ont des proches criminalisés. La question des proches de personnes incarcérées me tient particulièrement à cœur car j’ai eu des proches en prison. C’est la raison pour laquelle j’ai mené mes premiers travaux sociologiques sur ce thème (voir mon livre : Les détenus et leurs proches. Solidarités et sentiments à l’ombre des murs, 2008), en montrant notamment comment les solidarités matérielles, financières et émotionnelles avec les prisonnier-e-s reposent essentiellement sur les femmes.
La dernière partie du livre se situe sur un plan politique et stratégique. J’y reprends des analyses qui ont été faites des manières dont le populisme pénal prétend protéger les femmes (ou les enfants) pour justifier une intensification des politiques pénales et je décris les impasses d’un féminisme « mainstream » qui s’appuie sur le système pénal – le « féminisme carcéral » pour reprendre l’expression d’Elizabeth Bernstein. Tout cela permet d’esquisser des pistes de réflexion pour une stratégie politique abolitionniste et féministe…
Gwenola Ricordeau ; Propos recueillis par Christian Mahieux
[1] Groupe religieux et culturel fondé au XVIème siècle pendant la Réforme protestante.
