Vers une démocratie autogérée ? Dans et hors de l’entreprise
Trop connotée, difficile à mettre en œuvre sur le plan pratique et contradictoire avec le système capitaliste, pour ses contempteurs, l’autogestion serait reléguée au rang des utopies passées de mode depuis les années 1970. Pourtant, la période montre qu’il est plus que jamais nécessaire de reposer la question de la démocratisation de l’économie et du travail qui concilierait (voire réconcilierait) le rôle de travailleur/travailleuse et citoyen/citoyenne.
La première partie de ce texte est initialement paru dans Cerises la coopérative n°47, mai 2023 (www.ceriseslacooperative.info)
Militante de Solidaires Finances publiques dont elle a été déléguée nationale adjointe, Ophélie Gath est membre du Secrétariat national de l’Union syndicale Solidaires. Elle a publié (avec Vincent Drezet) Argent public pour mieux vivre ensemble. Impôts, dépense publique, service public, protection sociale : et maintenant que fait-on ? Éditions L’Harmattan, 2021.

Si pour les gouvernants, la crise démocratique n’existe pas au motif qu’ils ont été élus et qu’ils appliquent un programme dans le respect du cadre institutionnel, nous vivons en réalité la plus grave crise démocratique de ces 50 dernières années. On observer une fracture entre une grande partie de la population et celles et ceux qui exercent le pouvoir. Le président de la République a négligé depuis le début de son mandat les « corps intermédiaires » de toute sorte, et singulièrement les organisations syndicales (si tant est que ce soient des « corps intermédiaires). Malgré des alertes récentes comme la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron et son gouvernement ont estimé que leur projet était le seul possible et qu’il ne souffrait d’aucune alternative. Dés lors, face au rejet massif du projet de contre-réforme, la seule issue possible pour le pouvoir était de l’imposer, « coûte que coûte » et de veiller à ne tenir aucunement compte de la position des organisations syndicales alors que celles-ci étaient jugées plus représentatives et légitimes que le gouvernement. Les artifices et arguments du pouvoir (l’utilisation de textes constitutionnels, l’absence de vote de l’Assemblée nationale, le 49-3, les déclarations provocatrices ou encore la répression policière ont largement contribué à aggraver la crise.
Ce qui est aujourd’hui rejeté est donc sa manière d’être, de se comporter, ses mesures et la façon dont fonctionnent les institutions, en quelque sorte une crise d’illégitimité de cet ensemble. A contrario, le conflit retraites et les enjeux liés au pouvoir d’achat dans un contexte inflationniste ont réhabilité le rôle et la légitimité des organisations syndicales et du mouvement social. Comment éviter qu’une nouvelle mesure illégitime soit imposée et comment faire vivre une vraie démocratie sociale, dans l’exercice du pouvoir et dans nos entreprises et administrations, sur nos lieux de travail ? Répondre à ces questions est d’autant plus nécessaire que les enjeux économiques, sociaux et écologiques actuels sont immenses.
La question démocratique se pose à tous les niveaux
Dans le monde du travail, il est urgent d’associer les salarié·es aux décisions de l’entreprise, concerné·es au premier chef. Ceci suppose de donner un véritable rôle aux travailleur·ses et à leurs représentant·es, dans toutes les instances – y compris celles qui régissent les stratégies. La démocratie sur les lieux de travail ne saurait toutefois être réelle si elle reste guidée par les objectifs actuellement dominants. Ceci implique par conséquent de sortir du management actionnarial, avec la finance et les profits pour seule boussole, et préférer des formes de lieux de travail plus coopératifs et solidaires au sein desquels la démocratie sociale s’exprime réellement. Il s’agit aussi ici de refaire sens et de faire rimer conditions de travail et conditions de vie. « L’objet social » de l’entreprise en serait profondément réorienté et les services publics retrouveraient leur sens premier. La démocratie doit également pouvoir vivre et s’exprimer dans les choix concernant la population. De ce point de vue, l’exercice solitaire et de plus en plus intolérant est discrédité.
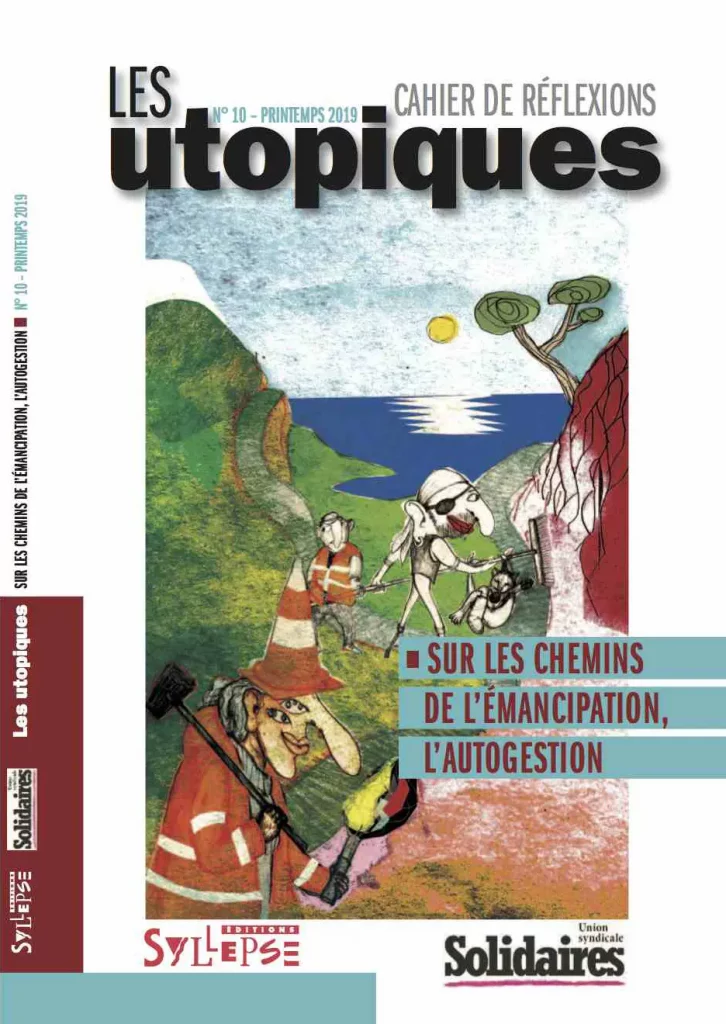
Il nous faut donc revoir le modèle social dominant et faire émerger un autre projet, celui auquel semble aspirer une part croissante de la société au regard de l’érosion intrinsèque du modèle capitaliste qui au-delà de creuser les inégalités, aliène les travailleurs∙ses et pourrit la planète. Cette transformation sociale passe par une forme d’autogestion, laquelle reste cependant à définir et construire collectivement, et qui ne peut être déconnectée des enjeux écologiques. Dans cette approche, et sans aller dans le détail, la population doit se sentir représentée légitimement avec des consultations des organisations du mouvement social, mais aussi des consultations directes de la population et globalement à réussir le défi de construire une société des égalités, avec le respect des minorités.
La démocratie ne résulte pas en un vote périodique, lequel exclut au passage les personnes qui vivent et travaillent dans notre société, les étranger·es sont privé·es d’un droit fondamental qu’est celui de l’expression, et de participer à une vie collective. Sur la base de règles claires connues et reconnues, la démocratie : c’est partout et tout le temps. Un nouveau contrat social, en somme !
Face à la crise du « travail », quelle voie pour l’autogestion sociale et écologique ?
Le débat sur le travail que la contre-réforme des retraites a, de facto, alimenté le démontre aisément : parler de la place et du rôle du travail, mais aussi de son organisation et de son sens profond est l’affaire de chacun∙e. Dès lors, on ne peut ignorer les enjeux et l’approche d’une organisation dans laquelle les travailleuses et travailleurs auraient une place centrale dans les décisions et qui remettrait en cause le management, l’individualisation et, finalement, l’objectif surdéterminant consistant à dégager un profit capté pour l’essentiel par une minorité d’agents économiques. La question est d’autant plus sensible que, fidèle à sa capacité d’appropriation des concepts pouvant le gêner, le capitalisme porte une approche très individualisée de l’autogestion. Face à celle-ci, qui ferait de l’autogestion un outil au service de la seule rentabilité, il nous faut donc penser une organisation qui place les travailleuses et travailleurs au centre des décisions dans la gestion de la production et la répartition de la richesse créée.
« L’autogestion » à la sauce capitaliste
La flexibilité, la performance ou encore l’évolution du mode de travail redessinerait-elle l’autogestion ? C’est ce que pourrait laisser croire le discours managérial selon lequel il faudrait que la coordination du travail, certains arbitrages ou encore des choix techniques et fonctionnels soient décidés par les travailleurs et travailleuses. A titre d’exemple, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les réunions visant à les « associer » pour porter des propositions de simplifications, de revue et d’amélioration des process ou tout simplement pour l’organisation matérielle des open-spaces évoluant vers des flex-offices ont tendance à se multiplier. Il en va de même pour l’organisation du télétravail, de plus en plus répandu. La participation de toutes et tous étant au cœur de ces échanges, cette évolution du travail est par conséquent présentée comme procédant d’une meilleure collaboration et le fruit d’une intelligence collective de l’ensemble des personnels. Ces transformations redéfiniraient le rôle du manager, lequel serait incité à mieux gérer l’humain grâce à des techniques de coaching, de communication et de gestion du stress. Tout cela relèverait donc d’une autogestion positive, car tournée vers la performance et le développement des compétences.
Seulement voilà, outre que ce qu’il faut bien appeler « mode de gouvernance et de management » n’associe pas les citoyen∙nes à l’orientation que doit prendre le travail par exemple, l’objectif reste d’améliorer la productivité pour, in fine, améliorer la rentabilité de l’entreprise et, dans le secteur public comme dans le secteur privé, de réduire les coûts. Évidemment, la propriété de l’entreprise relève ici toujours des actionnaires qui veillent jalousement à leurs intérêts ; en témoignent les versements records de dividendes de ces deux dernières années. Ces dividendes nourrissent non seulement des patrimoines économiques et personnels de plus en plus importants, mais aussi un système de domination, au sein duquel le pouvoir est concentré dans un nombre réduit de personnes et de (très grandes) sociétés, qui pèse sur l’organisation de la vie en société. Cette captation de la valeur apparaît d’autant moins soutenable et supportable que nos sociétés font face à des défis écologiques et sociaux majeurs. Permettre à chacun et chacune de vivre dignement implique d’améliorer la rémunération du plus grand nombre de d’augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée. En outre, financer la transition climatique et réduire les inégalités suppose ainsi des rentrées fiscales, mises à mal par des décennies de politiques fiscales injustes marquées d’une part, par des baisses d’impôt dont les grandes entreprises et les plus riches sont les grands bénéficiaires et d’autre part, par un évitement colossal de l’impôt. Ces politiques ont accru les injustices et nourri une crise démocratique qui est apparue au grand jour au premier semestre 2023.
Lier « travail » et « démocratie » ne saurait donc s’inscrire dans une approche qui fait du capitalisme un système indépassable face auquel il n’y aurait pas d’alternative.
Quelle approche de l’autogestion de demain ?
L’autogestion consiste à penser un travail (ou une activité) dirigé directement par les travailleurs/travailleuses, qui en définissent et suivent collectivement et directement les règles, les normes et les institutions. Il ne s’agit plus ici d’obéir à des consignes décidées en amont. Le refus d’une hiérarchie verticale et d’une division entre « gouvernant∙es » et « gouverné∙es », autrement dit entre patrons ou actionnaires et salarié∙es (direct∙es ou sous-traitants) accompagne cette organisation. Enfin, dans un tel cadre, les citoyen∙nes sont également associé∙es aux objectifs et sont informé∙es de l’évolution du travail d’une entreprise. Toutes les parties prenantes (travailleurs, producteurs, utilisateurs, consommateurs, membres de soutiens divers, etc.) étant concernées, il est en effet légitime qu’elles aient leur place dans les prises de décisions et dans leur mise en œuvre.
Outil d’une véritable transformation sociale, qui doit également poursuivre un objectif écologique, l’autogestion demeure compatible avec des formes d’entreprises coopératives et ce qu’il est convenu de nommer « l’économie solidaire ». Basée sur une remise en cause du fonctionnement managérial et hiérarchique traditionnel, elle n’implique pas pour autant une absence de la division du travail ni par conséquent que tous les personnels fassent tout et n’importe quoi. Elle repose sur le principe fondateur selon lequel elle se concentre sur la participation aux décisions, leur mise en œuvre et sur l’organisation du travail.
Une telle organisation doit donc être structurée afin que les modalités de discussions, de décisions et de mise en œuvre soient claires, démocratiquement décidées ex ante et évaluées ex post. Ce faisant, elle favorise l’implication et l’émancipation de chacun.e. Au fond, si plusieurs modalités pratiques sont possibles (rotation de mandats, contrôle, etc), le principe est que la décision finale est toujours du ressort du groupe formé par les travailleuses et travailleurs. Les décisions et les orientations doivent par ailleurs associer les populations puisqu’elles peuvent directement être concernées sur les conséquences des choix de l’entreprise qu’il s’agisse des conséquences sociales (la politique de l’emploi dans un bassin économique donné) ou environnementales (pour faire face au risque de pollution) par exemple.

Quelle forme pourrait prendre les entreprises autogérées ? On peut évoquer ici les actuelles Sociétés coopératives de production (SCOP), qui reposent sur une gouvernance démocratique. Les salarié∙es ayant le statut d’associé∙e sont en effet nécessairement associé∙es majoritaires de la société et possèdent donc au minimum, ensemble, 51 % du capital social. Aucun∙e associé∙e ne peut détenir plus de la moitié du capital et concentrer ainsi le pouvoir. Lors d’un départ d’un∙e salarié∙e ayant le statut d’associé∙e, le capital qu’il ou elle a investi lui est remboursé, Tous les salarié∙es d’une SCOP n’en sont pas associé∙es, mais ont vocation à le devenir. La forme associative, à but non lucratif, est également une forme d’organisation à prendre en compte. Cet existant constitue en quelque sorte un « point de départ » que rien n’empêcherait de faire évoluer. Dans une action complémentaire à celles des services publics, ces organisations nouvelles du travail pourraient également se décliner en Sociétés coopératives d’intérêt général. Celles-ci n’auraient pas vocation à dégager un profit. Organisées autour du principe « un associé = une voix », elles pourraient intervenir dans la prise en charge de certains travaux, par exemple en matière d’isolation thermique des bâtiments publics ou de transports publics de proximité. Là aussi, la population et ses représentant∙es seraient associé∙es aux décisions et à la gestion d’une structure poursuivant par définition un objectif d’intérêt général.
Pour nourrir la réflexion, il peut être utile d’analyser par exemple la façon dont plus d’une centaine de maisons médicales fonctionnent en Belgique. Celles-ci ont en effet remis en cause le fonctionnement hiérarchique traditionnel et offrent une large place aux travailleuses et travailleurs dans la gestion. Si la place centrale revient à l’usager∙e, toutes les parties prenantes travaille ensemble : médecins généralistes, infirmier∙es, travailleurs et travailleuses sociaux, etc. Du fait de leur proximité avec la population, elles occupent une place importante dans les quartiers où elles sont situées.
Si cette nouvelle autogestion peut se concevoir à l’échelle locale voire sur certains secteurs particuliers et dans des structures de taille réduite voire moyenne, rien n’empêche de réfléchir à un mode d’organisation inspiré des mêmes principes dans des structures de grande taille. Chaque salarié∙e peut en effet être associé∙e aux décisions de son unité de travail locale et mandater un ou une représentant∙, qui rendrait compte, pour le niveau que l’on qualifiera ici de plus « global ». Enfin, l’idéal serait qu’au plan national, cette organisation autogérée du travail soit portée dans une orientation politique et mise en œuvre dans le cadre d’une planification stratégique. Sans cela en effet, elle n’apparaîtra que comme un supplément d’âme dans un système inchangé alors qu’elle a vocation à s’inscrire dans une transformation profonde et globale.

- Du congrès Solidaires… - 31 août 2024
- Dialectik Football - 30 août 2024
- Le Miroir du football : un journal de référence - 29 août 2024
