Défaire le fascisme, affronter le racisme
Nous avons demandé à Omar Slaouti et Ugo Paletha dont le livre Défaire le racisme, affronter le fascisme est sorti en mars 2022 (éditions La dispute), de revenir sur les liens politiques entre racisme et fascisme et ceux qui sont à construire dans nos combats.
Ugo Palheta est militant anticapitaliste, sociologue et co-directeur de la revue en ligne Contretemps. Il est maître de conférences à l’université de Lille. Il est l’auteur notamment de La possibilité du fascisme – France, la trajectoire du désastre (Editions La Découverte, 2018) et, avec Ludivine Bantigny, Face à la menace fasciste (Editions Textuel, 2021). Professeur dans un lycée d’Argenteuil, Omar Slaouti est militant antiraciste, codirecteur de l’ouvrage Racismes de France avec Olivier Le Cour Grandmaison et 21 contributeurs et contributrices. Il a été l’un des porte-parole de la Marche pour la justice et la dignité et contre les violences policières en 2017, du collectif Rosa Parks en 2018, et l’un des initiateurs de la Marche contre l’islamophobie en 2019. Tous deux sont membres de la FSU.
Retraitée d’Orange, militante de SUD PTT, Verveine Angeli a été membre du secrétariat national de l’Union syndicale Solidaires de 2014 à 2020. Membre d’ATTAC-France, elle est aussi active au sein de la Fédération des associations de solidarité avec tou·te·s les immigré
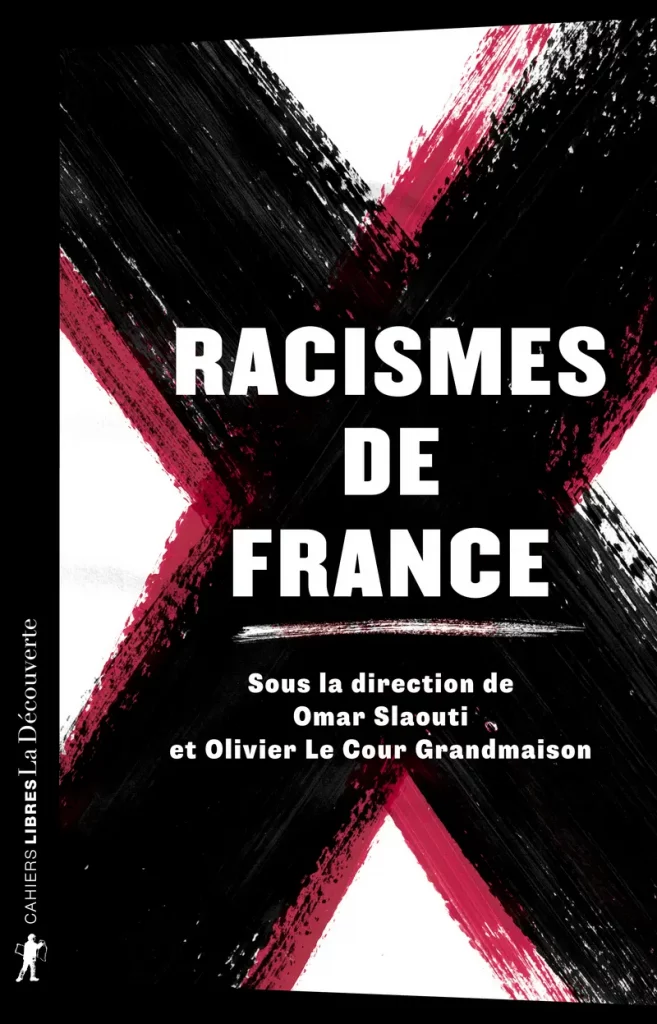
Verveine Angeli : Vous dites que le racisme n’est pas le privilège de l’extrême droite, pourtant dans les milieux syndicaux l’assimilation est souvent faite. Pouvez-vous développer ce que vous pensez du racisme dans une grande partie du monde politique ? Du lien avec le passé colonial ?
Omar Slaouti : Tout d’abord, comment expliquer que du RN à Zemmour en passant par Dupont-Aignan l’extrême-droite puisse occuper la tête des voix exprimées au premier tour de ces présidentielles, avec 32% des voix et 13,2 millions d’électeurs et électrices à ce second tour des présidentielles ? Ceci n’est rendu possible que parce que le racisme et l’islamophobie, dont la matrice est coloniale, débordent l’extrême-droite. L’erreur serait de penser ces courants politiques fascistes comme exogènes ou à la marge des structures sociales de la société française, et qu’ils auraient gagné du terrain par capillarité, au détour de crises d’hégémonie, en ramenant un racisme périphérique au centre du monde social et politique. Le roman national aimerait que cette fable puisse encore permettre la croyance en une République immaculée, aux institutions et idéaux suspendus hors du temps, surplombant tous les espaces sociaux. Il n’en est rien ; suite à cinq siècles d’esclavagisme, de colonialisme et d’impérialisme qui ont permis l’émergence du capitalisme et des sociétés dites « modernes », le racisme comme rapport social de domination est non seulement transversal mais structure tous les espaces sociaux, y compris ceux qui se revendiquent de l’émancipation sociale comme les partis de gauche et les syndicats – à l’instar du patriarcat et du sexisme. Ce que certain∙es nomment par confort d’esprit « l’extrême-droitisation » de la société révèle, en réalité, ce racisme systémique dont les racines historiques permettent « l’ensauvagement » dont parle Aimé Césaire [1] à propos du continent européen. Si le génie scientifique français a construit puis classifié les Races pour légitimer l’esclavagisme, le colonialisme et le nazisme, le même génie politique a aussi substitué à la définition scientifiquement réfutée des Races biologiques celle d’essences culturelles immuables dans l’espace et le temps. Après le génocide des Juifs et des Tsiganes, les Races scientifiques déchues en légitimité ont ainsi perdu leur majuscule pour faire place à la race sociale, qui à son tour a été convoquée, tant par la droite que par la gauche, pour légitimer les hiérarchisations sociales et poursuivre les conquêtes coloniales, l’impérialisme et la surexploitation capitaliste des racisé.es d’en bas. C’est cette mécanique qui permet de comprendre comment une partie de la gauche, après avoir été anti-dreyfusarde ou vichyste, a pu poursuivre son œuvre coloniale et raciste. Dans notre livre Défaire le racisme, combattre le fascisme, Ugo Palheta et moi rapportons non seulement les trahisons de la gauche et ses rendez-vous manqués avec les luttes de l’antiracisme politique, mais aussi les orientations politiques racistes de celle-ci, y compris de la gauche dite radicale ou extrême.

Verveine Angeli : Vous développez que la menace fasciste se construit aussi aujourd’hui sur des politiques racistes de l’État ?
Omar Slaouti : En synergie avec cette transversalité horizontale du racisme, existe le racisme étatique, lui vertical : celui originel de l’État-nation, celui dans l’État avec ses institutions et celui assumé par l’État. La création de l’État-nation, qui a pour matrice la race, s’ingénie à construire une identité française fantasmée, par opposition et par écrasement de toutes les altérités, elles-mêmes essentialisées et hiérarchisées – tant et si bien que l’identification administrative des étrangers précède l’identité nationale. C’est cet État-nation qui se fait centre au nom de valeurs proclamées « universelles » et des dites « Lumières », rejetant dans les marges du monde les peuples du Sud global, juste bons à être colonisés, civilisés. Le racisme dans l’État ou racisme institutionnel, fonctionne sans intentionnalité, ce qui produit les effets les plus pernicieux. La distribution et la stratification raciales du travail et des tâches, les trajectoires raciales de diplomation et d’exclusion scolaire, les parcours raciaux dans l’accès aux soins et dans les soins eux-mêmes sont entre autres autant de blessures dans nos chairs individuelles et collectives de la racialisation de la société. La gauche et a fortiori la droite et son extrême, nient voire réfutent cette mécanique racialiste qui produit les racisé.es d’en bas et d’en haut, ces non-blancs et ces blancs, c’est-à-dire ces statuts sociaux et politiques différenciés et hiérarchisés selon la race. Au nom de l’exploitation capitaliste sans couleur, au nom du « même patron, même combat ! », au nom toujours de la bienveillance morale de secteurs ou d’espaces sociaux comme l’Éducation, la santé, les arts et la culture, le sport, l’humour… la race comme opérateur de hiérarchisation est effacée, la cécité aux discriminations raciales, le color blind deviennent la norme.
Reste le racisme par l’État, celui qui s’assume pleinement par des propos, des décrets, des lois dont les intentions racistes à peine voilées font ruisseler du haut vers le bas ce que l’on nomme communément le racisme d’État. C’est ce racisme qui rejette dans la zone de non-être ceux et celles qui fuient les désordres du monde, les guerres, les famines, les dérèglements climatiques causés par les pays impérialistes. C’est encore ce racisme qui s’affiche dans le bras armé de l’État qui mutile, tue et blesse nos dignités, ceux et celles communément nommé.es les habitant.es des quartiers populaires, qui sont en réalité principalement des noir.es et des arabes de par la ségrégation socio-raciale, en plus des femmes de familles monoparentales. La police et la gendarmerie qui ont majoritairement voté à l’extrême droite se sentent aujourd’hui encore plus qu’hier légitimés à nous écraser, et ce d’autant plus que l’État a fait de nous des ennemis de l’intérieur, sous ce gouvernement et sous les précédents dits de gauche. Nous n’en sommes pas évidemment à l’État raciste propre au fascisme que le RN aurait mis en place, mais à ce qui le précède, la fascisation opérée par Macron mais qui pourrait très bien selon les rapports de force à venir opter pour un régime fasciste. Il n’y aurait aucune contradiction entre néo-libéralisme assumé et le fascisme, d’autant que cette forme financiarisée à l’extrême du capitalisme a fait historiquement ses premiers pas sous le régime fasciste de Pinochet.
Verveine Angeli : Et vous dites que la loi séparatisme est un symbole de ce racisme d’État et des complicités de la société française.
Omar Slaouti : Les discussions à l’Assemblée nationale et au Sénat autour de la loi séparatisme qui est la dernière loi ouvertement islamophobe, ont pu rendre compte de cette France raciste bien avant les scores de l’extrême droite à ces dernières élections présidentielles. On se souviendra par exemple que « l’amendement UNEF » contre les réunions non-mixtes a été voté à l’unanimité au Sénat. Comme on se souviendra que la mobilisation contre cette loi a été inexistante pour l’écrasante majorité des organisations qui avaient mobilisé quelques semaines avant et à juste titre contre la loi Sécurité globale. Même l’article 24 de cette dernière, interdisant de filmer la police et de diffuser les images, qui avait disparu grâce à la mobilisation d’une coalition rassemblant plus de 100 organisations, a été réintroduit dans l’article 36 de la loi séparatisme, sans même que cela ne suscite une condamnation de la part de ce contre-pouvoir éphémère et sélectif. Si pour de trop nombreuses organisations se revendiquant de l’émancipation sociale (associations, syndicats et partis politiques), le terme d’islamophobie choisi par les victimes du racisme antimusulman fait encore blocage, alors le concept d’islamophobie d’État, lui, relève à fortiori à leurs yeux de l’ineptie, d’un non-lieu. Tout comme aux yeux des auteurs de l’article 9 de la Charte des principes de l’Islam qui affirme que les « actes antimusulmans sont l’œuvre d’une minorité extrémiste qui ne saurait être confondue ni avec l’État ni avec le peuple français. Dès lors, les dénonciations d’un prétendu racisme d’État, comme toutes les postures victimaires, relèvent de la diffamation. Elles nourrissent et exacerbent à la fois la haine antimusulmane et la haine de la France ». On comprend dès lors que les 4000 portes fracturées de personnes de confession ou de culture musulmane ont pu être fracassées à l’aube dans un silence assourdissant et de fait complice. Si pour Darmanin, il s’agissait de « donner un signal », les musulmans∙es de ce pays auront reçu un autre signal, celui d’être isolé∙es dans leur condition d’oppression raciale.

C’est dans ce contexte de légitimation de l’islamophobie que 13,2 millions de personnes ayant voté Le Pen, et bien davantage encore si on ajoute une dizaine de millions d’islamophobes dans le vote Macron ou parmi les abstentionnistes, que nous pouvons réaffirmer que les idées racistes ne sont pas l’apanage des extrêmes droites mais irriguent l’essentiel des partis politiques de droite et même de gauche. C’est dans ce même contexte qu’il faut analyser l’un des événements majeurs de ce premier tour des présidentielles, à savoir la mobilisation pour le vote Mélenchon des dits « Français de papiers », de ces Arabes, de ces noir∙es, de ces musulman∙es des quartiers populaires. Le seul qui à la fois pouvait se prévaloir d’être au second tour sur un programme de partage des richesses et qui dénonce simplement la chasse aux sorcières islamo gauchistes et aux musulman∙es en assumant d’avoir participé à la manifestation du 19 novembre 2018 contre l’islamophobie, après l’attaque de la mosquée de Bayonne. Il n’y avait rien dans la démarche de particulièrement audacieux, mais les attaques islamophobes de toutes parts sont telles que la perspective d’abrogation de la loi séparatisme raciste, ajoutée à une politique de partage des richesses, ouvrait des horizons d’espérance dans cet abîme social et racial où s’écrasent nos vies et nos dignités. Les logiques d’appareil à gauche et le déni de cette période de fascisation avec le fascisme comme issue possible ont eu raison de nos espérances et de nos nécessités. Et même si, au final, Macron aurait gagné de toute façon, nous aurions eu droit à la construction d’un rapport de forces davantage en notre faveur. C’est en ce sens que les militant∙es des quartiers populaires du collectif On s’en mêle ont appelé à voter Mélenchon tout en gardant leur indépendance et sans illusion sur une quelconque figure prophétique.
Verveine Angeli : Vous distinguez fascisation et fascisme. En quoi est-ce opérant pour parler de la situation politique en France ? Et quelle est la place des politiques racistes et islamophobes dans cette situation ?
Ugo Paletha : Il s’agit de casser l’idée que le fascisme n’est un danger que pour après-demain, quelque chose d’effrayant mais dans un horizon relativement lointain, une catastrophe qu’on pourrait voir venir à l’avance et qu’on pourrait alors conjurer aisément. Or, ce n’est pas comme ça que les choses se passent. Le fascisme n’apparaît pas comme un éclair dans un ciel serein : il y a toute une trajectoire qui mène vers ce type singulier de régime, un type de pouvoir qui brise ou étouffe toutes les oppositions, et pousse jusqu’au nettoyage ethnique les logiques et les politiques racistes. Il y a tout un processus préparatoire, qui imprègne les institutions de l’État et habitue les cerveaux, si bien que lorsque le fascisme est là et qu’il toque à la porte du pouvoir, il est en général déjà trop tard. C’est ce processus que l’on nomme fascisation, et on essaie d’expliquer dans le livre, Omar Slaouti et moi-même, en quoi cela consiste. Effectivement, l’un des vecteurs les plus puissants de la fascisation, c’est le racisme. Celui-ci n’a pas besoin du fascisme pour prospérer, c’est évident comme vient de le montrer Omar : il renvoie à une autre temporalité, qui est en grande partie celle du capitalisme (notamment via l’esclavage) ; il est présent partout et sous des formes diverses (violences physiques, discriminations, déni de dignité, stigmatisation, micro-agressions, etc.). À l’inverse, ce nationalisme radical qu’est le fascisme peut difficilement se développer sans le racisme dans la mesure où celui-ci permet de coaliser, de cimenter, de mobiliser voire de soulever ce qui est la clientèle du fascisme : cette « poussière humaine » dont parlait Trotsky, un ensemble très disparate d’individus et de couches sociales.
Ces derniers n’ont guère d’intérêt en commun mais, face à une crise profonde et multiforme qui tend à détruire tous les repères et à provoquer le désespoir, ils peuvent être attirés par la mystique fasciste de la nation en proie à un processus de délitement, de décomposition ou de déclin, nation qui aurait besoin d’être purgée pour retrouver non seulement son identité profonde, mais aussi son homogénéité fantasmée et sa gloire d’autrefois. Le fascisme a besoin d’un ennemi absolu, d’un ennemi à la fois intérieur et extérieur, qui voudrait la mort de la nation et qui œuvrerait en sous-main. Il a pu parfois le trouver dans le mouvement ouvrier (en Italie par exemple au début des années 1920), l’Internationale communiste pouvant notamment apparaître comme une hydre à mille têtes, puissante et menaçante, mais dans bien des cas c’est le racisme qui le lui a fourni : les Juifs·ves, les Rrom·es, les musulman·s, etc., et bien sûr plus généralement les étranger∙es (ou plutôt celles et ceux perçu·es comme tel·les, aujourd’hui plus particulièrement les migrant·es venu·es du Sud global) et les minorités (ethno-raciales ou religieuses).
Le racisme est donc le plus formidable catalyseur du fascisme, sa locomotive. Et l’on voit bien alors que la force du fascisme, en particulier dans une vieille puissance impériale en déclin comme la France, c’est de s’appuyer non pas sur ses seules forces militantes ou sur la seule habileté rhétorique de ses dirigeant·es, mais sur le racisme systémique et institutionnel, s’exprimant sous des formes matérielle et idéologique, économique et politique, dans les interactions ordinaires comme dans la logique des institutions (voir le livre Racismes de France [2] dirigé par Omar et Olivier Le Cour Grandmaison). Le fascisme apparaît alors pour ce qu’il est : non pas une force antisystème, comme il se présente, mais la pointe la plus acérée du système (raciste, capitaliste, patriarcal, etc.) ; non pas une « révolution » ou une rupture comme il se proclame, mais comme une contre-révolution et le développement jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à ses plus terribles conséquences, des pires tendances des sociétés dans lesquelles nous vivons.
Verveine Angeli : Alors quelle est la responsabilité de Macron dans ce processus ?
Ugo Paletha :La romancière africaine-américaine Toni Morrison disait que, pour qu’il y ait une « solution finale », il a fallu qu’il y ait une solution première, puis une solution seconde, etc. Manière de dire que les formes génocidaires du racisme sont l’aboutissement de politiques de démonisation et de déshumanisation qui les précèdent et les préparent. Et c’est bien ce que ce que voulons pointer lorsque nous parlons de fascisation. Macron n’est pas un fasciste, son projet c’est la refonte de tous les rapports sociaux dans un sens néolibéral : marchandisation, privatisation, intensification de toutes les concurrences pour ceux d’en bas, etc. Mais pour mener sa politique et faire face aux résistances qu’elle engendre nécessairement, Macron a été amené à accentuer le cours autoritaire de l’État, initié dès le milieu des années 2010 sous Hollande, et à user de l’arme raciste : en accentuant la logique du bouc-émissaire ciblant les musulman·es et en criminalisant les luttes antiracistes. C’est de ce point de vue que Macron est un acteur majeur de la fascisation : à la fois parce qu’il a banalisé et légitimé les politiques proposées par l’extrême droite, ce qui a amené le renforcement important de son influence électorale, mais aussi (et peut-être surtout) parce qu’il a engagé une transformation de l’État lui-même. Le fascisme pourrait bien être le point de destination de politiques autoritaires qui donnent des pouvoirs de plus en plus importants et arbitraires à la police, pour surveiller et châtier les minorités, les quartiers populaires et d’immigration, mais aussi pour réprimer les mouvements d’émancipation. Le fascisme est aussi présent à l’état embryonnaire à travers les politiques et discours islamophobes qui fournissent à la fois un ennemi, dont on doit dissoudre les organisations et réprimer les moindres velléités d’autonomie (au nom de la lutte contre le « séparatisme ») et un prétexte à ce renforcement autoritaire de l’État que je viens d’évoquer.
Verveine Angeli : Est-ce que l’intersectionalité est un outil opérant pour lutter contre le racisme et contre l’extrême droite ? Et quelle autonomie revendiquer pour l’émancipation ?
Omar Slaouti : En amont du concept d’intersectionnalité comme outil de lutte, il y a des réalités objectives qui font par exemple, que les femmes noires et arabes salariées de l’Hôtel Ibis ne subissent pas une oppression genrée ou une oppression raciste ou une exploitation de classe mais une sur exploitation où genre, race et classe s’interpénètrent de manière dynamique créant une singularité nouvelle. Ce n’est pas une intersection figée des oppressions, c’est un entrecroisement dynamique qui à chaque instant reconfigure les corps. C’est en partant de cette approche que l’articulation des luttes d’émancipation peut prendre sens et toute son efficacité. Il ne s’agit pas d’une manœuvre tactique pour être plus nombreux et nombreuses dans la lutte, avec des cortèges patchwork où chacun∙e vient dans le sien avec ses propres revendications. Il s’agit, par exemple, de comprendre et d’agir contre la racialisation au sein même des luttes féministes, de comprendre et d’agir contre le patriarcat au sein même de nos luttes antiracistes et décoloniales etc. Ma ville à Argenteuil, où il y a des zones de relégations sociales, raciales et genrées du fait de la présence nombreuse de femmes de familles monoparentales est aussi (et pas par ailleurs), l’une des dix villes les plus polluées d’Europe au monoxyde d’azote. Dès lors les luttes écologiques doivent intégrer l’exigence de justice climatique pour tous ceux et toutes celles qui racisées d’en bas ou/et femmes sont bien souvent les premières victimes du dérèglement climatique. Les luttes doivent devenir intersectionnelles car nos vies cristallisent cet entrecroisement dynamique des oppressions.

Mais il y a un autre outil non négociable dans nos luttes d’émancipation. C’est celui de l’autonomie quitte à faire hurler les plus obtus d’esprit comme ceux, celles qui pensent que nous ne devons pas diviser notre classe sociale ou encore qui estiment que l’exploitation capitaliste est l’oppression première et que les autres sont secondaires. Je ne parle pas de ceux, celles qui hurlent au séparatisme lorsqu’une réunion en non-mixité existe, je parle de militants et militantes qui ont une approche dogmatique donc faussée du marxisme. Les syndicats en particulier ont un rôle majeur dans la période, par exemple au moment où Macron va resservir le couvert avec la réforme des retraites, qu’il avait dû mettre de côté après la mobilisation de 1,8 millions de personnes en décembre 2018, il serait important que l’on mesure à l’instar de ce qui est fait pour les femmes, en quoi cette contre-réforme creuserait encore davantage les inégalités entre les français et les étrangers, entre les blancs et les non-blancs. Ce travail serait d’autant plus facilité que des réunions non mixtes puissent se créer dans ces appareils de lutte. On peut être certain.es que des mobilisations qui tiennent comptent des conséquences de cette réforme des retraites en fonction du genre, de la race…seraient non seulement plus massives mais permettraient si en plus les porte-paroles ou responsables de ces appareils sont à l’image des concerné.es, de passer de la défiance, à la méfiance puis à la confiance. L’autonomie, c’est ce qui a permis à de nombreux collectifs contre les violences policières de se construire et d’occuper le champ politique, idem pour les luttes des migrant.es, des sans-papier.es. C’est ce cadre d’autonomie portée par les premier.es concerné.es qui est le seul garant de la lutte contre l’islamophobie, la négrophobie, l’antitsiganisme. C’est toujours au sein de ce cadre autonome que peuvent se discuter les questions tactiques comme celles des alliances et stratégiques comme celle du pouvoir.
Verveine Angeli : Vous distinguez convergences, alliances, articulations des différents mouvements ? Comment faire concrètement ? Comment lier les combats contre le racisme et contre l’extrême droite ? Quelle place à vos yeux pour les syndicats ?
Ugo Paletha : Au-delà des mots et des expressions parfois fatiguées parce qu’elles ont été beaucoup utilisées depuis des décennies, comme celle de « convergence des luttes », il y a l’idée juste de l’unité, qui est une aspiration largement partagée par celles et ceux qui souffrent des politiques néolibérales et racistes, et qui est une nécessité pour rompre avec l’ordre social actuel. Mais nous insistons effectivement dans le livre sur le fait que cette unité doit être un objectif, un combat, pas un préalable : on ne peut pas se contenter d’exiger l’unité comme on exigerait que chacun·e se mette au garde-à-vous, ce qui signifie bien souvent en pratique le fait de se ranger derrière le plus fort et de mettre de côté les questions ou les revendications portées par les différents mouvements d’émancipation, ou du moins celles qui fâchent, celles qui ne font pas consensus dans les franges dominantes de la gauche (islamophobie, violences policières…).
On a vu en particulier comment, à de nombreuses reprises depuis 40 ans, les aspirations et les propositions des mouvements antiracistes, de l’immigration et des quartiers populaires avaient été marginalisées ou instrumentalisées, et une partie de ses militants cooptés, notamment par le Parti socialiste et ses alliés. Mais on l’a vu encore régulièrement ces dernières années, par exemple au moment de la discussion parlementaire de la loi dite « séparatisme » où la gauche sociale et politique a été aux abonnés absents, ou pour être plus précis a simplement refusé de construire le front de lutte qui était absolument nécessaire contre cette loi scélérate, qui va toucher en premier les musulman·es (leurs organisations, leurs lieux de culte, etc.) mais qui – comme toutes les lois de ce genre – va aussi affecter les autres luttes et organisations. Par exemple, la dissolution par le gouvernement du GALE (Groupe antifasciste Lyon et environs) a été en partie légitimée par des articles de la loi « séparatisme », qui condamne en particulier le fait pour une organisation de dénoncer l’existence d’un racisme d’État ou institutionnalisée.
L’unité ne doit donc pas se faire au détriment de l’autonomie des mouvements (dont Omar vient de rappeler l’importance) et de leur égale dignité. Et on voit bien à quel point cette question résonne aujourd’hui, avec non seulement la brèche ouverte par l’Union populaire lors de la présidentielle mais surtout la (difficile) construction d’un front politique qui a suivi. Pour construire véritablement un tel front, il faut intégrer les propositions centrales des différents mouvements (par exemple, pour ce qui est du mouvement antiracistes, l’abrogation des lois islamophobes, la régularisation des sans-papiers, la dissolution de la BAC, l’abrogation des lois qui donnent toujours plus de pouvoir à la police, etc.). Mais il faut aussi permettre que les mouvements aient une place en tant que telles dans les instances de campagne ou les instances permanentes du front en question, que ses acteurs·rices puissent se faire entendre, y compris en étant investi·es électoralement. Si l’unité se fait sans les militant·es racisé·es, il y a de grandes chances qu’elles se fassent contre les racisé·es, contre les revendications qu’ils ou elles portent, et que des avancées sur certains plans masquent le statu quo (voire des régressions) sur d’autres.
Verveine Angeli : Alors au final, quelles relations doivent exister entre mouvements antifascistes et antiracistes ?
Ugo Paletha : Concernant les relations entre antiracisme et antifascisme, il me semble que le mouvement réel a déjà levé partiellement une partie des barrières qui existaient il y a une vingtaine d’années. L’antifascisme c’est bien sûr la lutte contre les organisations d’extrême droite, parce que ces dernières sont les pires ennemis des opprimé·es et des exploité·es, celles qui portent un projet visant à écraser politiquement voire physiquement leurs organisations et leurs mouvements, à « épurer » le corps social de tout ce qui est perçu comme « étranger » à la nation, et cela peut conduire à des crimes de masse comme on l’a vu au 20e siècle. Pas étonnant que Zemmour parle – comme Drumont il y a presque un siècle et demi – de « parti de l’étranger » pour désigner les minorités et la gauche. Mais, en partie sous la pression de l’antiracisme politique, l’antifascisme s’est élargi de fait à de multiples luttes : contre l’islamophobie, contre les crimes policiers et leur impunité, contre les politiques anti-migratoires, etc. De ce fait, il s’est donné la possibilité de s’adresser plus largement à celles et ceux qui, dans les quartiers notamment, pouvaient légitimement dire : « je n’ai jamais été agressé par des militants d’extrême droite, par contre j’ai été agressé par des flics lors de contrôles policiers ».

Ce que nous défendons entre autres dans le livre, c’est qu’il faut approfondir cette alliance entre l’antiracisme et l’antifascisme, mais aussi continuer à politiser l’antifascisme dans le sens de la critique d’un « antifascisme républicain » qui prétend qu’il faudrait défendre les institutions « démocratiques » contre les fascistes et que ces institutions nous défendront contre les fascistes. Ces institutions n’ont d’abord jamais été pleinement démocratiques pour les opprimé·es (la classe dominante les utilisent en permanence pour réprimer leurs mouvements), mais elles sont en outre de moins en moins démocratiques, car de plus en plus grignotées par le processus de fascisation. Elles laissent de moins en moins de place pour des luttes autonomes de l’État (la preuve par l’encadrement policier des cortèges, que nous subissons depuis des années). Elles ne front presque plus aucune concession, même lorsque les luttes sont massives et majoritaires dans l’opinion. Et n’ayons aucun doute : ces institutions ne suffiront pas à nous protéger si les forces qui portent un projet fasciste parviennent au pouvoir : ni la constitution de la Cinquième République, ni l’État tel qu’il est, ne seront des remparts.
Dans ce paysage, les syndicats ont effectivement un rôle majeur à jouer parce qu’elles restent les organisations populaires les plus massives, les mieux implantées dans la classe travailleuse, malgré le grand affaiblissement subi durant les années 1980-90. Elles ont leur rôle traditionnel à jouer sur les lieux de travail, parce que l’extrême droite se nourrit de l’isolement des salarié·es et de la montée des concurrences. On ne fera pas régresser durablement le fascisme sans la reconstruction de solidarités collectives, et sans doute doit-on réfléchir collectivement – dans le cadre d’un front syndical, associatif et politique – à ce que pourrait être une stratégie spécifique là où l’extrême droite est la plus puissante : dans les villes petites et moyennes mais aussi les zones rurales ou semi-rurales. L’autre aspect, c’est que les syndicats ont assurément une place plus importante à prendre sur les questions spécifiquement antiracistes et antifascistes, à la fois par les voies qui leur sont propres (le militantisme sur les lieux de travail), et en tant que composantes de fronts plus larges. Mais cela exige un renouvellement des analyses et des pratiques.
Les expériences de fronts de lutte des dernières années ont été inégalement satisfaisantes. Exceptée la manifestation du 10 novembre 2019 contre l’islamophobie, qui avait été un large succès (suscitant une réaction massive et haineuse de la classe dominante), elles n’ont été ni de francs succès, ni des échecs complets. Il faut donc ne pas désespérer : la fascisation a tellement avancé, les organisations fascistes ont tellement progressé, que nous sommes engagé·es dans une lutte de long terme, une lutte « sans trêve » comme disait Angela Davis. Mais pour cela il faut que le monde syndical prenne davantage ces enjeux au sérieux : en matière d’antiracisme, il y aurait par exemple beaucoup à faire pour aller plus loin que les positions abstraites (« même patron même combat »), qui dissimulent les inégalités raciales entre travailleurs·ses, et engager un véritable combat contre les discriminations systémiques : en lien avec des chercheurs·ses sur ces questions, le monde syndical pourrait promouvoir des outils de mesure, mener des campagnes politiques et militantes, engager des procédures contre des entreprises, etc. Là encore, le combat global pour un autre monde possible n’est pas contradictoire avec les luttes autonomes ; au contraire, le premier se renforcera au contact des secondes.
Omar Slaouti, Ugo Palheta
Propos recueillis par Verveine Angeli
[1] Aimé Césaire (1913-2008) est un écrivain et homme politique martiniquais.
[2] Éditions La Découverte, 2020.
- Du congrès Solidaires… - 31 août 2024
- Dialectik Football - 30 août 2024
- Le Miroir du football : un journal de référence - 29 août 2024
