La santé publique en Grèce, on affûte les couteaux pour réduire les dépenses

Les mêmes recettes sont appliquées partout, avec des modalités, à des doses et à des rythmes distincts selon les rapports de forces socio-économiques et politiques du moment, en vue de donner la priorité aux intérêts privés et à la concurrence. Le but serait d’accroître la « rentabilité » des dépenses de santé afin de créer les conditions d’un développement économique soutenable. Mais on voit bien aux États-Unis et même en Europe, notamment en France, que la marchandisation de la santé est insoutenable : les coûts ne se réduisent pas (surtout pas les coûts bureaucratiques), ils augmentent ; les restructurations et réorganisations désorganisent les services, y compris les plus critiques (soins intensifs, urgences), le travail des personnels soignants est « empêché », ils et elles ne parviennent plus à « bien faire » leur travail, s’épuisent au point de mettre la vie des autres, et la leur, en danger ; la recherche médicale est minée ; l’accès aux soins se réduit, les inégalités s’approfondissent… Tous résultats délétères que l’on constate aussi en Grèce, à cette différence près que le démantèlement du système de soins y a été beaucoup plus expéditif et ses conséquences corrosives plus intenses. Les gouvernements grecs ont taillé dans les dépenses de santé « avec des couteaux de boucher », pour reprendre l’expression d’Andreas Loverdos, ministre de la Santé de 2010 à 2012, au moment même où les déterminants sociaux de la santé — la brutale dégradation des conditions de vie sous l’effet des politiques austéritaires dans leur ensemble — se répercutaient sur la santé publique.
On constate par exemple qu’entre 2009 et 2016, les dépenses de santé financées par les régimes publics et les régimes contributifs obligatoires ont diminué en Grèce de 42 %, alors qu’elles augmentaient dans les autres pays européens sauf au Portugal (baisse de 8 %). En France et en Allemagne, par exemple, elles ont crû de 29 % pendant la même période. Pour atteindre leurs buts, les gouverneurs [1] européens disposaient d’un outil de taille : le système dette, analysé en profondeur par le Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM [2]), leur a permis de soumettre la Grèce à un régime punitif de discipline et de contrôle de ses politiques et finances publiques sans équivalent dans l’histoire européenne d’après 1945. Ainsi armés, ils ont amené les autorités grecques (plutôt serviles) à engager des restructurations et réorganisations permanentes des secteurs du médicament, de l’hôpital et des soins primaires. Ces politiques sont présentées dans leurs grandes lignes avant d’aborder, dans un deuxième temps, leurs conséquences sociales et sanitaires.
Le système national de santé (ESY)
Tel qu’il fut institué en 1983, l’ESY associe de façon complexe trois types de structures.
D’abord, des structures financées par l’impôt (l’ESY proprement dit) comprenant principalement les hôpitaux publics, des centres de santé ruraux et plus rarement urbains et des services ambulatoires.
Ensuite, des organismes appartenant au réseau des assurances sociales obligatoires structurées par branche ou par catégorie socio-professionnelle, financées par des cotisations et couvrant l’essentiel (95 %) des soins primaires. Parmi elles, quelques-unes – dont l’IKA (la Fondation de Sécurité sociale créée en 1934) des travailleurs et travailleuses du secteur privé – disposaient de leur propre infrastructure de soins et de leurs propres médecins. Les autres achetaient des services en partie ou en totalité au secteur privé. Cette structuration a été modifiée à partir de 2011.
Enfin, le très important secteur privé avec ses médecins, dentistes, laboratoires, centres de diagnostic, hôpitaux et cliniques ambulatoires
DE L’ART DE TAILLER DANS LES DÉPENSES

En 2009, la surconsommation de médicaments était incontestable en Grèce. Pour diverses raisons de malfonctionnement, elles-mêmes en partie liées à des pratiques de corruption, ou pour le moins à une déontologie peu rigoureuse de la part de certains médecins, le pays dépensait 2,4 % de son PIB en médicaments, contre 1,6 % en moyenne dans les pays de l’OCDE. La réduction des dépenses pharmaceutiques, programmée dès 2010, a permis de réaliser des économies substantielles (une baisse de 56,4 % des dépenses publiques pharmaceutiques entre 2011 et 2015) au moyen de diverses techniques, dont l’établissement de listes régulièrement modifiées de génériques remboursables, des dosages dans le panier de soins et surtout le transfert d’une partie des coûts aux patients et patientes. Ils et elles doivent assumer une proportion croissante de la dépense totale non remboursée au risque de se priver de soins. En moyenne, le ticket modérateur est passé de 9 % du prix du médicament en 2011, à 25 % en 2013, 35 % à 40 % en 2015. Il oscille aujourd’hui entre 25 % et 50 %.
L’épuisement de la masse critique nécessaire au bon fonctionnement de l’hôpital public a été organisé d’abord et avant tout à travers une saignée des effectifs. En 2011, il apparaissait déjà que la chute des dépenses publiques hospitalières avait été obtenue au moyen d’une diminution de 75 % des coûts salariaux. Les salaires des professionnel.les de santé publique, qui étaient les plus faibles d’Europe, ont été réduits d’au moins 40 % depuis 2010. La compression du personnel a conduit à une perte d’au moins 30 % des effectifs consécutive au gel des embauches, au non remplacement de fait des départs à la retraite ou en retraite anticipée, pour ne pas mentionner l’exode massif de jeunes diplômé.es et de personnels médicaux partis à la recherche de conditions de travail meilleures hors de Grèce (18 000 médecins auraient quitté le pays). Pour combler des vides, des formes de rafistolage ont été inventées : conserver les internes plus longtemps à l’hôpital avec simultanément le statut d’interne et la fonction de spécialiste ; embaucher des personnels précaires sur des contrats non renouvelables d’un ou de deux ans maximum.
Parallèlement, la rationalisation et la mise en concurrence des établissements a été mise en œuvre à travers la fermeture de grands hôpitaux, la suppression et/ou la fusion de services et d’unités spécialisées, le regroupement de centaines de laboratoires, la privatisation de lits hospitaliers, l’élimination de milliers d’autres lits, et l’introduction de mécanismes managériaux de surveillance et de contrainte permettant de contrôler l’activité et les dépenses hospitalières. En 2013, on introduisit un système de tarification à l’acte, instrument budgétaire qui lie les recettes au volume et à la nature des activités plutôt qu’au prix de journée. Comme d’autres expériences l’ont montré, notamment en France, ce mécanisme métamorphose les établissements publics en « hôpitaux-entreprises ». Il les place en position défavorable sur un « marché des soins » dont profitent les hôpitaux privés car ceux-ci peuvent facilement capter les parts de marché lucratives constituées par les traitements relativement simples et peu risqués de maladies courantes et prévisibles, et laisser aux hôpitaux publics le soin de prendre en charge (en dépit de leurs ressources fortement diminuées) les traitements plus complexes, coûteux et risqués. Un vaste supermarché de la santé est en voie de constitution, qui transformera l’organisation de l’espace sanitaire, comme l’indique l’achat par d’énormes fonds de placement d’hôpitaux (Metropolitan, Iaso General, Hygeia, Mitera dans la région d’Athènes) et autres services médicaux et assurantiels.
Avant 2010, les soins primaires, assurés à la fois par des entités publiques (hôpitaux, centres de santé et autres structures), par des organismes privés (centres de diagnostic, hôpitaux etc), par les caisses d’assurance et/ou par des professionnel.les sous contrat avec elles, était un secteur structurellement fragmenté, mal coordonné, en proie à des difficultés permanentes. Diverses opérations lancées par les autorités entre 2011 et 2017 ont eu pour objet de contrôler et mutualiser les activités et les structures et de rationaliser en les séparant les fonctions d’acheteur et de prestataire de services. C’est ainsi qu’une unique Organisation nationale pour la prestation de services de santé (EOPYY) placée sous le contrôle du ministère de la Santé fut créée en 2011 sur le modèle de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie française (UNCOM). Elle absorba les caisses d’assurances sociales et devint le seul acheteur de médicaments et de services de soins de santé pour tous les assurés. En 2014 fut tentée une reconfiguration de la fonction de prestataire de services, avec la création de réseaux nationaux de soins de santé primaires (PEDY), une initiative si mal pensée (le principal objectif du ministre, Adonis Georgiadis, avait été de se débarrasser de 1 500 salariés) que les structures de soins primaires, essentiellement celles de l’ancienne IKA, cessèrent pratiquement de fonctionner. Finalement en 2017, un nouveau plan pilote étalé sur trois ans a été lancé. Il vise la modification des comportements des patientes et patients (et avant tout le désengorgement des urgences hospitalières) à travers la formation d’un système de soins primaires à deux niveaux comprenant des « unités locales de santé » (ToMY) à la base chapeautées par des « centres de santé » plus conséquents. Faute de moyens matériels et humains, dont l’insuffisance est criante, toutes ces réorganisations, y compris la dernière, n’ont guère amélioré la situation. Elles ont plutôt désorganisé les soins et accentué les difficultés d’accès à la santé publique. Ainsi, de nombreuses ToMY ont été créées qui encouragent les citoyens à s’y inscrire, mais ce sont encore des coquilles vides dont le seul objet, d’après nos enquêtes, est de montrer à la Commission européenne que les « réformes » progressent. En somme, comme le dit une docteure, « il manque le réseau social et professionnel pour apporter un soutien aux malades. Et ça, ils ne l’ont pas mis en place ni ne le feront parce qu’il faut beaucoup d’argent et un personnel stable. »
QUEL DESTIN PROFESSIONNEL ET SOCIAL ?

Il est impossible de résumer les conséquences des opérations de restructuration des institutions de santé publique, car elles affectent tous les domaines de la vie personnelle et sociale et sont en retour amplifiées par les meurtrissures consécutives à dix ans de dépression économique forcée. Quelques indications, tout de même. D’abord, sur les conditions de travail. Les sous-effectifs sont le principal problème. Ils conduisent à un allongement excessif de la durée du travail, à l’épuisement des personnels et rendent précaire et dangereux le travail à l’hôpital. Dans tous les secteurs de la santé publique, le personnel soignant fait du « taylorisme médical » : « Nous voulons travailler, nous voulons aider, mais [il faut faire] vite, vite, vite et tu as cessé d’avoir du temps libre pour pouvoir penser à un patient, penser à un autre protocole, avoir une discussion » (une médecin). Les non-recrutements pourraient bien sonner le glas des hôpitaux publics : « Il y aura des services dans lesquels l’âge moyen sera de 55 ans, il n’y aura pas de jeunes qui se forment et le niveau de départs à la retraite ne cessera de croître ; et dans 7 à 8 ans au plus, il faudra faire des recrutements massifs dans l’ESY, sinon les hôpitaux vont fermer. Ce n’est pas possible que les hôpitaux aient un personnel de soixantenaires. Qui sera de garde ? » (médecin pratiquant désormais dans un cabinet privé).
L’absence de planification sérieuse, pour tout dire la désorganisation, accroît les difficultés. Par exemple, en dépit d’un récent programme coûteux d’achats d’infrastructures pour les hôpitaux de la région d’Attique, les équipements dorment dans des cartons : il n’y a pas de personnel ou de programme pour les faire fonctionner. Souvent mentionnée, l’absence de fournitures les plus élémentaires ne tient peut-être pas à un problème économique, mais à la « gestion des besoins par les bureaucrates. (…) Au lieu d’acheter des draps, des taies d’oreillers et toutes ces choses-là, ils vont fabriquer un bureau qui s’apelle ‘bureau de la qualité’ et à côté un autre bureau qui s’appelle ‘bureau des réclamations’. Et un patient fait une réclamation – s’il sait écrire ; et le bureau des réclamations prend [la feuille] et la porte au bureau de la qualité ; et après, un employé la prend et l’emmène dans tous les bureaux. Mais rien ne se fait. Il n’y a pas de planification. Nos chefs nous disent qu’ils ont les mains liées du fait des normes des politiques publiques, mais je crois que ce n’est pas seulement ça. »
La « crise » des urgences, qui existe aussi en Grèce, s’explique par l’impossible ou le très difficile accès des citoyens et citoyennes à la santé publique. Entre 2011 et 2016, officiellement, 12,5 millions de chômeurs et chômeuses – plus probablement 3 millions – sur une population totale (en diminution) de 11 millions, n’ont plus eu accès aux soins parce qu’en perdant leur emploi, ils et elles avaient aussi perdu leur assurance maladie . Elles et ils avaient la possibilité d’aller à l’hôpital public, mais l’établissement leur facturait leur traitement et, s’ils ne pouvaient pas payer, leur dette était transmise aux impôts qui s’occupait du recouvrement (y compris par le recours aux saisies immobilières). En 2016, une loi devait garantir un accès « universel » à la santé publique à tous les citoyen.nes légalement installés dans le pays. Elle a un peu amélioré les choses. Un peu. Parce que sont exclus du dispositif les traitements privés ou contractés par l’EOPYY avec des médecins ou structures privées. Parce que la gratuité des médicaments est exceptionnelle, réservée seulement aux quelque 15 % de la population classée « extrêmement pauvre », à condition que les intéressé.es soient reconnu.es comme tels à la suite d’une procédure bureaucratique à travers laquelle ils ou elles prouvent leur dénuement total, et cette procédure, d’après mes recherches, élimine injustement plus de la moitié d’entre eux et elles, sans doute les trois quarts. Et parce que les listes d’attente étant monstrueuses, les rendez-vous pour une consultation ou un examen peuvent prendre trois à six mois. En somme, « l’accès, tout seul, c’est comme si on me disait à moi que je te donne une carte d’accès libre à tous les autobus du pays, à cette différence près qu’il n’y a pas d’autobus dehors » (docteure).
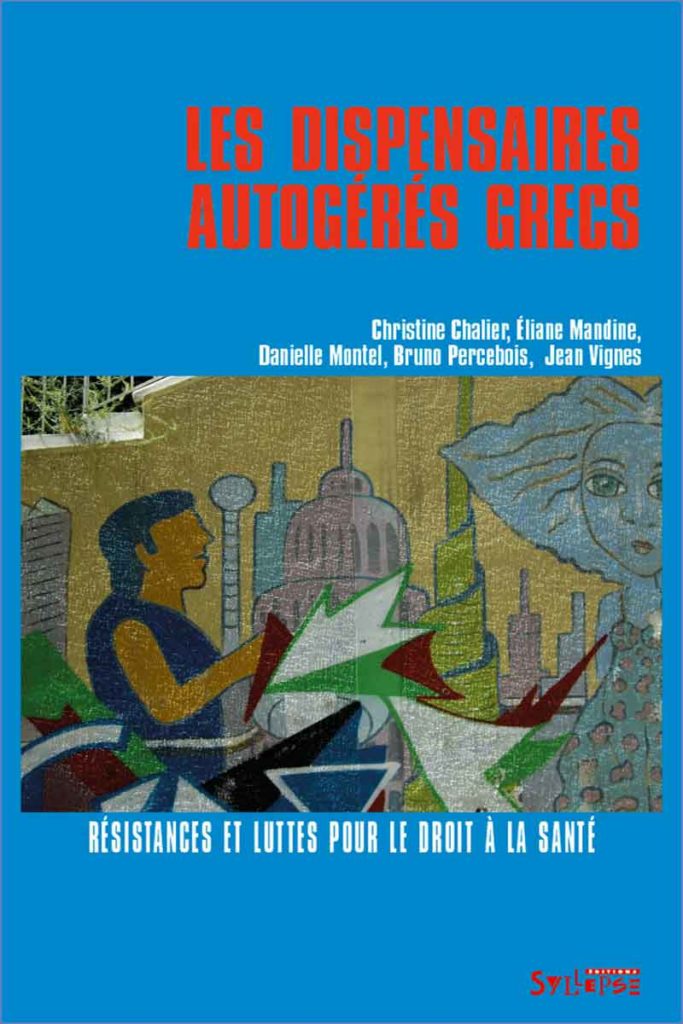
Les sans papiers sont exclus de l’accès à la santé. L’actuel gouvernement conservateur est tenté d’en exclure aussi les réfugié.es régulièrement entrés sur le territoire (qui y avaient théoriquement droit). Est-ce que cela ne favorise pas l’apparition et la dissémination de maladies ? La réapparition de la tuberculose, de la rougeole, de la malaria est causée par la pauvreté, non par le statut de migrant ou migrante. Comme l’explique une spécialiste des maladies infectieuses, celles-ci sont liées à la plus ou moins grande résistance de l’organisme quand il entre en contact avec elles. « Même moi qui suis en contact avec beaucoup d’infections – je suis médecin –, si vous me laissez à jeun, dans le froid, à marcher pendant des kilomètres, et que vous m’enfermez dans un camp militaire, je vais attraper la tuberculose, c’est sûr. Pas parce que mon voisin me l’a transmise, mais parce que moi, je suis très faible. » Beaucoup de Grecs ont peur des migrant.es, des gitan.es, des réfugié.es. Les femmes rechignent à accoucher à l’hôpital public pour ne pas les côtoyer. En général, ceux et celles qui peuvent payer paient. Et beaucoup de médecins sont complices, qui demandent un dessous de table. « La Grèce, dit un néphrologue, « travaille avec des passe-droits, tous ceux que nous soignons ici [dans un établissement public], c’est comme ça, [ils proposent de l’argent pour trouver un médecin ou avoir un traitement] ». D’autres gens, nombreux, se négligent, ne prennent pas leurs médicaments ou les vendent, viennent se soigner quand il est déjà trop tard. Il n’y a pas de données quantitatives, mais les témoignages recueillis concordent. Par exemple, « Tu vois des gens qui ont eu un épisode cardiaque et on leur dit : ‘Marche !’ ; ils ne marchent pas. ‘Faites attention à votre poids !’ : ils n’y font pas attention… Les gens sont réellement comme s’ils avaient abandonné leur soi » (un neurologue). Un autre médecin évoque des situations de personnes ayant vainement cherché des solutions à leurs problèmes de vie ; il arrive un moment, dit-il, où « ils renoncent. Ils renoncent en attendant la mort (…) renoncent à l’effort de survivre (…) attendent leur destin ».
Les programmes d’ajustement structurel et les prétextes budgétaires ont fermé la vie des gens. Ils n’ont plus d’avenir, le savent, entrent en dépression (problème considérable), ont des crises de panique, se laissent mourir, tentent de se suicider, y compris les enfants d’après les témoignages de pédopsychiatres. Et pendant ce temps, les gouverneurs affûtent les couteaux pour tailler dans d’autres dépenses.
[1] J’emploie le mot gouverneurs pour marquer le déploiement en un ordre de bataille quasi militaire des injonctions et des mesures d’austérité.
