Gilets jaunes, On nous appelait les prisonniers politiques

« Je n’aurais jamais cru aller en prison ! » Le 11 mars 2019, le verdict du tribunal de grande instance de Montpellier s’abat comme un coup de massue sur Victor [1]. « 4 mois ferme avec mandat de dépôt, 8 mois de sursis, 800 euros de dommages et intérêt ». Arrêté lors de l’acte 16, pour avoir tiré un feu d’artifice en direction des forces de l’ordre, ce gilet jaune de Montpellier est jugé en comparution immédiate pour « violences contre les forces de l’ordre » et « participation à un groupement en vue de commettre des violences ». Les images de son jugement tournent en boucle dans sa tête. « Ça n’a même pas duré 10 minutes. Je n’ai rien compris à ce qui se passait. » À peine sorti de sa garde-à-vue, sidéré, ce plombier et père de famille est embarqué au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone. Placé pendant cinq jours dans le quartier des « arrivants », il y reçoit un petit kit avec le minimum nécessaire pour le couchage et l’hygiène. « Au début c’était terrible. Je ne voulais pas sortir de ma cellule, être confronté aux surveillants et aux détenus. » Il sortira de prison trois mois plus tard.
PLUS DE 2200 PEINES DE PRISON PRONONCÉES, FERMES OU AVEC SURSIS
Victor fait partie des 440 gilets jaunes condamnés à de la prison ferme avec mandat de dépôt, selon le dernier bilan du ministère de la Justice, en novembre, qui comptabilise 1000 peines de prison ferme allant d’un mois jusqu’à 3 ans [2] Sur ce total, 600 peines ont été prononcées sans mandat, aménageables avec un bracelet électronique ou un régime de semi-liberté [3], tandis que 1230 gilets jaunes ont été condamnés à de la prison avec sursis. Cette répression carcérale est inédite dans les dernières décennies. Seules les révoltes des banlieues de 2005 ont fait l’objet de plus d’incarcérations, avec 763 personnes écrouées sur 4402 garde-à-vue [4].

Comme Victor, la grande majorité n’avait pas de casier judiciaire ni de connaissance du monde carcéral. « À 40 ans, bientôt quatre enfants, je n’étais pas du tout préparé à aller en prison ! » souffle Abdelaziz, ancien brancardier à Perpignan. Cette figure associative locale de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie se savait dans le collimateur de la BAC depuis le printemps 2017, où il avait diffusé une vidéo de violences policières. Le 5 janvier, une manifestation s’échauffe devant le tribunal de Perpignan. Des manifestant.es rentrent dans l’enceinte, des vitres sont brisées, des affrontements éclatent. Quatre jours plus tard, Abdelaziz est perquisitionné à l’aube. « Ils cherchaient mon gilet jaune et le mégaphone de mon association, pour me présenter comme le meneur. » Les policiers l’accusent d’avoir assené un coup de poing à un agent, ce qu’il conteste fermement. « En garde-à-vue les policiers disaient entre eux : « regardez, on a eu Abdelaziz ! ». « J’étais comme un animal qu’on avait attrapé ». Placé en détention préventive en attente de son procès en février, il est condamné à 3 mois ferme et 5 mois de sursis. « Deux autres gilets jaunes, Arnaud et André, interpellés au même moment, ont accepté la comparution immédiate en espérant que le juge soit plus clément ». Ils prendront 8 et 10 mois ferme avec mandat de dépôt.
ENTASSES A CINQ DANS UNE CELLULE DE 14 M2
À Perpignan, Abdelaziz rejoint un deuxième détenu dans une cellule conçue pour une personne.Au début, la cohabitation est respectueuse. Mais elle se détériore avec l’arrivée d’un troisième prisonnier qui dort sur un matelas à même le sol. « « Les conditions de détention étaient horribles. Nos toilettes sont à 50 cm de l’endroit où on mange, sans cloison. Il y a des grillages derrière les barreaux de nos fenêtres alors que c’est interdit. La surpopulation est de plus de 200 %. Des femmes s’entassent à quatre dans certaines cellules. Récemment un détenu s’est suicidé dans sa cellule. J’ai porté plainte contre la prison. » Émilie, compagne d’un gilet jaune incarcéré depuis juin dernier en détention préventive dans une prison du sud-ouest de la France, évoque aussi des conditions très dures. « Ils sont trois dans 9 m². Il doit régulièrement changer de cellule parce que la cohabitation se passe mal. » Son compagnon a été interpellé avec 30 autres personnes dans le cadre de l’information judiciaire sur l’incendie du péage et de la gendarmerie de Narbonne Sud le 1er décembre 2018. Leurs demandes d’accès à une « unité de vie familiale » – un espace permettant aux couples et aux familles de se retrouver avec plus de temps et d’intimité que les parloirs [5] – sont restées sans réponse depuis trois mois. « On a fini par se faire un câlin dans le parloir. C’est interdit : l’administration nous l’a supprimé pendant deux mois. » Bastamag a aussi reçu le témoignage anonyme d’un détenu purgeant une peine de plus de deux ans dans une prison du nord de la France. Entassé avec quatre autres personnes dans une cellule de 14 m², il déplore des conditions insalubres : « une table, quatre mini-placards, un WC dans un état lamentable, un lavabo sans eau chaude pour vaisselle et toilette, pas de frigo, des murs moisis, une prise électrique détériorée, des grilles à la fenêtre. Les promenades sont enclavées et grillagées ». Il dénonce une « lenteur abusive » de l’administration pénitentiaire provoquant des délais de « 10 jours pour obtenir un sac de linge arrivant, 3 semaines pour une plaque de cuisson, un mois pour un poste radio, et des courriers qui mettent jusqu’à une dizaine de jours pour nous parvenir ». Du côté des parloirs, il critique le « manque d’intimité en parloir collectif, des fouilles abusives et systématiques, et des problèmes informatiques récurrents pour la réservation des familles ».
À Montpellier, Victor a « ressenti la faim ». En prison, la nourriture fournie gratuitement n’est pas suffisante. L’image des détenus « nourris, logés, blanchis » est un leurre. Pour améliorer l’ordinaire, tous les détenus doivent « cantiner », c’est à dire acheter le surplus. Et tout se paie : nourriture supplémentaire, cigarette, papier toilette, savon, location de télévision, journaux, etc. Il est crucial d’obtenir de l’argent par des « mandats » envoyé par l’entourage ou en travaillant en détention. « Je m’entendais bien avec mon codétenu, au début il a cantiné pour moi. Une fois que j’ai eu mes cantinages, j’ai rendu la pareille à d’autres détenus en difficulté. » Pour Bruno, gilet jaune du Mans, « les conditions n’étaient pas trop mauvaises : il y avait même une douche dans la chambre ». Ce déménageur de 51 ans, avait d’abord écopé de 3 mois de sursis à la suite d’un feu de poubelle en janvier. Interpellé à nouveau le 16 février pour « outrage », « rébellion » et jet de canette de bière, il est incarcéré à la prison des Croisettes, un établissement plus récent « Ce qui est fatigant, c’est la routine. Le réveil, le café, les infos, la promenade du matin, le repas du midi, la télé, la sieste, la promenade de l’après-midi, le repas du soir, etc. Toutes les journées se ressemblent. » Pour tuer le temps et bénéficier de réductions de peine, Bruno s’est inscrit à certaines des activités proposées en prison : « J’ai fait l’école des prisonniers, avec des cours d’anglais, de mathématiques, de français et d’histoire géo. Et aussi des activités avec un groupe musical. ». Le compagnon d’Émilie, lui, s’est « inscrit à toutes les activités et au travail. Il a aussi participé à un atelier d’écriture dans le journal de la prison… sauf que le mot « gilet jaune » y était interdit ! »
« QUAND ON SORT, SI LE MOUVEMENT CONTINUE ON SERA AVEC VOUS ! »
Malgré ces conditions très difficiles, de nombreux gilets jaunes interrogés témoignent du respect exprimé par les autres détenus. « Mon nom c’était le « gilet jaune du B2 rez-de-chaussée » se souvient Victor. « Pendant les promenades, certains prisonniers me posaient des questions sur le mouvement. Certains disaient « quand on sort, si ça continue on sera avec vous ! » L’ambiance est similaire à Perpignan. « On nous appelait les « prisonniers politiques ». La majorité des détenus soutenaient les gilets jaunes. Ils savaient qu’on avait manifesté pour la justice et la dignité » témoigne Abdelaziz. « Les prisonniers, majoritairement issus des quartiers populaires, y aspirent aussi. Ils sont souvent incarcérés parce qu’ils ont fait des actions illicites pour obtenir de l’argent et améliorer leur quotidien. » Parfois, les manifestations de soutien sont allées jusqu’au personnel de la prison. « Une des surveillantes m’appelait « camarade » » se souvient Victor. Abdelaziz est encore plus affirmatif : « Les 3/4 des gardiens nous soutenaient, le restant sont des fachos. L’un d’entre eux participait même au mouvement au début. » Sourire aux lèvres, Victor évoque même des encouragements, à mots couverts, de la psychologue chargée de son suivi. « Elle a fini par me dire que j’avais raison d’aller aux manifestations. »

Ce respect diffus est pourtant loin d’être généralisé. Dans la prison du sud-ouest de la France où son conjoint est placé en préventive, Émilie évoque des « surveillants qui font tout pour [le] pousser à un geste de violence pour pouvoir le sanctionner ». Dans la prison du nord de la France, le détenu anonyme dénonce des maltraitances, avec « des surveillants parfois irrespectueux. Certains nous prennent même pour des chiens, d’autres donnent des coups physiques ou verbaux ». Dans cette même ville, un gilet jaune anonyme d’un collectif local analyse : « Au début il y avait encore des matons pro-mouvement. Mais maintenant l’image de « l’ultra-jaune » s’est imposée, il n’y a plus de bons traitements : ceux qui sont encore en prison sont particulièrement ciblés. » L’administration pénitentiaire ne fait aucun cadeau et cherche à saper le moral des gilets jaunes incarcérés. À son arrivée en janvier, Abdelaziz avait rencontré sept autres camarades au quartier des arrivants. Mais les retrouvailles ont été de courte durée. « L’administration nous a divisé dans les différents bâtiments de la prison pour casser les solidarités et éviter qu’on s’organise. À la fin, on ne se croisait plus, sauf par hasard à l’infirmerie. »
« MON PÈRE EST PRISONNIER POLITIQUE GILET JAUNE ! »
Pour résister à l’isolement, le lien avec la famille et les proches est indispensable. Chaque soir, à 21h, Victor avait son rituel, sa « bouffée d’oxygène ». « J’appelais longuement ma femme et mes enfants. C’était mon seul lien avec l’extérieur, à part la télé. Heureusement qu’on avait un téléphone en cellule. » Normalement interdits, ils sont tolérés de fait. « Comme pour le cannabis : c’est comme ça qu’ils achètent la paix sociale entre les murs. » À l’extérieur, les familles sont profondément bousculées par l’incarcération, à commencer par les enfants. « Mon plus petit m’a vu partir, menotté, de la maison à 6h du matin. L’autre a refait pipi au lit pendant que je n’étais pas là » explique Abdelaziz. « À la rentrée, la maîtresse a demandé à mon fils ce que leurs parents faisaient comme métier. Il a répondu : « mon père est prisonnier politique gilet jaune ! ».
En l’absence des prisonniers – surtout des hommes – les femmes se retrouvent en première ligne pour tenir le foyer et assumer les démarches pour les détenus, au risque de l’étranglement financier. « Ma femme a été obligée d’emprunter 3000 euros pour payer le loyer et les factures avec un salaire en moins. » explique Victor. Émilie, elle, « dépense toutes ses économies » dans des aller-retours coûteux pour les parloirs, le cantinage et les frais juridiques. « Normalement, on aurait dû faire les marchés cet été. On a un énorme manque à gagner ». Karine, assistante maternelle à Narbonne, « réfléchit à monter un dossier de surendettement ». Son compagnon, Hedi Martin, était un youtubeur influent au début du mouvement. « Il avait lâché son travail pour le mouvement. Il n’en a pas retrouvé depuis. On en a eu pour plus de 5000 euros de frais d’avocat : ça nous a tué. » Interpellé lui aussi dans le coup de filet autour de l’incendie du péage de Narbonne Sud, Hedi a fait un mois de préventive en janvier 2019, suivi de six mois de bracelet électronique. Dans le viseur des autorités, il avait aussi été condamné en janvier 2019 à 6 mois de prison ferme sans mandat de dépôt pour avoir relayé un appel à bloquer une raffinerie, un symbole de la répression ciblée sur les « meneurs » locaux.
S’ORGANISER POUR SOUTENIR LES PRISONNIERS
Mais tous les détenu.es n’ont pas la chance d’avoir des proches prêts à se mobiliser. Le soutien du mouvement est donc crucial. Candy, gilet jaune à Saumur, en est l’une des chevilles ouvrières. Après la fin des manifestations dans sa région, cette mère au foyer s’est impliquée dans l’écriture de lettre aux prisonniers. En août dernier, elle a créé le groupe Facebook « Un petit mot, un sourire : où écrire à nos condamnés » [6]. Sans bouger de sa maison, derrière son ordinateur, elle a épluché jour et nuit articles et réseaux sociaux pour retrouver les identités des prisonniers et les diffuser avec l’accord de leurs proches. De Toulouse à Reims, en passant par Caen, Lyon, Fleury-Mérogis mais aussi Digne, Bourges, Marseille, Béziers ou encore Grenoble, une cinquantaine d’adresses de prisonniers dans dix-sept prisons ont été collectées.Le groupe, animé par trois modératrices, rassemble plus de 2500 personnes, « dont un noyau actif d’une centaine ». Chaque semaine,ils écrivent aux prisonniers et publient leurs nouvelles et leurs besoins. « Les gens engagent une correspondance suivie, on ne les lâche pas : c’est le cœur qui parle ! » explique-t-elle. « On est devenus comme des parrains et des marraines, en recréant une grande toile de solidarité. »
Les contours de cette toile ont rapidement dépassé la pointe du stylo. « On s’est vite rendu compte qu’il fallait aller plus loin que les lettres. Certaines personnes sont isolées, sans famille. On ne pouvait pas les laisser dans cette situation. À Toulouse, un jeune détenu est resté seul quatre mois, sans visite de sa famille, ni référent pour ouvrir un parloir et l’accès au cantinage. On s’en est occupé. » Certains assurent des cantinages pour les prisonniers que la famille ne peut pas soutenir. D’autres récoltent des vêtements. « Chaque geste compte. Récemment, on s’est organisé pour héberger ceux qui sortent et ont perdu leurs logements. » Au-delà des réseaux sociaux, dans certaines villes le mouvement local s’est fortement mobilisé. « Tous les dimanches matin j’entendais des bruits de moteurs, de klaxon, de cornes de brume. Les gilets jaunes venaient faire du bruit. » se remémore Abdelaziz en souriant. « Je faisais tournoyer mon pull orange fluo par les grilles pour qu’ils nous voient » Le gilet jaune a aussi reçu du cantinage. À Montpellier, Victor se souvient avec émotion des feux d’artifice qui résonnaient au-dessus de l’enceinte dimanche soir. « C’était mon moment de gloire. Je sortais un miroir pour voir les explosions par le petit trou de ma fenêtre. Tous les détenus hurlaient, c’était de la folie. » Le groupe anti-répression de Montpellier, « l’Assemblée contre les violences d’État », s’est largement impliqué dans l’appui financier aux frais juridiques ou l’organisation de petits déjeuners devant les prisons, à l’instar de beaucoup de grandes villes familières de la répression comme Paris ou Toulouse. À l’inverse, dans d’autres villes la mobilisation a été très limitée. « À Narbonne la vague d’arrestations pour l’incendie de Croix-Sud a tué le mouvement. Beaucoup ont eu peur. Le reste s’est divisé et ne s’occupait pas des inculpés parce que l’action n’était pas pacifiste. » se souvient Hedi. Karine complète : « Hedi était connu donc il a été privilégié, avec une cagnotte, des rassemblements. Mais il n’y a presque rien eu pour les autres ». En plus de ses longues semaines de travail, Karine a donc créé en juin dernier, avec sa mère et des amies, le « Cool’actif de solidarité du 11 » [7] pour soutenir les prisonniers et prisonnières isolé.es.
« Je regrette qu’on se soit fait avoir par la justice au début du mouvement. On ne connaissait rien à la répression et à la prison. Maintenant il faut mieux informer les gens pour se renforcer. » Peu à peu, leur collectif s’est rapproché de groupes « antirep » expérimentés à Toulouse ou Montpellier. « On veut aller plus loin que l’appui aux incarcérés et promouvoir la défense collective : ne pas faire le tri entre « bons et mauvais manifestants », refuser de parler en garde à vue, se mettre en réseau avec les avocats. » explique l’assistante maternelle. À sa manière, la « famille gilet jaune » se réapproprie la lutte anti-répression.Mais la mobilisation reste cependant faible par rapport à l’ampleur des condamnations. Détenu en préventive pendant six mois à la prison de la Santé, le militant antifasciste Antonin Bernanos évoque, dans une lettre parue en octobre, « beaucoup de gilets jaunes croisés derrière les barreaux, souvent isolés, oubliés et démunis de tout soutien politique extérieur ». « Sur près 400 personnes, on n’a pu contacter que 10 % des prisonniers environ » constate Candy. Karine, de son côté, n’a pas reçu de réponses à toutes ses lettres. « Certains détenus nous ont dit qu’ils ne voulaient plus entendre parler des gilets jaunes en attendant leur jugement ». Notamment le procès-fleuve du péage de Narbonne mi-décembre où comparaissaient 31 prévenus, dont 21 ont écopé de prison ferme, avec deux mandats de dépôts et deux maintiens en détention. Isolés face au système judiciaire, ces détenus ont fait une croix sur le gilet.
« JE NE PEUX PAS QUITTER CE MOUVEMENT, APRÈS TOUT CE QU’IL A FAIT POUR MOI ! »
C’est aussi le cas d’Hedi, qui avoue avoir « tout arrêté dès que les embrouilles judiciaires ont commencé ». Le débit rapide de ce passionné d’informatique masque une certaine amertume. « Tout ce qu’on avait est allé dans ce mouvement : notre argent, notre voiture, nos meubles. Mais on a raté le coche. Il a fallu revenir à la vie normale. C’est comme une descente : je suis mort intérieurement. » Le coup dur est venu avec le bracelet électronique imposé de mars à fin novembre après sa détention provisoire. « J’étais en prison à domicile. Mon contrôle judiciaire m’interdisait d’aller sur les ronds-points, en manifestation, de sortir du territoire national. J’étais assigné à résidence de 22h à 6h, avec un pointage une fois par semaine, une obligation de travail et de soin. » Cette répression « à emporter » l’a conduit à faire une dépression. « J’ai senti l’étau se refermer sur moi. Un psy m’a prescrit un arrêt. Pendant quatre mois et demi je ne suis pas sorti de ma maison. » Comme pour les blessé.es, les conséquences post-traumatiques de l’incarcération sont insidieuses et s’insinuent partout dans le quotidien, générant repli, amertume, colère. L’entourage et les compagnes sont les premières affectées. « Ils te détruisent économiquement, psychologiquement. Si en plus ils arrivent à casser le niveau familial on perd tout. Beaucoup de couples explosent. » explique Karine.
Les nuits de Victor sont hantées par des cauchemars récurrents, peuplés de policiers qui le poursuivent et le perquisitionnent pour un meurtre qu’il ne sait plus s’il a commis. « Je me réveille le matin déboussolé. » Mais pas question de quitter le mouvement, malgré ses 8 mois de sursis, 2 ans de mise à l’épreuve, son obligation de travail et de suivi. « Je continue d’aller à toutes les manifestations. Toujours en première ligne, mais les mains dans les poches et à visage découvert ! Je ne peux pas lâcher le mouvement, après toute cette solidarité qu’il y a eu autour de moi. » Abdelaziz, lui, y va « un samedi sur deux, au plus loin des policiers. » En plus de son incarcération, Bruno a écopé d’une peine d’interdiction de manifester de 2 ans sur le territoire national. Une peine complémentaire qui, depuis le passage de la loi « anticasseurs » en avril 2019, tend à se généraliser dans les condamnations pour « violences » ou « dégradations ». Il a donc littéralement arrêté de marcher dans les cortèges du samedi, pas plus, pas moins. « Je reste 300 m plus loin devant ou derrière en faisant très attention, mais je suis là. Je vais partout où je peux aller, aux pique-niques, aux assemblées populaires, aux tractages sur les marchés ». Il s’est aussi impliqué dans la « coordination anti-répression » du Mans.
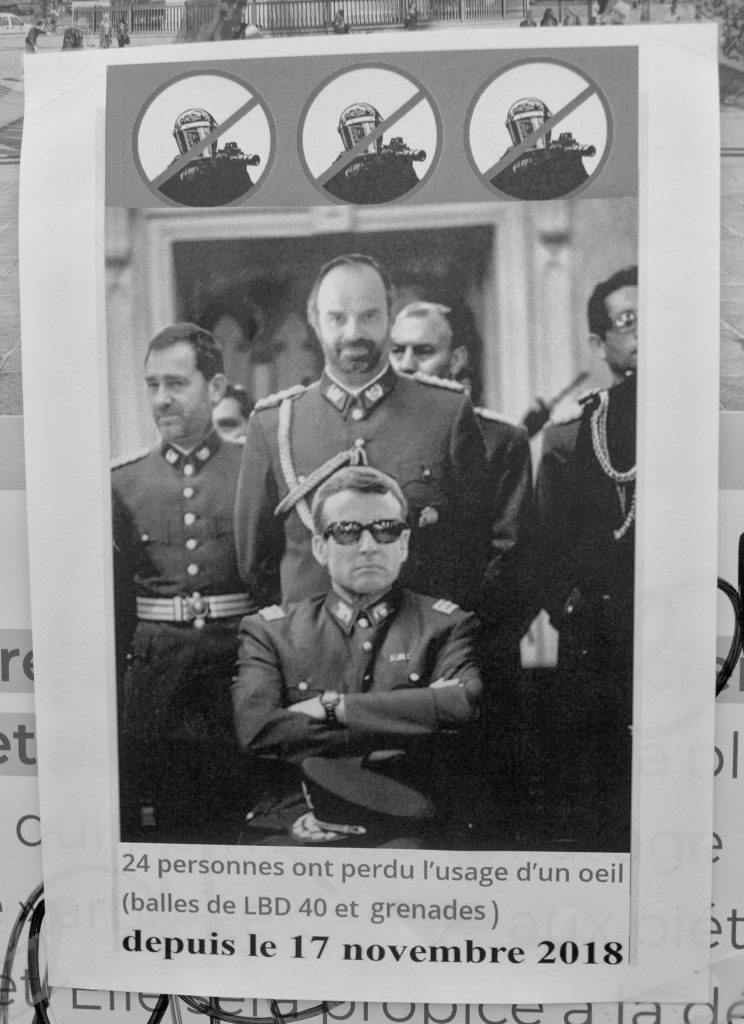
L’incarcération a profondément marqué les gilets jaunes interrogés. Tous ont changé de regard sur la prison. « Je croyais que c’était la guerre, que seuls les mauvais y allaient. Mes proches ont cru que j’allais me faire violer ou mourir. Mais j’ai surtout réalisé les conditions honteuses. » explique Victor. Les rencontres entre les mondes, entamées sur les ronds-points, se sont poursuivies entre quatre murs. « André, incarcéré avec moi, votait RN. » confie Abdelaziz. « Maintenant c’est fini. Il a changé de regard sur les détenus, qui sont surtout des personnes racisées issues des quartiers populaires. Ce sont des gens comme tout le monde. » Grâce au soutien sans failles de ses proches et du mouvement, la détermination de Victor est restée intacte. « Tous n’ont pas eu cette chance mais j’en suis sorti plus fort. Ils m’ont mis en prison pour me détruire, ça a produit l’inverse : j’ai encore plus ouvert les yeux. Le système ne sait plus comment faire pour contenir la colère sociale alors il enferme même des gens avec un profil « intégré ». Jusqu’au jour où ça explosera encore plus fort. » Le gilet jaune ne regrette en aucun cas le geste qui a provoqué son arrestation. « J’en ai assumé les conséquences. J’ai encore la rage : pour l’instant, on n’a rien gagné. »
[1] Plusieurs prénoms ont été changés.
[2] ww.bastamag.net/gilets-jaunes-champs-elysees-justice-repression-condamnations-violences-police-loi-anti-casseurs-prison#nb336-1
[3] www.liberation.fr/checknews/2019/11/08/un-millier-de-gilets-jaunes-condamnes-a-de-la-prison-ferme-depuis-le-debut-du-mouvement_1762173
[4] www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2006-4-page-431.htm#no2
[5] https://oip.org/fiche-droits/parloirs-salons-familiaux-et-unites-de-vie-familiale/
[6] www.facebook.com/groups/458302821392566/
[7]www.facebook.com/coolactif11voussoutient
- Gilets jaunes, On nous appelait les prisonniers politiques - 9 juillet 2020
